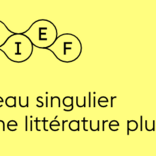Jean-Marc Roberts aura traversé la vie avec la grâce des équilibristes sur leur fil. Un rien voyou, qui ne détestait pas les parties de flipper dans les arrière-salles de cafés, mais très dandy : ces derniers temps, il portait beau le chapeau blanc, pour cacher son crâne malmené par les chimiothérapies. Un rien bourgeois, mais très bohème : il aura passé son temps à déménager, quittant les femmes de sa vie et les appartements dans lesquels il les avait aimées, sans rien emmener derrière lui, sinon quelques livres et ses disques préférés. Il aura fini par se persuader qu’il n’était pas doué pour le bonheur, pourtant on lui enviera longtemps son existence bien remplie. Il s’était convaincu, aussi, que personne, ou presque, ne l’aimait dans le métier. N’empêche, l’annonce de sa mort, même si elle ne fut pas une surprise, en a choqué beaucoup, à l’image de Claude Durand qui la juge « scandaleuse, intolérable ». Et rares sont les éditeurs dont la disparition provoque, dans la presse, un déferlement d’hommages comme celui qu’on a pu constater cette semaine.
Soyons cyniques : fidèle à sa réputation de grand « manipulateur », Jean-Marc Roberts aura su habilement préparer le terrain. Deux semaines avant de mourir, il publiait (chez Flammarion) ce qui serait, de toute évidence, son dernier livre, Deux vies valent mieux qu’une, l’émouvant récit entrecroisé de ses vacances adolescentes au soleil de Calabre et de ses séjours dans la grisaille des hôpitaux parisiens, après qu’un cancer du poumon lui a été diagnostiqué à la fin de l’été 2011. Ce n’était pas encore le « grand » livre qu’on attendait de lui, et qu’il remettait toujours à plus tard, depuis qu’il avait fait ses débuts, pressés, en littérature, en 1972, avec son premier roman, Samedi, dimanche et fêtes. Mais en tout juste cent pages, il tenait la chronique du mal qui allait l’emporter avec ce sens de l’humour et de la pirouette dignes, là encore, du dandy, inventant au passage un gimmick déjà entré dans la postérité - « Tumeur 1, saison 1 ; tumeur 2, saison 2 ». L’idée de ce livre lui avait en partie été inspirée par le destin de Muriel Cerf, adulée pendant quatre ou cinq ans, à peu près au moment où Roberts entrait lui-même en littérature, puis devenue un élément du décor, qui publia ensuite tous ses autres livres dans une quasi-indifférence et dont la mort, au printemps 2012, ne donna lieu qu’à quelques entrefilets. On comprend que ce silence, cet oubli pesant, l’aient hanté, alors qu’il s’enfonçait lui-même dans la nuit.
Faiseur de prix.
Mais s’il a mieux réussi sa sortie, c’est d’abord parce qu’il aura été un éditeur hors pair. «Un véritable éditeur, c’est-à-dire l’allié de vos exigences d’auteur », résume Erik Orsenna, qui le suivait depuis 1977 et qui aura fait l’essentiel de sa carrière avec lui. «Ce milieu est plein d’éditeurs qui veulent écrire leur livre manqué à votre place, poursuit Orsenna. Pas Jean-Marc. Il n’était pas un écrivain frustré. J’avais une confiance totale en son jugement. » Brigitte Giraud, dont Jean-Marc Roberts avait publié, en 1997, le premier roman, La chambre des parents, abonde dans son sens : « Il avait su pointer, dans ce premier texte, ce qui n’était pas abouti et son regard et son exigence m’avaient d’emblée impressionnée. La confiance a été là tout de suite. Un bon éditeur, c’est celui qui rassure, qui patiente, qui s’emballe. C’est un pilier, dans la vie d’un écrivain. J’aimais son intuition, sa capacité à s’enthousiasmer. Et puis, surtout, j’aimais la façon dont il attendait le livre. Le grand moment était juste avant de lui remettre le manuscrit, qu’il lisait toutes affaires cessantes. » Sa rapidité à lire n’était pas une légende : «Un jour, je lui ai remis un manuscrit de 850 pages, sur lequel j’avais travaillé sept ans, raconte Erik Orsenna. Trois jours après, il avait lu et il m’appelait : "J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle." - "Commence par la mauvaise." - "C’est la même que la bonne : tu peux faire mieux." J’ai passé un week-end épouvantable. Je l’ai rappelé le lundi pour lui annoncer que je reprenais tout à zéro, et ça a donné L’exposition coloniale. »Sa carrière d’éditeur, Jean-Marc Roberts l’avait commencée voici tout juste quarante ans, en 1973, d’abord comme simple stagiaire chez Julliard. En 1977, il arrive au Seuil, où il va rester seize ans et se construire une réputation. Notamment, de faiseur de prix - d’où cette image de « manipulateur » qui lui collait aux basques. En réalité, Jean-Marc Roberts, qui fréquentait beaucoup les casinos, où il a souvent perdu sa chemise, était un joueur. « Il s’enflammait pour le casino de la rentrée littéraire », résume l’écrivain Jean-Noël Pancrazi, juré Renaudot et son ami depuis plus de trente ans. « Il dépensait une telle énergie, au moment des prix, qu’on pouvait en retirer l’impression qu’il prenait ça trop au sérieux. Mais il le faisait à la fois par amour du jeu, et pour ses auteurs. Sa seule vraie stratégie était la stratégie de l’affectif. Jean-Marc, c’était l’homme de l’amour des écrivains. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un de plus engagé pour ses auteurs que lui. Il n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il avait pu décrocher une récompense pour l’un d’eux. »
Un éditeur dans la durée
En 1993, Claude Durand appelle Jean-Marc Roberts chez Fayard. Il va y créer la célèbre collection « Bleue », qu’il emportera ensuite chez Stock, et dont il avait raconté récemment la genèse à Libération : « Un jour, alors qu’un maquettiste se promenait avec un carton à dessin sous le bras, je l’ai pointé du doigt : "Voilà cette couleur ! On va faire une couverture bleue comme ça !" On m’a répondu que ce n’était pas une couleur pour la littérature. Claude Durand n’était pas tellement pour non plus, mais il m’a fait confiance » (1). Claude Durand confirme : « Nous étions tous sceptiques. Mais il en a fait sa marque de fabrique. Jean-Marc était quelqu’un qui défendait ses choix jusqu’au bout et qui, du même coup, imposait une sorte de légitimité de ses choix. »
En 1998, il est nommé patron de Stock. Gérant et directeur éditorial, le voilà seul maître à bord. Philippe Claudel, François Taillandier, Nina Bouraoui, Erik Orsenna, Christine Angot, Jean-Louis Fournier et beaucoup d’autres publieront chez lui quelques-uns de leurs plus beaux livres. Et la confiance professionnelle que d’autres, avant, lui avaient accordée, il va l’accorder à son tour : « En 2010, il m’a confié la direction d’une collection de littérature,"La forêt", raconte Brigitte Giraud. Il savait que nous avions des goûts parfois différents et il avait envie de proposer chez Stock un autre regard. Je crois qu’il aimait être surpris. Il lui est arrivé de me dire "ça, je n’en suis pas fou", mais il se battait autant pour imposer le texte. Il aimait qu’on affirme ses choix et les défende. Qu’on prenne des risques. »
Jean-Marc Roberts quitte la scène après un dernier « coup », le livre de Marcela Iacub, si fort décrié. Mais c’est oublier qu’il était avant tout un éditeur qui travaillait dans la durée. Ainsi, en 1995, lorsqu’il attire François Taillandier chez Fayard, il lui signe trois contrats d’avance : « Je n’en revenais pas, mais ce que j’écrivais l’intéressait et il voulait inscrire nos rapports dans le long terme. De même, quand je lui ai parlé un jour de mon projet de La grande intrigue, il a tout de suite adhéré. "Tu peux le faire", m’a-t-il assuré, alors que je n’avais pas encore écrit la première ligne. Le lendemain, je recevais la pile de contrats pour les cinq tomes ! Une telle confiance, c’est énorme ! »
Ces dernières semaines, Jean-Marc Roberts évoquait, devant les journalistes, la liste des « vautours » qui convoitaient son poste. « Mais il ne sera pas facile de lui succéder, pronostique François Taillandier. Celui qui s’assiéra dans son fauteuil ne devra pas seulement être compétent, mais surtout modeste. On ne fera pas oublier Jean-Marc Roberts en trois mois. Il a trop marqué cette maison de son empreinte personnelle. » En attendant, nombreux sont les auteurs qui, tel Erik Orsenna, se disent « orphelins ».
Daniel Garcia
(1) Libération du 8 mars 2013.
Ecrivain de saison
Précoce, prolixe, Jean-Marc Roberts laisse une œuvre légèrement grave.
Jean-Marc Roberts n’était pas l’écrivain des longues phrases, du grand style. Pas l’écrivain non plus de grands romans, amples et ambitieux, comme on dit. Adepte de l’autodérision, il a souvent été son plus lucide critique, se chargeant lui-même de remettre ses livres - une vingtaine publiée sur quarante ans - à leur place : ne les qualifiait-il pas de « petits romans de saison » dans François-Marie (Gallimard, 2011), plaidoyer pour le photographe François-Marie Banier, acolyte de ses 20 ans, compère des quatre cents coups ? « Mes livres, comme l’a regretté P.O.L en me refusant l’un d’entre eux, ressemblent à des tours de cabaret. Je fais sortir des lapins d’un chapeau, au mieux des colombes, mais si peu de vérités. Où est leur profondeur ? » s’interrogeait-il déjà dans Toilette de chat (Seuil, 2003), ce roman qui appartient à la veine plus franchement autofictive amorcée au mitan des années 1980. Dans le même livre, on pouvait aussi trouver cette appréciation : « Mes livres semblent tellement légers que je finirai par m’envoler avec eux. »
L’ancien « petit gros » avait mis sa prose au régime, écrivant des livres comme des biscuits secs, sans matière grasse, peu roboratifs. Pris un par un, sans doute aucun chef-d’œuvre, mais mis bout à bout, au final, une œuvre pourtant, un ensemble identifiable qui faisait dire dans ces colonnes, à propos de La prière (Flammarion, 2008), qu’il avait l’air d’« un Roberts très Roberts ». Qu’est-ce qu’était donc un Roberts ? C’était mince, souple, séduisant, gentiment roublard, furtif, habile, ironique, codé, coquet, cruel par saillie, grave en contrebande…
Eternel meilleur espoir.
Sa carrière avait commencé un peu par hasard mais pied au plancher, à 18 ans, avec Samedi, dimanche et fêtes (prix Fénéon 1973), le premier manuscrit accepté par Jean Cayrol après trois refus. L’adoubement, lui aussi, avait été précoce : lauréat du prix Renaudot 1979 pour Affaires étrangères, le jeune écrivain pouvait déployer à 25 ans l’étendard plein de promesse d’« écrivain le plus doué de sa génération ». Taraudé par la reconnaissance et doutant de la mériter, parvenu doué, Jean-Marc Roberts est ainsi resté l’éternel meilleur espoir des lettres françaises. Rien qui ressemble au destin du pote de jeunesse Modiano.Roberts romancier, saison 1, cela aura été une dizaine de titres enchaînés avant d’atteindre les 30 ans jusqu’à Méchant (1985), une étape. Il ne voulait plus écrire de romans « adaptables », analysait-il des années plus tard, après que cinq d’entre eux furent devenus des scénarios de films. Affaires étrangères, cette histoire de jeune cadre persécuté par son patron dans le monde de la publicité, était devenu en 1981, derrière la caméra de Pierre Granier-Deferre, Une étrange affaire, avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli dans les rôles principaux. Le même adaptera en 1983 L’ami de Vincent, tiré du roman éponyme.
A partir de 1988 et de Mon père américain, que, bloqué, Roberts mettra trois ans à écrire, le romancier accentuera encore le tournant autobiographique, donnant régulièrement, quoique à un rythme moins soutenu, des nouvelles de sa vie amoureuse et professionnelle, mêlant les protagonistes (rebaptisés ou non) de son show de music-hall - mère (Peggy dans les romans), femmes aimées, enfants et collègues - à des fictions qui s’amusaient à cacher les clés : Une petite femme, Un début d’explication, Je te laisse…
Désinvolture élégante.
Lui qui, en 1982, se décrivait en écrivain ayant besoin d’habitudes, de régularité, offrait plutôt des livres de dilettante qui donnaient l’impression d’avoir été écrits en passant, des romans « en vitesse » comme il le disait des souvenirs convoqués dans Deux vies valent mieux qu’une, le livre dans lequel, peut-être parce qu’il misait avec le plus de sincérité sur l’idée que ce serait le dernier, le tour de l’illusionniste était particulièrement réussi. Emouvant, autant que peuvent l’être ces drames où le héros-narrateur, en position particulièrement délicate, conserve une insouciance, une inextinguible joie. Et il faut du talent pour la légèreté. Encore plus pour s’y tenir. Ni l’âge, ni la maladie ne sont parvenus à recouvrir d’amertume la désinvolture élégante de la griffe Roberts. C’était sa grâce, un savoir-vivre.Jean-Marc Roberts avait un jour raconté qu’il s’était mis à écrire à 15 ans et demi quand il avait compris qu’il ne serait pas chanteur. « Je voudrais enfin réussir à lire Proust en entier, Thomas Mann aussi. Je ne m’abrite pas derrière une pose quand je parle d’imposture. On voit bien que je n’écris pas avec autant de mots », insistait-il dans son ultime livre. « Pas autant de mots », voilà bien le genre de tournures en esquive qu’il affectionnait : feinter en utilisant une négation à la place d’une affirmation. Ainsi il n’écrivait pas « Gérard venait d’apprendre une mauvaise nouvelle », mais « Gérard ne venait pas d’apprendre une très bonne nouvelle ». Une façon toujours déviée d’aller au but. Dans Cinquante ans passés (Grasset, 2006), Jean-Marc Roberts avait fait mettre sur la quatrième de couverture : « J’ai toujours rêvé d’écrire un livre comme celui-ci. Doux et imprévu. Un livre que je n’attendais pas. Raconter ce qui ne s’est pas passé, rien que pour voir où ça nous mène. » <
Véronique Rossignol