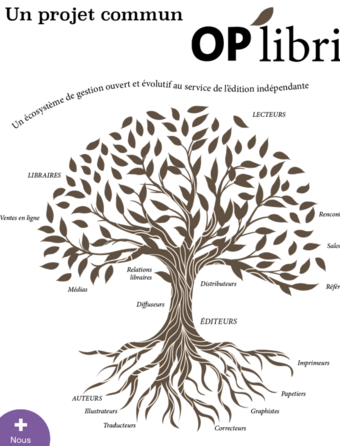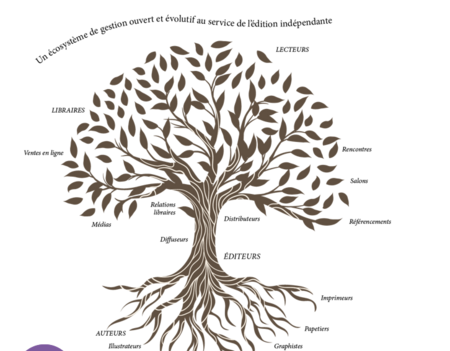J’étais interviewé, midi-septembre, durant le journal de 18h00 de France Inter pour commenter la « suspension » soudaine du livre « Le Fin Mot de l’histoire de France en 200 expressions », coécrit par Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot.
La journaliste Iliana Morioussef me demandait si les agissements de ce type étaient fréquents dans l’édition française.
Et d’évoquer la question de la liberté d’expression, à nouveau posée puisque ce livre évoque Vincent Bolloré et devait paraître aux éditons Le Robert, filiale d’un groupe qui lui appartient.
De fait, la rentrée littéraire, comme chaque année, connait son lot de polémiques, voire d’envoi de mises en demeures et d’assignations. Les articles estivaux, souvent à charge, les livres à clé avançant masqués, en témoignent autrement.
Ces livres sont tous édités de façon singulière, puisqu’ils passés entre les mains d’un avocat, révélant un phénomène d'autocensure devenu habituel. On ne peut en effet toujours pas publier sans trier ou dissimuler, sous peine d'être condamné. Les dommages-intérêts sont le visage moderne de la nouvelle inquisition.
L’avocat commence ainsi sa carrière d’homme de lettres en réécrivant les livres des autres. L’avocat ou le juriste d’une « entreprise » culturelle - maison d’édition, organe de presse, société de production, etc. - est un censeur professionnel. Il doit examiner la viabilité de l’œuvre au regard des quelques centaines de textes qui restreignent aujourd’hui la liberté d’expression. Cette science est devenue en quelques années si complexe, si dense, et parfois si rationnelle dans son irrationalité, qu’il faut des spécialistes pour « préjuger » des œuvres.
L’objectif est double. Il s’agit, d’une part, d’éviter, l’interdiction. Les éditeurs gardent en mémoire les gigantesques « loupés » qu’ont été L’Affaire Yann Piat ou Le Grande Secret, promis best-sellers et arrêtés par des juges quelques jours à peine après leur mise en vente, voire, pire, leur accession aux têtes de gondoles des hypermarchés. Tous les producteurs gardent à l’esprit Baise-moi, que le Conseil d’État, en le faisant retirer de toutes les salles convenables, tua commercialement. L’interdiction, par essence, ne fait pas vendre.
D’ailleurs, le simple scandale, la censure, le procès sont aujourd’hui de piètres arguments marketing. Ils peuvent éveiller une vague curiosité, au mieux une indignation, mais ils ne vaudront jamais une vraie campagne promotionnelle dans les linéaires, en 3X4 dans le métro, en abribus, sur Instagram, etc. Combien de poursuites, combien de condamnations pour si peu de colonnes de journaux ou de tweets ? Empiriquement, les spécialistes diront, à la buvette du Palais, au moins quelques centaines, sans doute quelques milliers… A l’année ! Un Houellebecq, un Sade, une Despentes, un Guyotat, un Skorecki ou une Angot, pour quelques cargaisons d’auteurs condamnés presque silencieusement, au palais de justice.
Il faut éviter donc, en premier lieu, l’interdiction, mais aussi sa version masquée : être condamné à tronquer un passage, à supprimer une séquence, à recouvrir une partie de l’affiche. Ces mesures ne sont « presque rien » aux yeux des juges. Mais, en pratique, pour un paragraphe interdit, il faut faire revenir tous les exemplaires des librairies. C’est le livre entier qu’il faut réimprimer, car il est impossible d’enlever ce « maudit » passage sans refabriquer un cahier de 16 pages, découdre l’ouvrage, le reconstituer, etc. En clair, devant l’auteur, qui culpabilise des tracas provoqués, l’éditeur déclare, furieux et soulagé : « on remballe, on ne le réimprimera pas, ça coûte trop cher » !
Sans compter les dommages-intérêts, les honoraires de l’avocat, le stress, le temps, l’énergie, la sensation de gâchis. Une condamnation « légère » coûte, pour parler chiffres et seulement chiffres, plus que la facture originelle de l’imprimeur ou du laboratoire.
L’autocensure dans l’édition
Quant à l’autocensure, elle est aussi vieille que le milieu du livre.
Trois exemples d’auteures censurées – puisque Nathalie Gendrot en est une - en attestent, à commencer par celui de la Comtesse de Ségur, qui se découvre à 55 ans un talent pour l’écriture en même temps que celui d’« idéale grand’mère ». Ses récits sont donc d’abord destinés à ses petites-filles.
Dans le même temps, Louis Hachette obtient le monopole de vente des livres et des journaux dans les gares. Il demande alors à son gendre, Émile Templier, de créer une collection destinée à l’enfance. Ce sera le début de l’emblématique « Bibliothèque rose ».
En seize ans, et jusqu’à sa mort, la Comtesse de Ségur écrira une vingtaine de romans pour enfants : sa volumineuse correspondance avec Émile Templier, son éditeur chez Hachette, fait état de changements que ce dernier lui imposa, notamment dans Les Petites Filles modèles (1858).
L’activité éditoriale est à cette époque contrôlée de près par l’État, et la censure ne laisse pratiquement rien passer. Afin de maintenir ses choix, la Comtesse tentera d’user à plusieurs reprises de l’autorité de son nom – en vain la plupart du temps, acceptant cette censure préalable demandée par son éditeur.
« Je désirerais me réserver la faculté de changements, additions, suppressions ou publications partielles », écrit-elle ainsi à Émile Templier en 1857, pour finalement conclure : « Mais, puisque vous tenez si absolument à exercer un pouvoir absolu et unique (…), que votre volonté soit faite et non la mienne. »
Durant les années 1860, alors que Napoléon ne soutiendra plus l’Église catholique, les vues de l’écrivaine et celles de la censure de l’État divergeront franchement : Hachette devra alors composer entre deux.
C’est ainsi que Théodore Barrau, directeur de La Semaine des Enfants, demandera « la suppression d’une centaine de lignes » dans L’Auberge de l’ange gardien (1863), car cela « n’ôtera rien au mérite de cette œuvre » et « notre jeune public n’en sera pas moins charmé ». La digne Comtesse, jugeant au contraire que ce serait « dénaturer l’ouvrage », campera fermement sur ses positions. Mais fait valoir ses soucis d’argent.
La suite est affaire de littérature, de légende et de compromis…