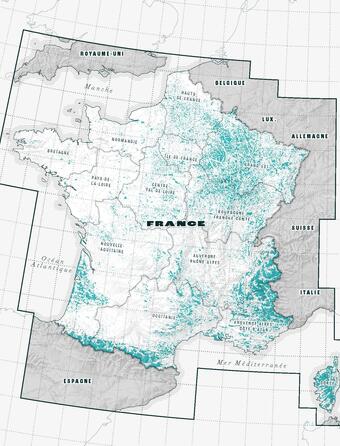L’amour, le désastre amoureux, elle en fait son affaire. Et plutôt deux fois qu’une. La première, c’était il y a deux ans, huit cents pages, un titre énigmatique et beau, Va et dis-le aux chiens, pour l’histoire d’un garçon et d’une fille qui vingt ans durant se cherchent et veillent à ne jamais tout à fait se trouver. Il y avait un ton, une voix, qui couraient tout au long de ce bréviaire « nouvelle vague » du désenchantement amoureux. La deuxième fois, le livre est moitié moins gros et tout aussi beau. Dans J’étais Quentin Erschen, un autre garçon, une autre fille, se rejouent les mêmes scènes de l’amour interdit, de l’absence au monde, de l’incompréhensible grammaire du désir. Isabelle Coudrier n’en connaît pas d’autre.
En deux livres donc, épais (« c’est pour faire sentir le passage du temps », dit-elle), amples, elle a imposé mieux qu’un univers romanesque, une tristesse fervente qui ne doit rien aux aléas de la modernité et qui est pourtant résolument contemporaine. Cette lectrice fervente de Stendhal, de Modiano, de La montagne magique, ne peut ni ne veut s’éloigner de son cher sujet, la passion amoureuse, le temps qui passe et le temps passé à le regarder filer, le silence insondable que creuse la jeunesse une fois qu’elle s’est enfuie.
S’enfuir, on devine que ce pourrait aussi être une tentation pour la romancière. Dans les bureaux de son éditeur, presque intimidante de fragilité, physique d’héroïne préraphaélite (Lawrence Alma-Tadema aurait pu la peindre, et l’actrice américaine Sondra Locke l’incarner à l’écran), elle se prête avec une circonspection gracieuse certes, mais un rien douloureuse, à l’exercice du portrait. S’il n’en tenait qu’à elle, elle se contenterait bien d’indiquer comme unique date biographique à retenir sa découverte de Proust, à l’adolescence, le pèlerinage jusqu’à Illiers-Combray qui s’ensuivit, et comment elle est demeurée jusqu’à ce jour dans cette lumière-là. Seulement voilà, ce J’étais Quentin Erschen doit moins à Proust qu’à Cocteau, et les jeux dangereux auxquels jouent ses héros dans leurs chambres closes sont ceux des Enfants terribles.
Chemins de traverse.
De nos jours donc, en France, dans la petite ville imaginaire d’Olsenheim en Alsace et puis à Paris, dans un grand appartement du boulevard Brune, quatre enfants, deux filles, deux garçons, vivent ensemble. Il y a là les enfants Erschen, Quentin, Delphine et Raphaël, qui grandissent auprès d’un père aimant, maladroit et lointain, sans leur mère, assassinée alors qu’ils étaient à peine nés. Il y a aussi la petite voisine, Natacha, qui leur voue une adoration inconditionnelle (sans doute rehaussée par le prestige d’être orphelins). Natacha aime Quentin qui ne sait pas aimer et qui, beau, brillant, semble n’attendre que quelque chose comme le plus grand chagrin possible, l’amorce d’une résolution. Il y aura des femmes qui disparaissent, des fêtes tristes, des examens passés avec mention, la province comme horizon, des coupures de journaux, des vacances, des virées à la piscine ou au cinéma, des jours de fièvre et des nuits chastes. On s’agitera un peu pour essayer en vain de s’aimer un peu moins.
Comme ses héros, Isabelle Coudrier a bien travaillé à l’école. Du moins jusqu’à Normale sup (« le latin m’a fait échouer… »). L’échec sera synonyme de chemins de traverse. Ce sera, en ces années 1980 où se réinvente autour d’Olivier Assayas et de Serge Daney une cinéphilie fervente, le cinéma. Et l’écriture qui est là, déjà. Elle écrit le scénario, élégiaque et fiévreux, de l’unique film, devenu culte depuis, de Michel Béna, Le ciel de Paris. S’ensuivront, avec un succès inégal, une série de films (ou de projets avortés…), biopic des « nuits fauves » de Roland Barthes, adaptations de Nicolas Bréhal, d’Yves Bichet, de Lutetia de Pierre Assouline, de L’échiquier du mal de Dan Simmons, qui tous semblent agiter la littérature comme un remords, comme un « je t’attends » de plus en plus impérieux. Isabelle Coudrier ira même jusqu’à réaliser elle-même un court et un moyen-métrage. Sans doute pour mieux s’assurer que ce métier-là, grégaire par essence, n’est pas pour elle. C’est le roman, l’écriture de Va et dis-le aux chiens, qui lui indiquera où est désormais sa place. Elle donne à lire son manuscrit à son agent qui le transmet aux éditions Fayard et l’affaire est faite. La belle affaire, vraiment.Olivier Mony
J’étais Quentin Erschen, Isabelle Coudrier, Fayard, prix : 20 euros, 401 p., ISBN : 978-2-213-67761-3. Sortie : 28 août.