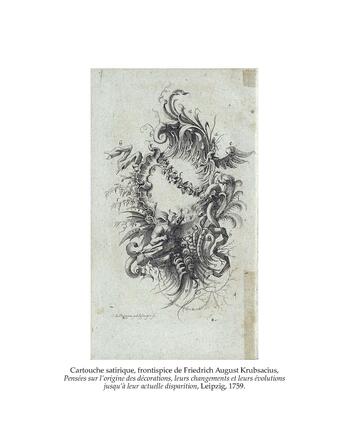Le regard et l’écrit rassemble cinq essais récents du célèbre sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, dans sa manière la plus personnelle. Deux textes consacrés à des écrivains : Anthony Powell, dont le jeune Naipaul, débarqué à Londres en 1950 de son Trinidad-et-Tobago natal « pauvre, emprunté » et doutant fort de sa vocation, devint l’ami, et le demeura jusqu’à la fin de la vie de l’auteur, alors illustre, de La ronde de la musique du temps, sans avoir d’ailleurs, confie-t-il, vraiment lu ses livres ; et Flaubert, celui de Salammbô, qu’il considère un peu comme son maître à écrire, et dont il analyse le rapport à ses sources. L’historien grec Polybe, notamment.
Mais la partie la plus importante du livre, dans les deux sens du terme, concerne à nouveau l’Inde, terre d’origine de la famille Naipaul : des Indiens pauvres de l’Uttar Pradesh s’étant engagés par contrat, à la fin du XIXe siècle, à venir travailler dans les plantations de Trinidad-et-Tobago, îles anglaises des Caraïbes, comme tant d’autres de leurs compatriotes le firent à Maurice ou à La Réunion. Des espèces d’esclaves légaux, libres mais misérables. Contrairement aux îles de l’océan Indien, assez proches de la mère patrie, l’univers caribéen en est éloigné, géographiquement et culturellement, et plus métissé. Si les anciennes générations, comme la grand-mère de l’écrivain, demeuraient indiennes et hindoues, chez les nouvelles, une certaine distance s’est installée. « L’Inde continuait de vivre en nous, même quand nous commençâmes d’en oublier la langue », écrit Naipaul, perdant son hindi. C’est ce rapport, paradoxal dès les origines, qui constitue l’une des constantes de son inspiration et l’un des ressorts majeurs de son œuvre.
Même si, devenu anglais dans les années 1950 puis anobli par la reine et nobélisé en 2001, sir Vidia n’a pas renié son héritage caribéen - exprimant son admiration pour Derek Walcott, dont il a découvert la poésie dès 1955, quarante-sept ans avant sa consécration par le Nobel, lui aussi, ou animant ensuite, à la BBC, l’émission Caribbean Voices -, l’Inde, d’abord fantasmée puis sillonnée pour de vrai, l’a beaucoup inspiré. Il revient volontiers sur son premier voyage « initiatique » de 1962. Il avait alors 30 ans, et découvrait un monde, un peu comme Gandhi à son retour d’Afrique du Sud. A l’égard du Mahatma, Naipaul nourrit des sentiments ambivalents. Le mystique ascète ne l’intéresse guère. Le politique, plus, celui qui rayonne, en 1925, au congrès du parti du Congrès, à Kanpur, déterminant pour la suite du mouvement vers l’indépendance du Raj. Congrès qu’a raconté aussi un certain Aldous Huxley, lequel y assista.
Naipaul ne se contente pas d’écrire sur le passé récent de l’Inde, il traite aussi du pays d’aujourd’hui, auquel il ne comprend pas grand-chose, et sur lequel il risque des formules génériques à l’emporte-pièce, comme : «L’Inde n’a pas de vie intellectuelle autonome» ou «L’Inde est dure et matérialiste». On comprend pourquoi l’intelligentsia indienne ne l’aime pas et s’indigne que certains critiques s’obstinent à le considérer comme l’un des siens. Sir Vidia est so british.
J.-C. P.
Grasset reprend aussi, dans « Les cahiers rouges », Jusqu’au bout de la foi, un volumineux essai sur l’islam et les religions, paru chez Plon en 1998.