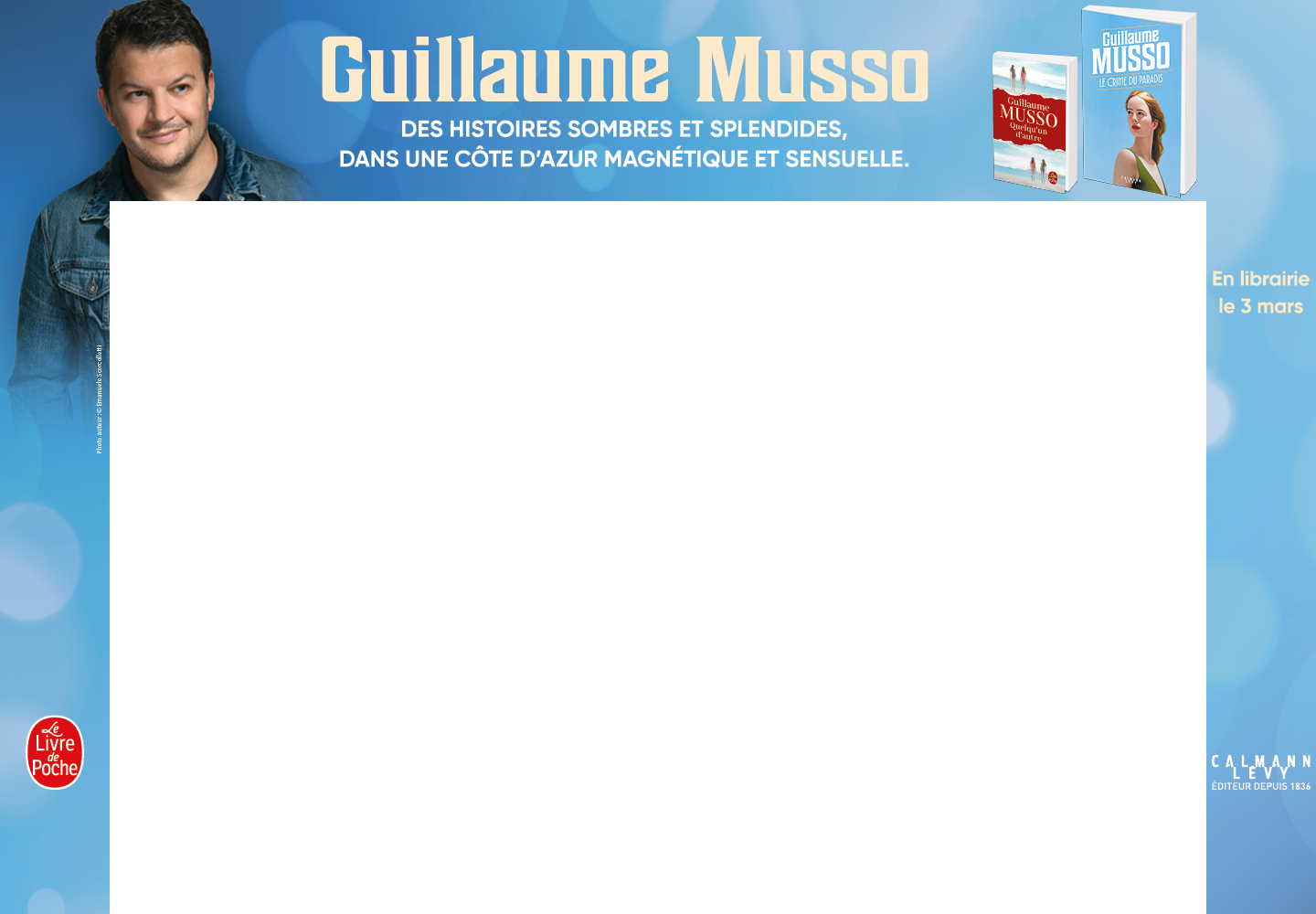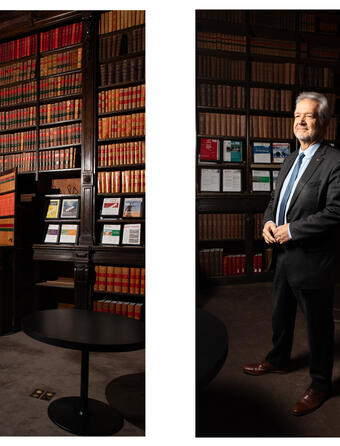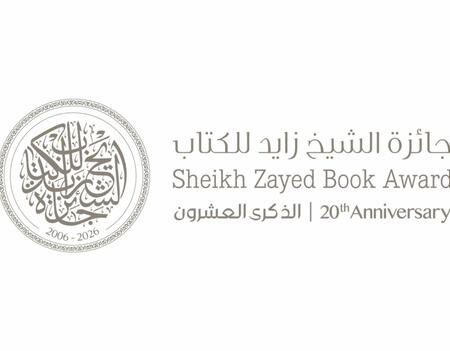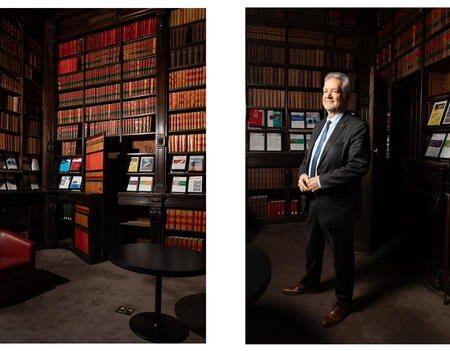Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
A peine élu au trône de saint Pierre, Paul III, dans un bref daté du 28 novembre 1534, édicte les premières mesures pour la protection des monuments. Des monuments de l'Antiquité, s'entend, les seuls vestiges du passé qui méritassent d'être conservés. Aux yeux des hommes de la Renaissance italienne, les canons du beau avaient été fixés une fois pour toutes par les Grecs et les Romains, et ces mêmes Italiens, par qui renaissait l'âge d'or esthétique, en étaient les seuls dignes héritiers. Le Moyen Age était entaché du stigmate des invasions barbares, les monuments autres qu'« antiques », dédiés à la mémoire de faits qu'on ne célébrait plus, étaient voués à la destruction... Passé la justification d'ordre sacré, politique ou sociale, nulle obligation de conservation. A la Renaissance, on ne concevait pas que pussent exister, selon la formule d'Aloïs Riegl, des « monuments non intentionnels », à savoir des monuments dont « la valeur historique et artistique » transcende l'intention pour laquelle ils furent érigés. L'historien d'art autrichien (1858-1905) replace le statut du monument dans une vision moderne de l'art. Une histoire de l'art évolutive et non plus hiérarchisée avec des périodes d'apogée et de décadence. L'auteur du Culte moderne des monuments rappelle que si la valeur artistique d'un édifice ancien est relative à l'histoire, il peut encore « parler » aux hommes du présent grâce à sa « valeur de contemporanéité ». Le monument résonne avec le Kunstwollen moderne, le « vouloir artistique » contemporain, espèce d'élan créatif défiant les lois de la déchéance et de la mort.