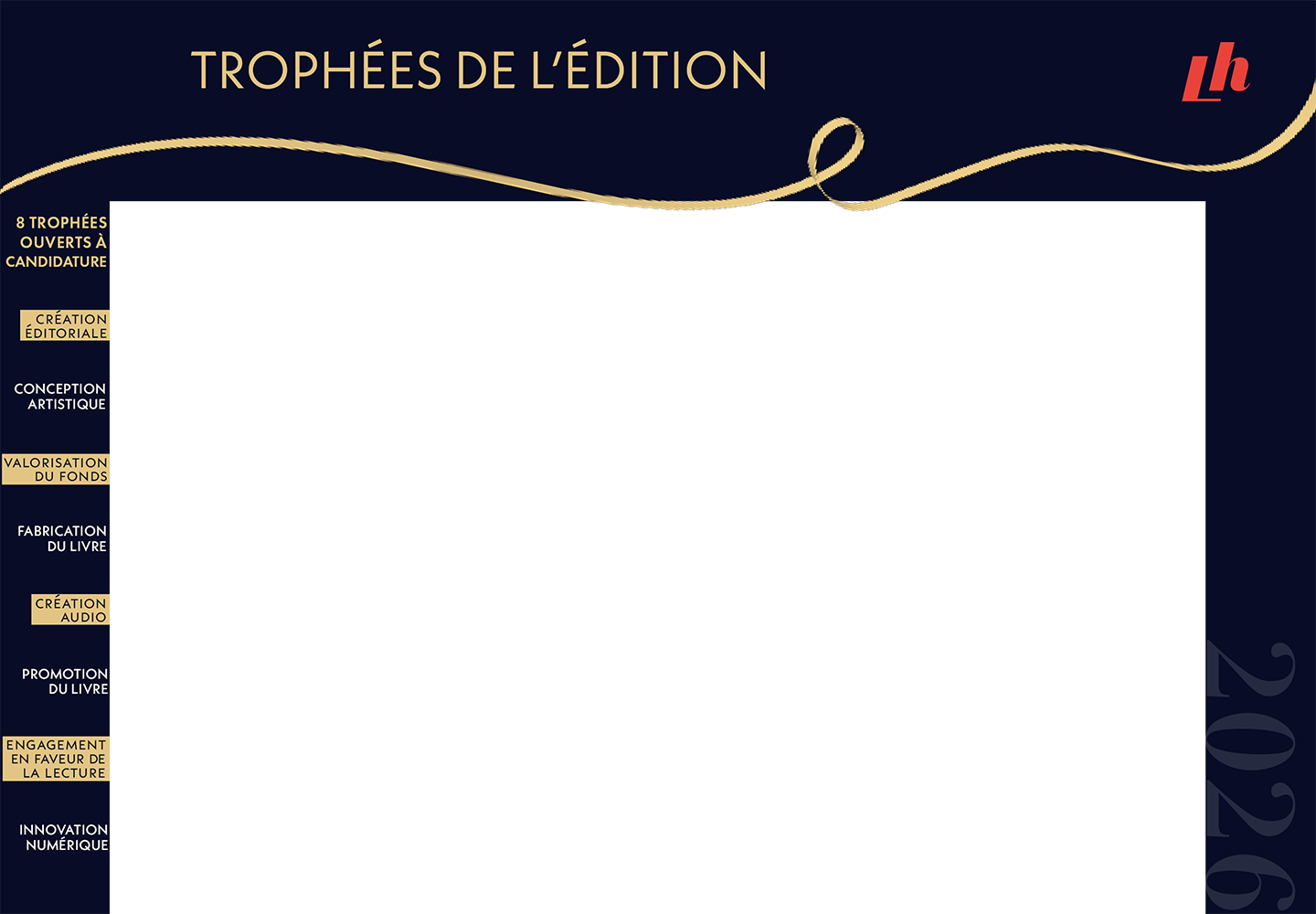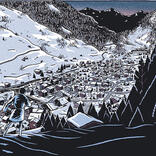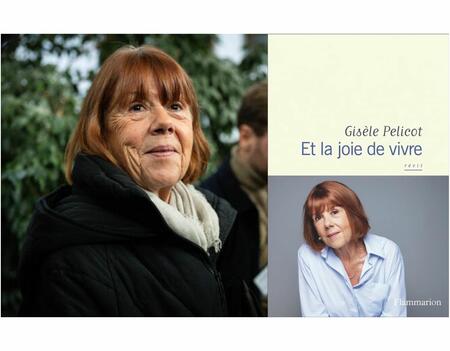Les questions abordées dans cet essai sont au cœur même de la littérature, de la création littéraire. Elles nous renvoient aussi à l’actualité au travers des récurrentes affaires de plagiat. Il s’agit de l’imitation. Maxime Decout (université Lille-3 Charles-de-Gaulle) ne traite pas uniquement de l’imitation, mais de la peur qu’elle engendre chez les écrivains. Cette angoisse mimétique est au centre de la démarche littéraire qui voudrait n’obéir qu’à la seule injonction de l’originalité. Mais comment créer sans se nourrir de ses lectures ? Dire n’est-il pas redire ? Auteur d’un précédent essai sur la mauvaise foi dans les lettres (Minuit, 2015), Maxime Decout évoque avec justesse "le problème du degré de conscience de la littérature devant ce qu’elle est souvent (une pratique mimétique) et devant ce qu’elle voudrait être (une originalité sans précédent)".
Devant le fait qu’il ne peut être toujours en "Rimbaldie", le pays du génie, de la "nouveauté sans exemple", l’auteur compose. Flaubert, Stendhal, Proust, Malcom Lowry, Sartre, Aragon, Valéry, Perec et tant d’autres ont écrit à l’ombre des autres. Lautréamont lui-même, météore de la singularité, a mis ses pas dans les traces d’autrui pour mieux les piétiner.
Avec une belle énergie et le sens de la formule, Maxime Decout reprend le dossier à son origine, en se focalisant sur le domaine français. Il explique que la peur de réécrire les autres, de plagier malgré soi, est assez récente. De la Renaissance au XVIIe siècle, on imitait sans vergogne. Montaigne ne s’en cachait guère tout en affirmant son style. "Qu’on voie, en ce que j’emprunte, si j’ai su choisir de quoi rehausser mon propos." Avec les Lumières, la Révolution et l’apparition du droit d’auteur, les choses ont changé. Le mimétisme littéraire fit craindre pour l’originalité. Proust aborda le problème en commençant par le pastiche, en traitant le mal par le mal, avant de tracer sa route. D’autres choisirent des écritures blanches comme Camus ou Modiano. Maxime Decout donne de nombreux exemples de cette crainte dans ce "voyage où les mots ne sont plus à personne, où les plumes s’échangent, se prêtent, où on les accapare et se les approprie".
Cette peur de réécrire les autres ne justifie en aucun cas le plagiat. "Car l’imitation, contrairement au plagiat, n’est pas un cas de conscience. Elle est un phénomène de la conscience." Tout écrivain se nourrit de ses lectures, de même que tout musicien entend ses prédécesseurs. La musique des mots flotte forcément dans son esprit lorsqu’il écrit. Mais c’est en imitant tout en se défiant de cette imitation que l’auteur offre ce qui lui est propre. L’imitation est un passager clandestin et tous les auteurs n’ont pas à son égard le même rapport, souligne Maxime Decout. Il distingue l’érudit, le pédant, le copiste, le faussaire ou le plagiaire. Mais celui qui prétend n’avoir jamais cédé "à l’alcool capiteux et affolant de l’imitation", à ruser avec elle, à se faire des frissons mimétiques pour naître soi-même au contact des autres, celui-là n’est pas écrivain. L. L.