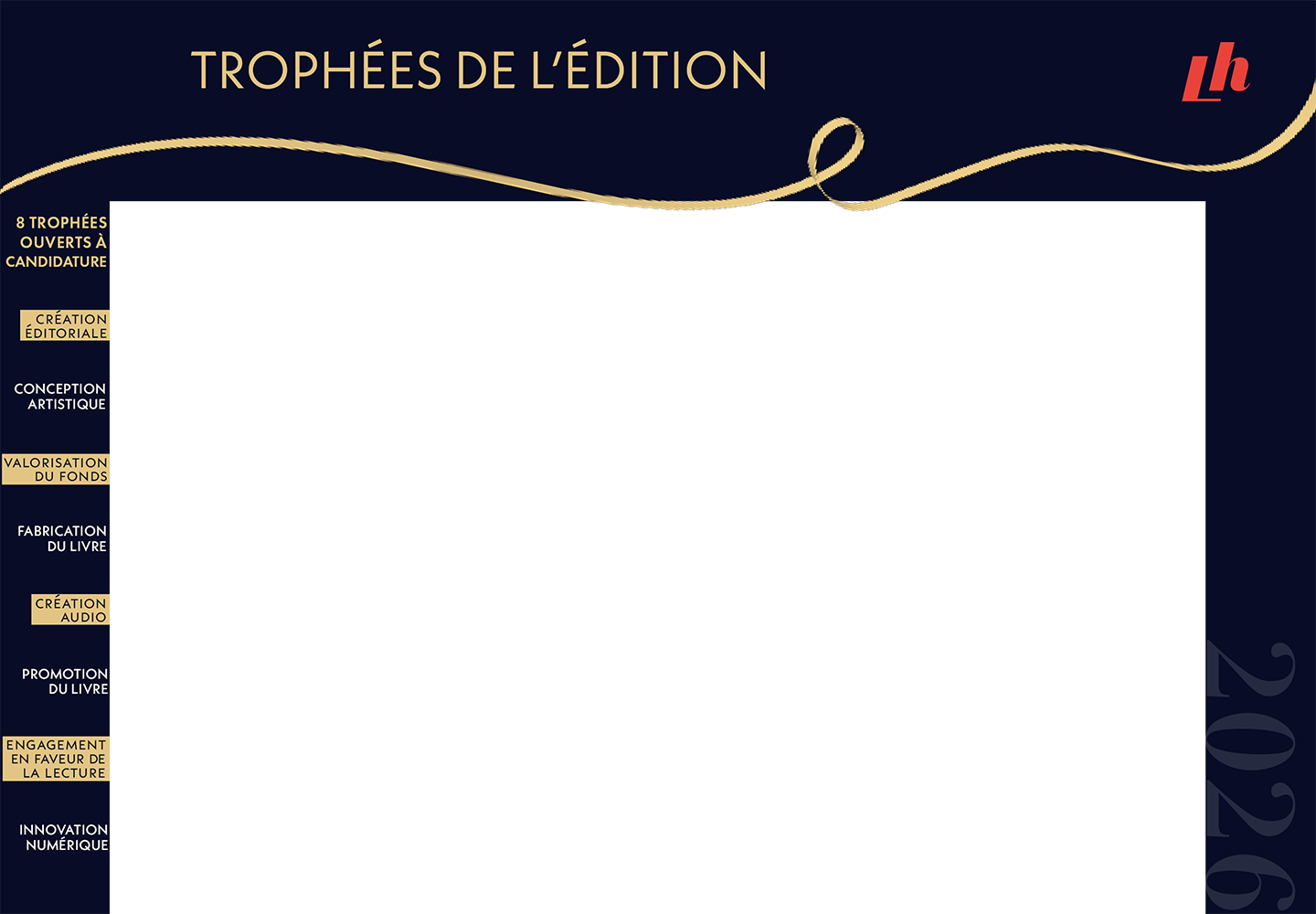En 1978, en plein état d’urgence imposé à l’Inde par Indira Gandhi, M. Mishra, un comptable bengali vivant à Delhi, décide d’émigrer vers les Etats-Unis. Depuis New York, il fait venir sa famille : sa femme Shuba, enseignante, et leurs deux fils, Birju, brillant sous tous rapports, et le petit Ajay. Ils s’installent dans le New Jersey, où ils vont subir brimades et racisme latent, même si la présence d’une communauté indienne permet de tenir. Le jeune garçon, lui, a tendance à se réfugier dans la lecture.
Mais un jour, un accident fait basculer le destin des Mishra. Birju chute dans une piscine, et demeurera infirme à jamais, menant une vie végétative. Tandis que le père, dévasté, se console dans l’alcool, Shuba fait face et soigne Birju à la maison, achetée avec les indemnités de l’assurance. Lesquelles ne sont pas inépuisables. Les Mishra, qui se déchirent dans l’intimité, connaissent à la fois la gêne et une certaine réussite sociale. Leurs compatriotes les entourent, Shuba étant devenue une sainte à qui l’on demande sa bénédiction. Effet redoublé lorsque Ajay, au terme d’une scolarité sérieuse, intègre Princeton University. Il finira riche banquier d’affaires, soutien de sa famille, et trouvera, sur le tard, le bonheur qui lui a été refusé durant son enfance fracassée. En fait, influencé par ses lectures, Hemingway surtout, il aurait voulu être écrivain, et il avait même écrit, adolescent, une nouvelle autobiographique.
Après Un père obéissant, son premier roman traduit en France (L’Olivier, 2002), Akhil Sharma explique avoir mis dix ans à accoucher de ce deuxième roman raconté à la première personne par Ajay, son double. Un gamin déboussolé mais travailleur et raisonnable, attachant parce qu’il ne tombe jamais dans le pathos et ne censure pas ses émotions. Pour Un père obéissant, Sharma avait reçu le prix Pen/Hemingway. Dans l’hindouisme, le hasard n’existe pas. On aimerait qu’il raconte son rapport à l’Inde, savoir s’il y est retourné et comment il a vécu cette expérience. J.-C. P.