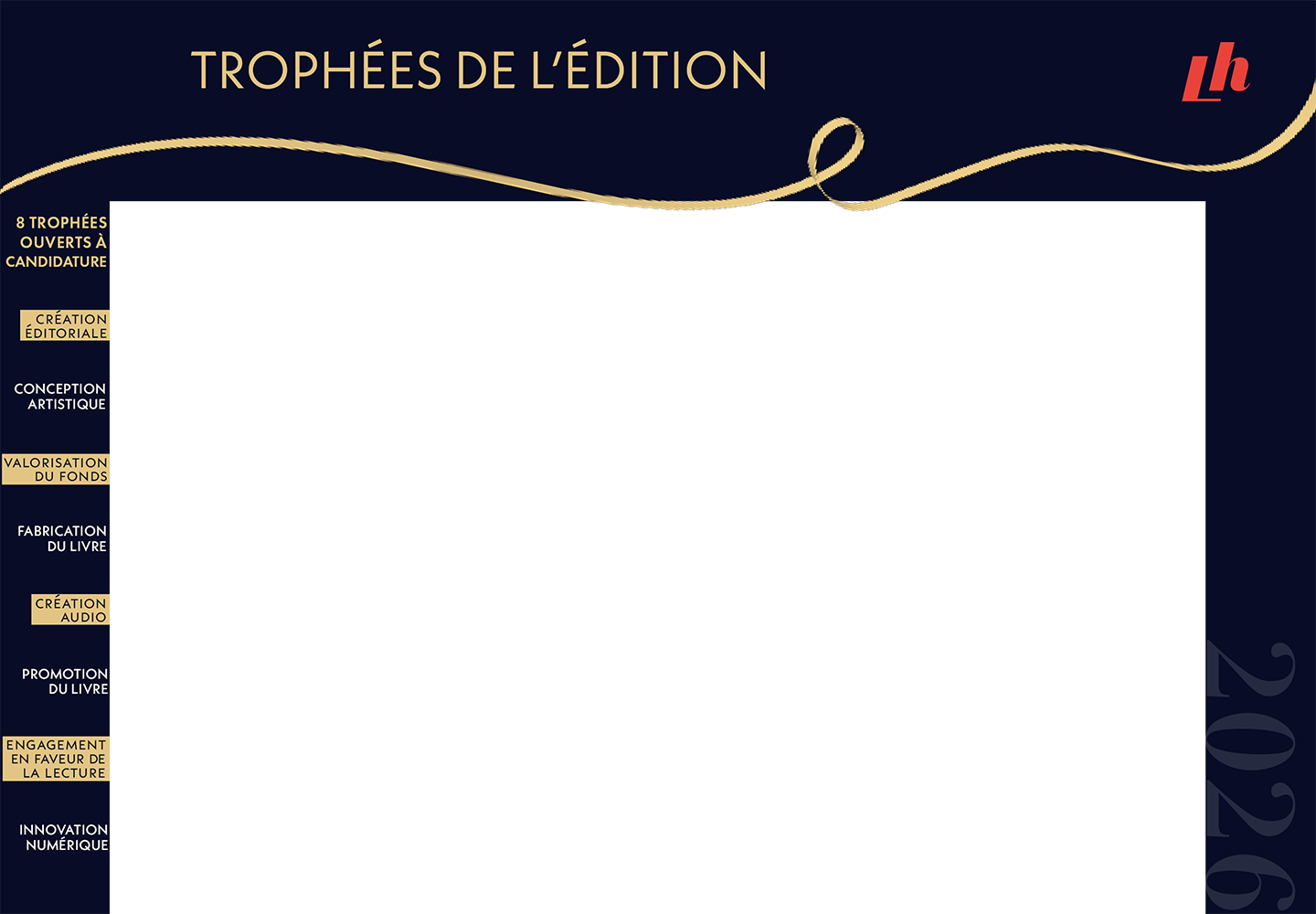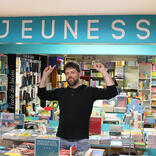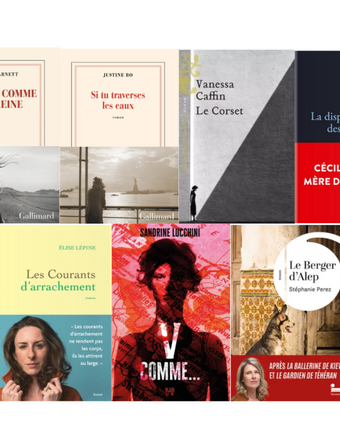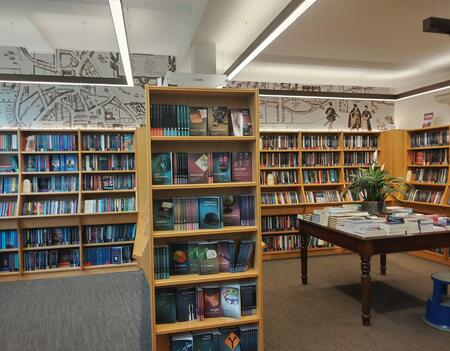Quand ils entendent le mot "intellectuels", certains sortent leur liste des meilleures ventes. Christophe Charle (université Paris-1) et Laurent Jeanpierre (université Paris-8) ne sont pas de ceux-là. La notoriété médiatique ne suffit pas à les convaincre. Pourtant, ils le savent bien, diriger une histoire de La vie intellectuelle en France des lendemains de la Révolution à nos jours comporte quelques écueils. A commencer par celui de se retrouver à étudier un sujet auquel on appartient.
Laurent Jeanpierre (à gauche) et Christophe Charle.- Photo E. MARCHADOURPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Christophe Charle balaie le reproche d’un revers d’argument. Les quelque cent trente contributeurs de cette somme ont cherché à cerner les différents aspects de la vie intellectuelle et non pas des intellectuels. "L’histoire de la vie intellectuelle ne se réduit pas à une histoire des intellectuels", souligne-t-il. C’est justement en dépersonnalisant cette histoire et en l’examinant sur la longue durée qu’apparaissent des lignes de force. En fait, on serait davantage dans une histoire de la création et de la circulation des idées, avec en arrière-plan ceux qui les ont incarnées.
Perspectives inattendues
"Ces quatre années de travail nous ont permis de réagir contre les idées reçues, explique Christophe Charle. La première est que la vie intellectuelle française n’existerait plus. En examinant cette histoire sur la longue durée, nous nous apercevons que ce thème du déclin apparaît déjà à la fin du XIXe siècle. Bien évidemment, la vie intellectuelle française est passée et passera encore par des crises. Ce qui peut donner ce sentiment aujourd’hui provient en partie de la concentration de la presse avec quatre ou cinq titres dominants qui ne rendent pas compte de la diversité de ce qui se passe vraiment."
Pour montrer la véritable richesse de cette vie intellectuelle et pour conjurer la prétendue malédiction qui frapperait ce petit monde se regardant beaucoup et tournant volontiers sur lui-même, les deux responsables éditoriaux ont fait appel à des chercheurs d’âge différent et de disciplines diverses. Cela évite de trop coller au motif et ouvre des perspectives inattendues.
Polémiques mémorables
"Le contemporain, on ne le voit qu’après. Prenez le surréalisme. A l’époque, c’était un groupe marginal et personne ne l’avait perçu comme un mouvement capital du XXe siècle. C’est pour cela que nous sommes allés voir, surtout pour la période actuelle, la manière dont les idées s’élaborent, dans les laboratoires, les cercles peu connus ou les institutions, détaille Christophe Charle. Nous montrons aussi l’importance de l’édition dans la circulation des idées, avec les traducteurs et les vulgarisateurs qui sont des passeurs essentiels. On ne peut pas réduire la vie intellectuelle à ce qui est médiatisé. Les grands auteurs ne font pas tout. Les anonymes ont aussi leur importance dans la vie intellectuelle en France comme ailleurs."
Les deux volumes de La vie intellectuelle en France abordent évidemment les grands thèmes, mais de nombreux encadrés donnent des pistes nouvelles et des éclairages pour nuancer, corriger ou compléter les grands articles. En rappelant les polémiques mémorables ou les crises révélatrices, ils signalent les interactions entre la vie intellectuelle et la société, avec cette séparation entre les élites et la société. "C’est ce qui provoque cette méfiance, estime le codirecteur de l’ouvrage. Elle est la conséquence de la centralisation. Les institutions sont à Paris, tout comme les médias. Cette concentration des lieux de pouvoir et des intellectuels entraîne fatalement un effet de cour. C’est aussi comme cela que s’établit une séparation avec le reste de la France et le reste du monde."
Ce sentiment de désarroi s’est accentué avec le recul du français dans le monde. "Dans les sciences de la nature, on a très vite compris qu’il fallait passer le pas et utiliser l’anglais pour faire connaître ses travaux. En sciences humaines, c’est plus difficile car la langue est aussi l’instrument de travail, observe Christophe Charle. Cela produit un sentiment d’aliénation face à l’anglais et l’impression d’être en infériorité."
Illusoire rappel à l’ordre
Pas plus qu’à une "défaite de la pensée" ou à une "fin des intellectuels" les auteurs ne croient en un "rappel à l’ordre" qui se caractériserait par une droitisation des idées. "Cela participe au même schéma que celui de la décadence ou du crépuscule d’un monde perdu qui ne peut être restauré que sous la forme d’une radicalité, dit Christophe Charle. Il n’y a jamais eu de véritable retour à l’ordre intellectuel, culturel ou politique ancien, pas plus en 1815 qu’en 1851, pas plus en 1918 qu’en 1986, pas plus en 2002 qu’en 2007 ou en 2015, et ce malgré la dramatisation immédiate de toutes ces dates politiques dans leurs commentaires à chaud par quelques intellectuels médiatiques et journalistes autorisés."
Les grandes ruptures - chute de Napoléon, Première Guerre mondiale ou fin de la guerre d’Algérie - sont essentielles, mais elles ne suffisent pas à expliquer les mutations dans la vie des idées. Voilà pourquoi les contributeurs menés par Christophe Charle et Laurent Jeanpierre ont abordé cette aventure intellectuelle en se méfiant des passions et en prenant en compte les dimensions sociales, culturelles et symboliques de ces événements politiques. "Il faut savoir différencier ceux qui vivent l’histoire et ceux qui tentent de l’étudier", souligne le premier. C’est d’ailleurs en dépassionnant les débats que ces deux volumes examinent sereinement les relations entre le monde des idées et celui des religions.
Sur le long terme, on voit clairement les frontières se déplacer, les savoirs s’atomiser et les débats étrangers avoir de plus en plus de répercussions sur la vie des idées en France. Contre l’illusion de l’éternel retour et de la panne des sens, cette chronique très française rend compte d’une histoire de deux siècles et des vicissitudes d’un milieu qui, malgré son accroissement, ne représente qu’à peine 3 % de la population active.
Christophe Charle et Laurent Jeanpierre (dir.),
La vie intellectuelle en France, Seuil, sortie : 15 septembre.
Vol. 1 : Des lendemains de la Révolution à 1914, 38 €, 660 p., ISBN 978-2-02-108138-1.
Vol. 2 : De 1914 à nos jours, 40 €, 910 p., ISBN 978-2-02-108143-5.