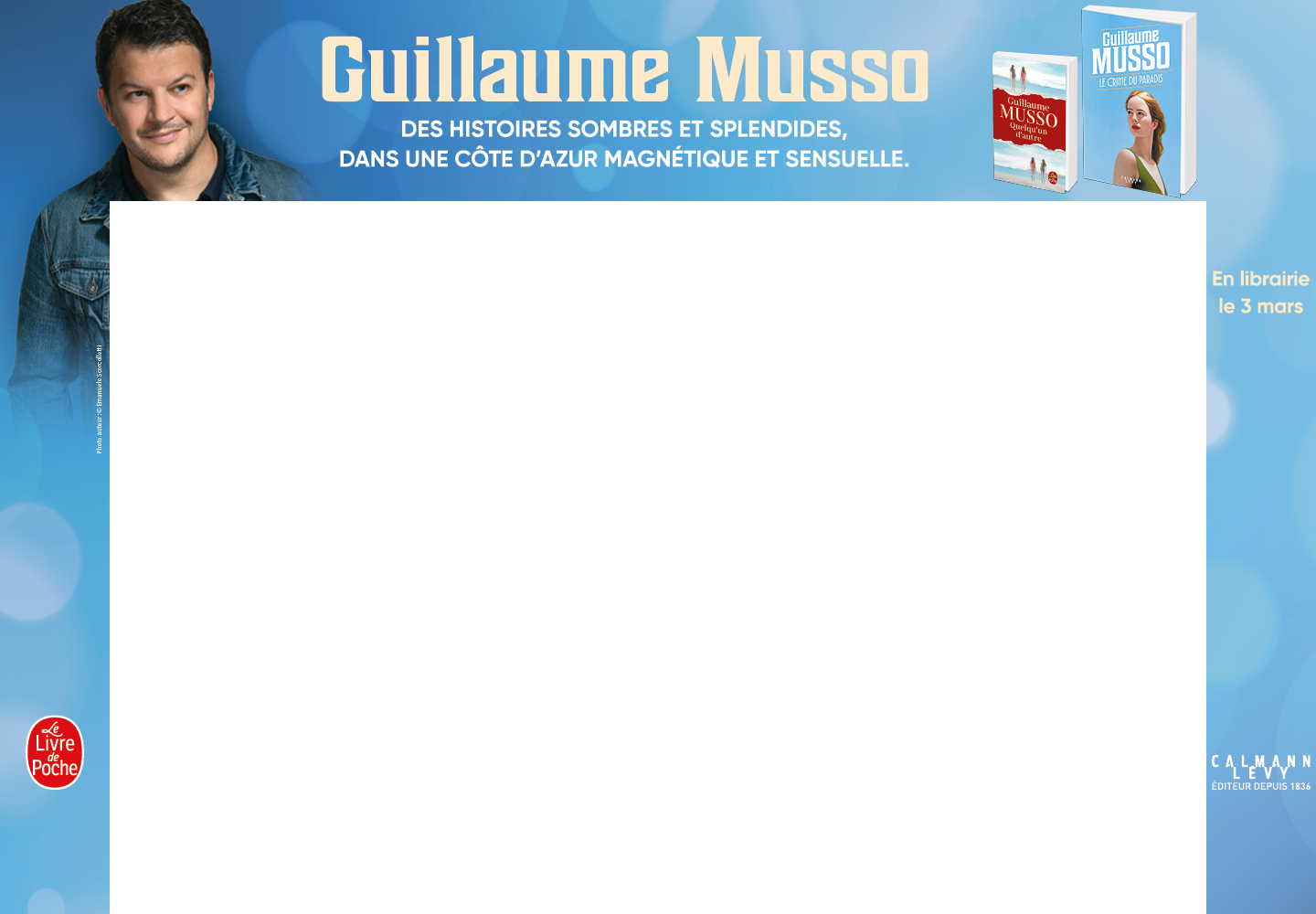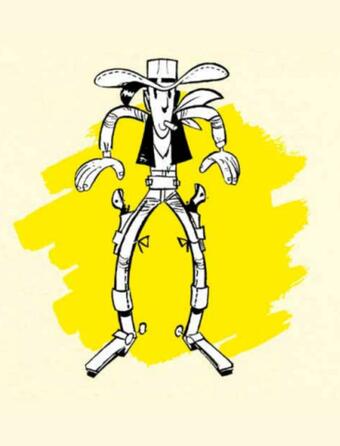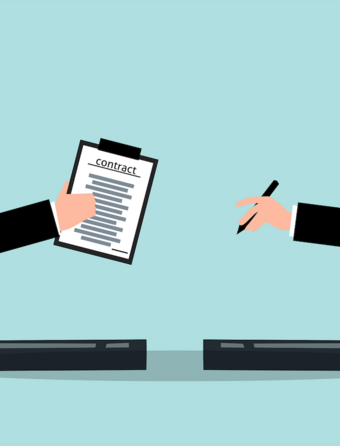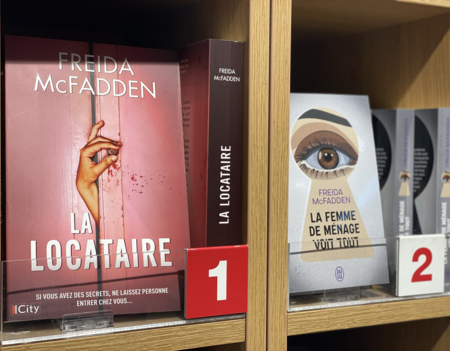Si l’on en croit une image d’Epinal née en grande partie des écrits de Vasari, Léonard de Vinci (1452-1519) aurait été un doux rêveur, peintre de femmes mystérieuses et de saintes éthérées dans leur sfumato, un écologiste avant la lettre, et même végétarien. Tout ceci n’est pas faux, mais pour le moins partiel. C’est gommer le côté protéiforme, polymorphe, du génie toscan, son esprit en mouvement perpétuel, son côté inventeur et bricoleur. On sait par exemple qu’à force de recherches formelles sur les couleurs de sa palette, ou la technique de la fresque, il a provoqué des dégâts irréparables sur certains de ses chefs-d’œuvre, voire leur autodestruction. Mais il est un autre domaine où Léonard exerça ses talents, et ce durant toute sa vie, au service de ses différents maîtres : l’art de la guerre dans toutes ses techniques, notamment la poliorcétique. Non seulement il ne s’en cachait pas - la Renaissance, époque « sadique » s’il en fut, perpétuellement en guerre, n’avait pas encore inventé le politiquement correct -, mais il en était même très fier. Bâtard sans fortune, il lui fallait bien gagner sa vie : il est mort très riche.
Dans son ouvrage minutieux et passionnant, l’historien Pascal Brioist reproduit un document extraordinaire, qui date de 1482 et se trouve dans l’Atlanticus, l’un des codices majeurs où sont conservés les manuscrits de Léonard de Vinci. Depuis Florence, le jeune homme avait eu l’occasion de voyager à Milan, la capitale des Sforza, admirant leur puissance et leur opulence. Aussi envoie-t-il au duc Ludovic, dit le More, son CV, une véritable lettre de candidature et de motivation aux fins de devenir son ingénieur. Il y vante ses talents en dix points très concrets : « construire des ponts très légers », investir une place forte, la bombarder, « détruire toute citadelle », fabriquer des chars, « des catapultes, mangonneaux […] et autres machines d’une admirable efficacité »… Et ce n’est qu’en dernier qu’il envisage, « en temps de paix », de « donner aussi entière satisfaction que quiconque » au prince, en tant qu’architecte, hydraulicien, voire sculpteur, et éventuellement peintre ! « Mon œuvre peut égaler celle de n’importe qui », conclut Léonard, qui, à 30 ans, n’avait pas encore la grosse tête. Naturellement, l’« Illustrissime Seigneur » Sforza l’a embauché, comme après lui César Borgia, rien que des tyrans belliqueux (pléonasme), ou encore François Ier.
Léonard a toujours aimé la France, il aurait même été en 1499 l’espion de Louis XII. Et il y est mort en 1519, au Clos Lucé. Comme nombre d’artistes, notre homme était mégalomane et attiré par le pouvoir : n’écrivit-il pas, en 1503, au sultan ottoman Bajazet, afin de lui proposer de jeter un pont sur la Corne d’Or, à Constantinople ? Léonard était un esprit très moderne, visionnaire et complexe, ainsi que l’a bien montré, dans son Introduction à la méthode de Léonard de Vinci - l’un de ses textes majeurs -, le subtil Paul Valéry qui aurait sans doute apprécié le livre de Pascal Brioist. J.-C. P.