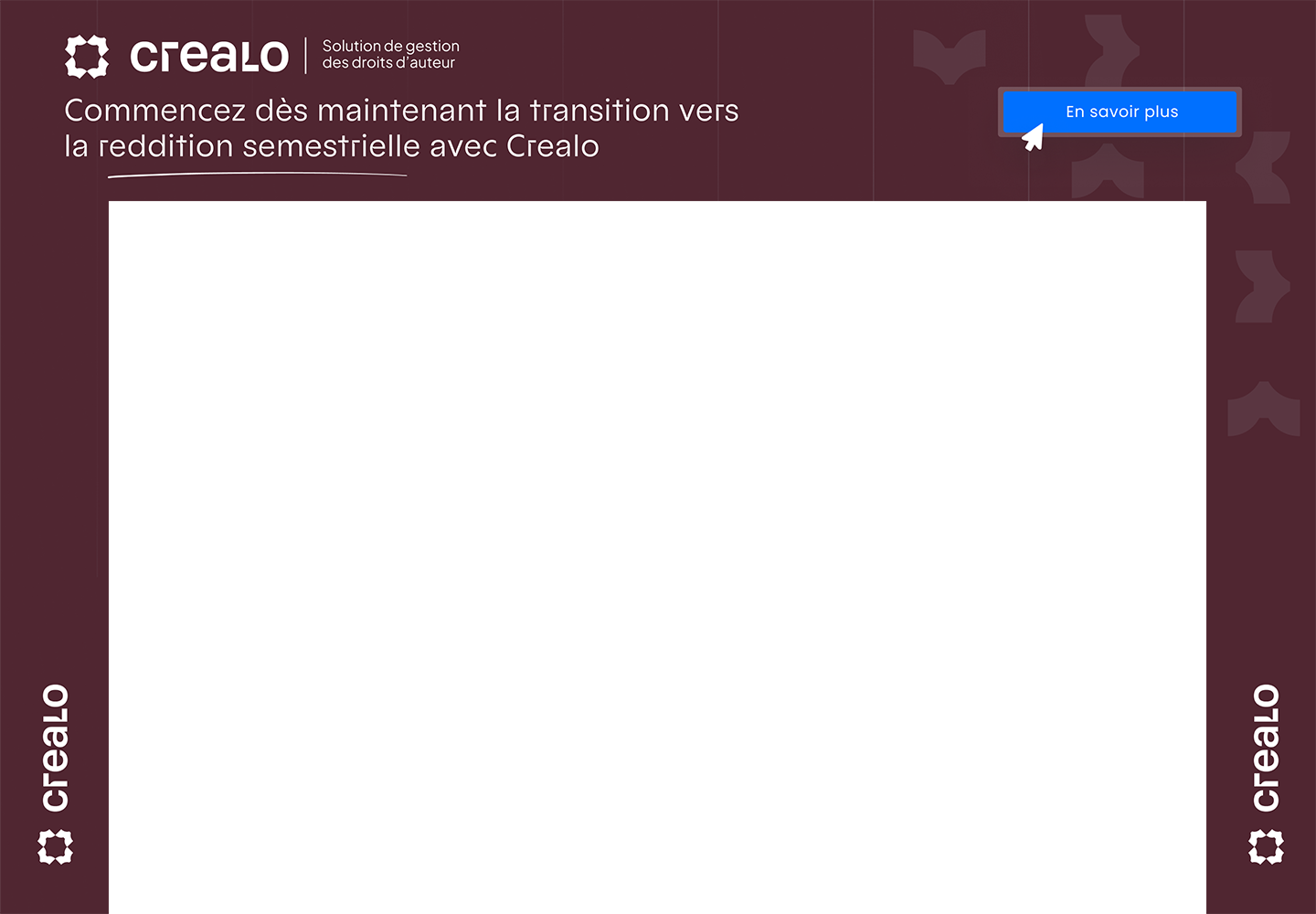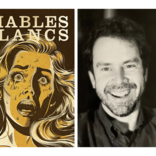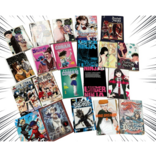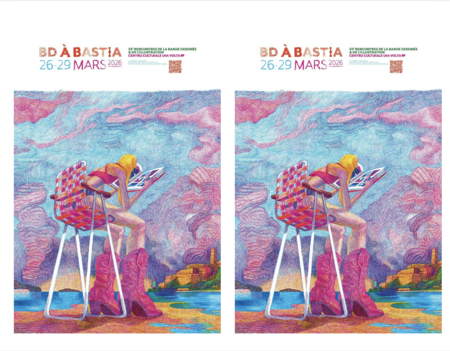Après deux traductions très remarquées de Magellan et de Marie-Antoinette de Stefan Zweig, Françoise Wuilmart continue, avec Marie Stuart, d’œuvrer à retrouver l’essence même du style de l’écrivain, souvent altérée par les versions précédentes. Les premières traductions, principalement réalisées par Alzir Hella dans les années 1930, ont eu le mérite d’introduire Zweig sur la scène francophone. Mais elles répondent à un « mot d’ordre traductif » très différent de celui qui est en vigueur de nos jours.
Hella, traducteur sans réelle formation, mais « quasi-officiel » de Zweig, s’autorise à rendre plus « neutres » les phrases qu’il juge trop « intenses », à couper les références historiques selon lui inutiles et les « métaphores qui fleurissent presque à chaque page ». Zweig lui-même lui laisse « carte blanche » pour ses coupes. Alors Hella gomme les phrases, les édulcore et finit par « acclimater » le texte à sa perception de la culture destinataire ou à son propre style.
Restituer la « saveur originelle » de Zweig
Françoise Wuilmart, au contraire, adopte une « optique benjaminienne » – c’est-à-dire inspirée de La Tâche du traducteur de Walter Benjamin. Elle s'engage à reproduire le style et le ton qui reflètent le ressenti de l’écrivain, à conserver ses métaphores prégnantes et même ses « redondances », qu'elle considère comme ses marques de fabrique. Son but est de restituer la « saveur originelle » du texte pour faire « sentir et ressentir » aux lecteurs le souffle et l’emportement de l’écrivain : cette « impression que, dans chacune de ses biographies, l’auteur était sur place, qu’il était là comme témoin en chair et en os, caméra au poing ».
C’est en effet la vive impression que procure la lecture de cette version de Marie Stuart, une biographie dans laquelle Zweig explore – comme s’il y était – la vie de l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire, de sa naissance à sa mort tragique. Devenue Reine d’Écosse en 1542, à seulement six jours, puis Reine de France à 17 ans par son mariage avec François II et exécutée – par décapitation à la hache – à 45 ans, Marie Stuart est une personnalité historique aux représentations contradictoires – tantôt meurtrière – accusée de complicité dans l’assassinat de son mari –, tantôt martyre, tantôt « stupide intrigante ou encore céleste sainte ».
Stefan Zweig s’efforce de devenir l’interprète « impartial », mais empathique de ce destin qui entremêle, nous prévient-il dès le départ « le faux et le vrai, le fictif et le réel ». Pour relever ce défi, il choisit deux années décisives de sa vie pendant lesquelles une « pression démesurée » l’oblige à « se dépasser, [à] s’élever au-dessus d’elle-même » jusqu’à se détruire. À 23 ans, veuve du roi François II de France, la Reine, jusque-là prise au sérieux comme politicienne, tombe follement amoureuse d’un jeune prince de 19 ans nommé Lord Darnley.
Regard psychanalytique
Zweig considère que c’est un point de bascule qui transforme la vie de Marie Stuart en tragédie. Et c’est en suivant cette pente vers les abysses que l’écrivain examine minutieusement les fameuses « lettres de la cassette », un ensemble de correspondances et de poèmes controversés, attribués à Marie Stuart, et qu’elle aurait écrits en partie au chevet de son deuxième mari mourant.
En prenant ces écrits au sérieux et en y portant un regard psychanalytique d’une finesse inouïe, Stefan Zweig, contemporain et admirateur de Freud, y voit la preuve d’une « furieuse détresse ». Écrites « avec maladresse », « par une main qui, on le perçoit, tremble d’agitation en écrivant », ces lettres témoignent, selon lui, d'un « état d'âme surexcité », une transe qui offre un accès unique au « moi intérieur » de la Reine.
Loin d’être une simple remise à jour linguistique, la nouvelle traduction de Françoise Wuilmart est une redécouverte de l’œuvre de Zweig, une expérience essentielle qui invite à mesurer l’ampleur d’un destin royal tout en se mettant à l’écoute de son âme, comme un être non pas figé dans l’histoire mais de chair, de sang et de cœur, dont la personnalité résonne avec force aujourd’hui.