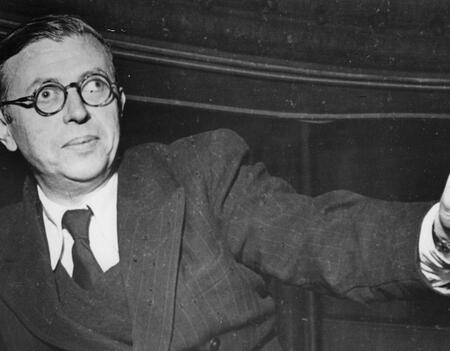Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pourquoi les femmes continuent-elles d'être sous-représentées dans certains métiers ? Pouquoi restent-elles minoritaires dans les postes à haut niveau de responsabilités, tandis que leurs salaires au sein d'une même profession demeurent inférieurs à ceux des hommes ? Ou, plus largement, "pourquoi le contrôle de ressources économiques considérables a été réparti de façon si inégale entre les sexes ?" s'interroge l'économiste Paul Seabright, qui s'attaque à ces questions avec audace, brassant biologie, anthropologie, psychologie et économie, revisitant darwinisme et théorie de l'évolution pour esquisser "L'économie de l'animal humain", titre d'une des interventions de ce professeur-chercheur qui travaille depuis une dizaine d'années au sein de l'Ecole d'économie à l'université de Toulouse.
Paul Seabright commence par faire un détour par la préhistoire et remonte au temps des chasseurs-cueilleurs, quand question sexuelle et organisation sociale étaient directement liées à la reproduction. Il convoque aussi mouches, bonobos et paons pour montrer, notamment, qu'au-delà des points communs l'espèce humaine se distingue par sa capacité à coopérer. Un mode de partenariat (impliquant par conséquent la négociation et le conflit) né de l'impératif, unique dans le règne animal, rappelle-t-il, d'assurer l'éducation des enfants pendant un temps très long. Ce qu'il appelle "l'investissement dans une niche évolutive centrée sur la progéniture".
La deuxième partie confronte ces données diverses au monde du travail contemporain. Si, dans l'économie moderne, l'inégalité persistante peut s'expliquer par l'héritage biologique lié à l'évolution, il n'y a pas pour autant, pose l'économiste, de fatalité naturelle qui justifierait que celle-ci soit immuable. Ainsi, montrant que structures et représentations, même héritées de la sélection naturelle, n'en sont pas moins aussi des affaires de choix éthiques et politiques, il interroge un certain nombre de pistes possibles - imposition légale de la parité (est-elle souhaitable ? dans quelles conditions ?), impact de l'institution d'un véritable congé de paternité... A toutes les étapes, il pointe les interprétations prêtant à controverse, les paradoxes, ainsi que la difficulté de tirer des conclusions fiables et définitives d'observations et d'études - celles par exemple permettant d'évaluer comparativement les "talents » des hommes et des femmes -, dont les instruments de mesures peuvent aussi être questionnés.
Ces sauts historiques et disciplinaires, ce ballet de variables, d'hypothèses et de spéculations donnent parfois un peu le tournis, mais dans cette traversée alerte et décloisonnée, pimentée d'une petite dose de provocation, on lit surtout une stimulante invitation, individuelle et collective, à faire preuve d'imagination, d'ingéniosité, de souplesse pour déjouer certaines logiques archaïques. Le plaisir de penser de nouvelles formes de coopération.