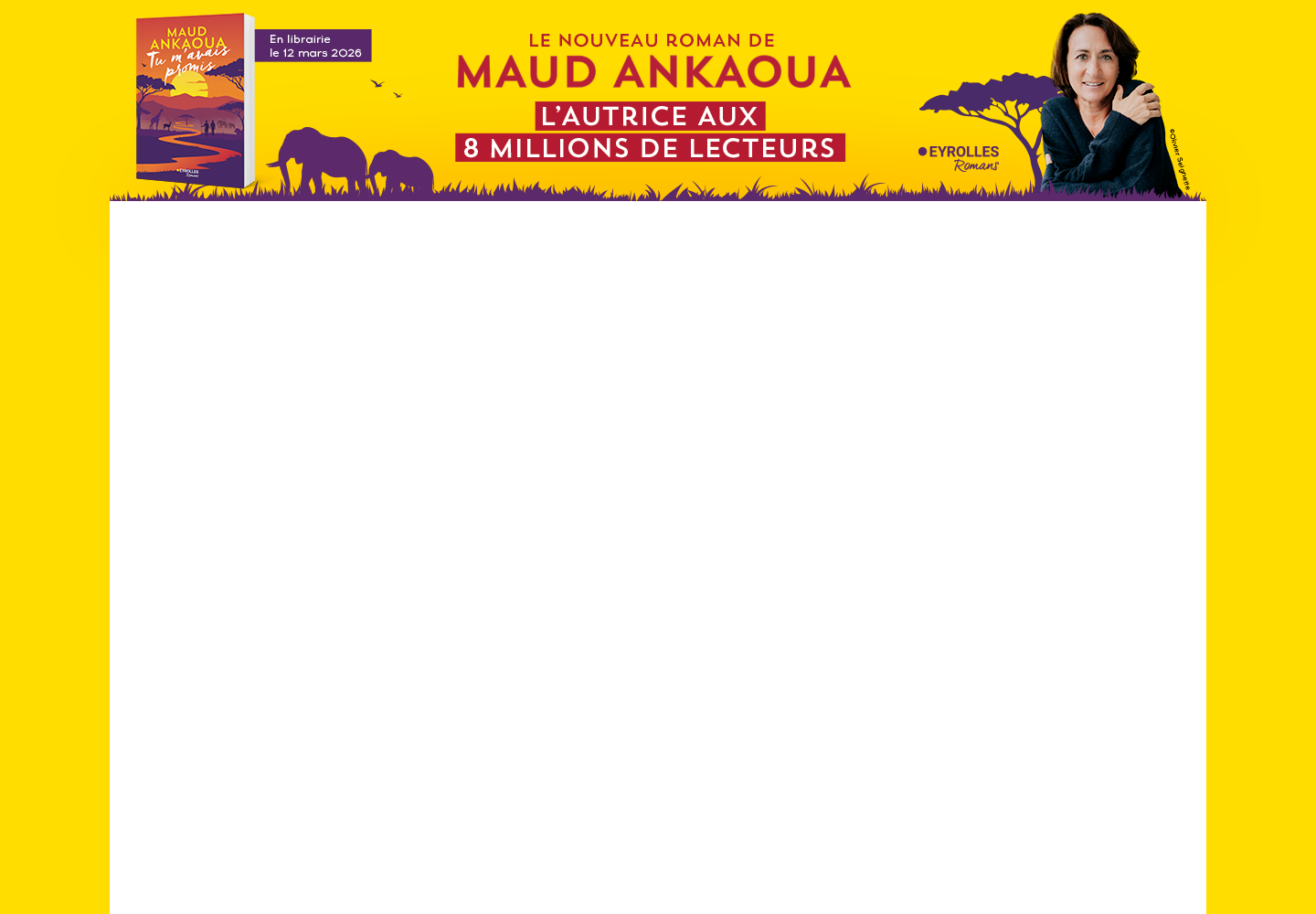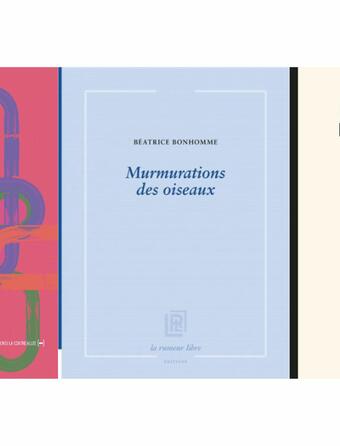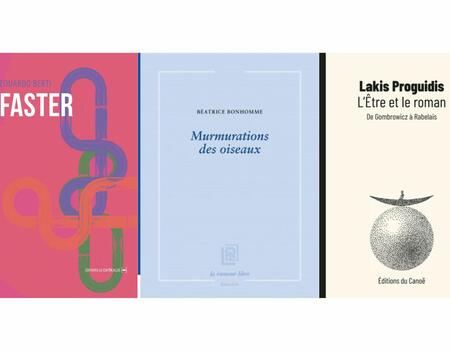Livres Hebdo : À suite de la chute mortelle de son épouse du haut de l’immeuble qu’il a construit, votre narrateur fuit son chagrin et les suspicions de meurtre qui l’entachent : il s’exile dans la Grèce de ses ancêtres. Plus de vingt ans après Rich girls (Victoire éditions, 2002), qui se passait à Patmos, pourquoi ce retour en fiction à vos propres racines grecques ?
Basile Panurgias : Chaque fois que je vais en Grèce, je me rends à l’Acropole. En 2023, je m’aperçois avec stupéfaction qu’on a cimenté le parvis du Parthénon. Cela m’avait scandalisé, mais je n’étais pas moins outré par le silence médiatique qui entourait la bétonisation de l’ancienne voie rocailleuse menant au temple. L’argument avancé par le gouvernement grec à l’époque était que, puisque le site était inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il devait être accessible aux handicapés. Sous couvert d’une intention louable, il s’agissait en fait d’attirer encore plus de touristes à l’Acropole… J’ai voulu à travers un roman parler de cette profanation d’un joyau archéologique à cause du surtourisme. Avoir des personnages grecs permettait de le faire d’une voix plus légitime. Et d’introduire dans le même temps une dynamique narrative entre différents points de vue : d’un côté, la vision du narrateur, Vassilis, l’esthète idéaliste ; de l’autre, celle de sa mère, typique femme grecque pragmatique, et aussi celle d’une Grecque d’une autre génération, dont fait partie Dido, la jeune archéologue dont s’éprend Vassilis.
En outre, Vassilis est architecte…
Le fait qu’il est architecte ajoute du drame à son parcours. Non seulement il ne peut plus exercer en France à cause des doutes qui ternissent sa réputation, quoiqu’il ait été innocenté, il doit laisser derrière lui ses projets, ses constructions. Quand on est un architecte qui s’expatrie, contrairement à un écrivain qui part avec son écriture, comme Nabokov dont l’œuvre littéraire l’accompagne dans son exil, on laisse derrière soi ses réalisations matérielles. C’est ironique que Vassilis hérite de la bicoque de sa mère dans les Anafiotika, un quartier populaire d’Athènes – une maison sans électricité, sans confort comme sur une île reculée dans les Cyclades. L’architecte parisien vit ici le déclassement.
« La passerelle du Parthénon incarne la société du spectacle dans une économie mondialisée »
Par le truchement de cette « délocalisation », ce départ pour Athènes, le héros vit également une sorte de dislocation personnelle – un démembrement de ses certitudes, dont le fragment d’antiquité qu’il acquiert dans un marché aux puces est le symbole.
Comme je l’ai dit, Vassilis, en tant que Grec expatrié ou fils de Grecs expatriés, est idéaliste et nourrit une image sublimée de la mère patrie, berceau de la démocratie : il défend la Grèce éternelle. Puis il voit bien que, malgré le bla-bla officiel sur l’accessibilité au patrimoine mondial de l’humanité, la passerelle du Parthénon incarne la société du spectacle dans une économie mondialisée. Récemment il a été le podium d’un défilé de mode de haute couture. Dido dont il tombe amoureux et qu’il souhaite séduire elle aussi est le visage d’une nouvelle Grèce, moins arc-boutée sur le récit national – elle-même est métisse éthiopienne. Vrai ou faux ? L’orteil provenant d’une statue censément antique va être pour Vassilis l’objet d’une enquête comme le moteur de sa conquête amoureuse. Il reflète également l’ambivalence des personnages, voire leur duplicité.
D’ailleurs, Dido représentante de cette jeunesse plus attirée vers l’extérieur a pour amant le voisin et rival de Vassilis, Alkis, le « beau gosse » gréco-américain…
Ce personnage de Dido que Vassilis, sûr de lui, avait cru conquérir sans difficultés monte en puissance au fil des pages et montre qu’elle n’est pas si malléable que ça et sait au contraire fort bien manipuler. Dans ce jeu de l’amour et du hasard, Dido tire les ficelles et porte malgré tout en elle des valeurs d’universalité et de cosmopolitisme très grecques.