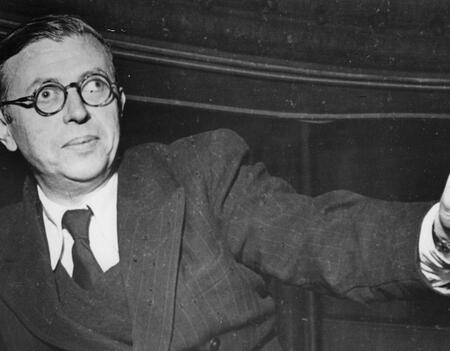Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
100 % en Suède, 75 % aux Etats-Unis, 71 % en Grande-Bretagne, 16 % en Allemagne, 4 % en France, très marginales en Espagne et aux Pays-Bas… la proportion des bibliothèques publiques qui prêtent des ebooks est très disparate dans le monde, et les relations bibliothécaires-éditeurs sont partout un casse-tête. C’est ce que confirme l’enquête réalisée par Idate pour le compte du ministère de la Culture dans sept pays, Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Suède (1). Il n’existe nulle part, à l’heure actuelle, de modèle économique stable. « Chaque pays a son histoire et sa problématique, a commenté Gilles Fontaine, directeur adjoint de l’Idate, lors d’une présentation le 22 mars au Salon du livre, mais certains cas sont plus instructifs que d’autres. » Et de citer la Suède où la totalité des éditeurs avaient accepté dès 2001 le prêt de leurs livres en bibliothèque avec un modèle de rémunération par la bibliothèque à chaque téléchargement. Problème : la pratique a eu un tel succès que les budgets des bibliothécaires ont explosé et que les éditeurs font machine arrière, constatant la concurrence (90 % des achats réalisés par les bibliothèques) et craignant le piratage : certains optent pour un délai de trois mois à un an avant de céder leurs titres, d’autres ont carrément cessé de les fournir.
Autre exemple significatif : celui de l’Amérique du Nord. C’est de loin le marché le plus avancé, grâce notamment à la plateforme pionnière Overdrive et au développement du parc des liseuses par Amazon depuis trois ans. Mais c’est aussi là que la situation est la plus tendue : le monopole d’Overdrive, qui pourrait bientôt être battu en brèche par des acteurs tels que 3M, a été remis en question à la suite de l’accord ambigu conclu par la plateforme avec Amazon, à la fois acteur majeur de la vente de livres imprimés et numériques et développeur du terminal propriétaire Kindle.
Pour les auteurs de l’étude, il serait utile que les bibliothécaires affinent leurs stratégies d’acquisition pour faire avancer les négociations et choisissent entre trois modèles : un modèle de réplication (acquisition systématique du papier et du numérique), un modèle de substitution (certains ouvrages du fonds ne sont plus disponibles qu’en numérique) ou un modèle d’extension (le numérique permet avant tout d’étendre les collections via des versions uniquement numériques).
Laurence Santantonios
(1) Le rapport final de l’étude est en ligne sur le site du ministère de la Culture.