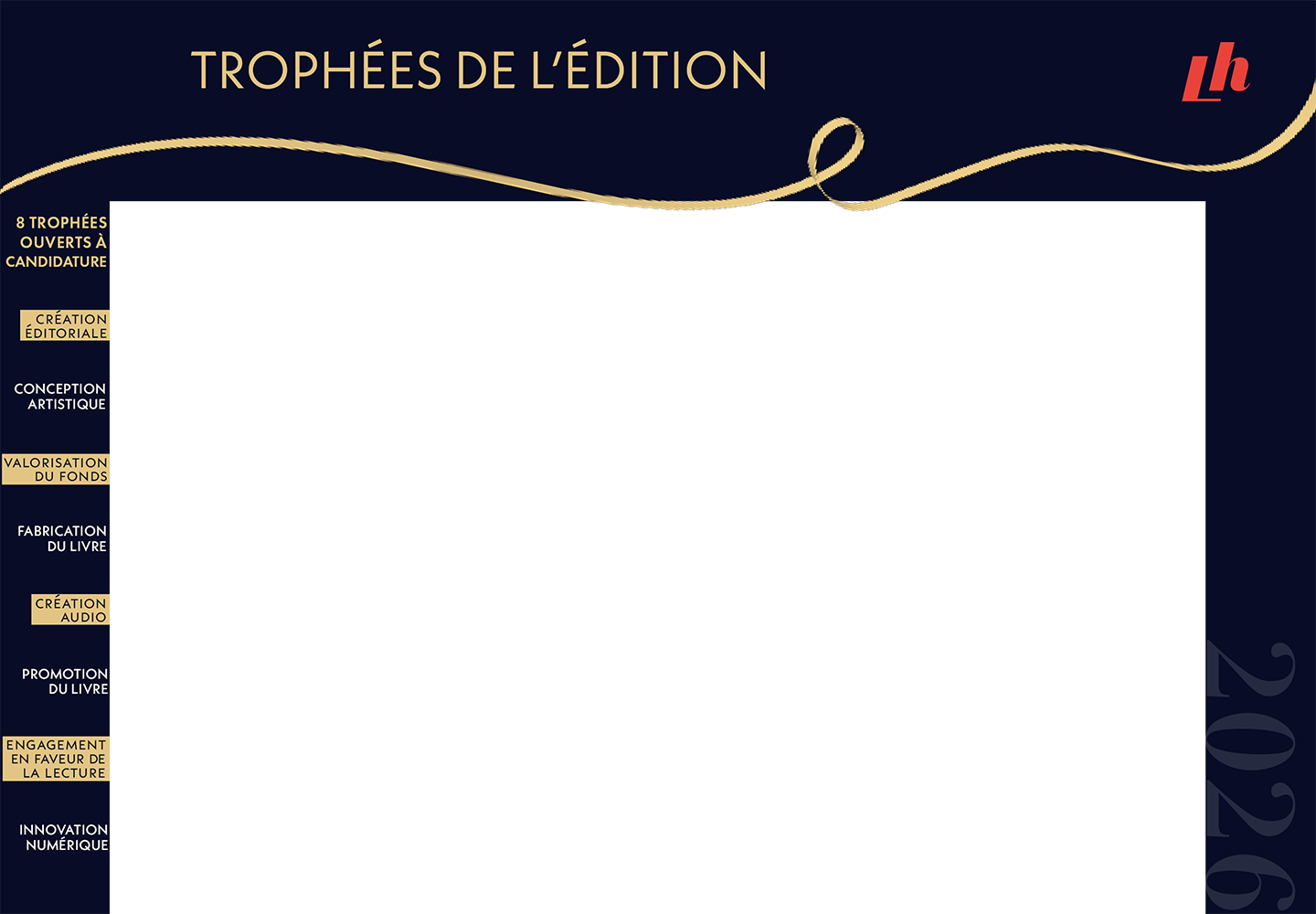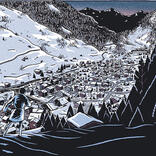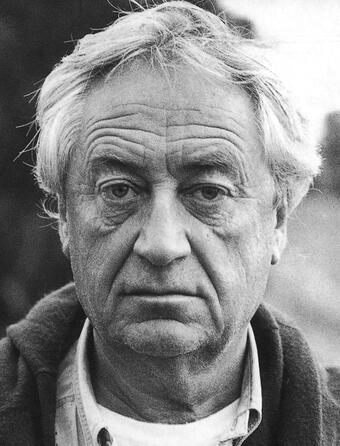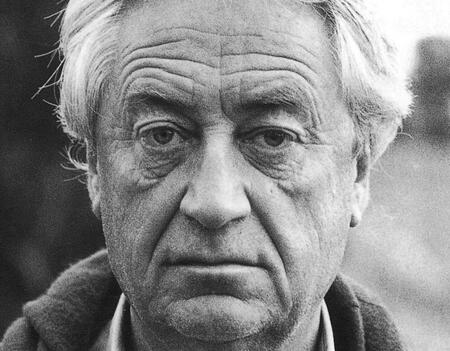Ce n’est pas encore un domaine très étudié par l’université. L’injure ou l’insulte sont cantonnées dans la périphérie de la linguistique, dans la zone moche de la lexicographie. Quant aux philosophes, ils ne s’intéressent guère aux crachats. Julienne Flory fait donc preuve d’audace en déblayant un terrain en jachère où poussent les mauvaises herbes du langage. Il y a bien eu le Traité d’injurologie et le Dictionnaire des injures (10/18, 2004) de Robert Edouard, précurseur dans la discipline, mais la jeune philosophe fait ici appel à Bourdieu et à quelques autres pour saisir l’insulte dans ses variétés comportementales et sociologiques.
Si l’injure est une manière de refuser les codes d’un langage normé et dominant, elle est aussi souvent l’expression de la haine, de la misogynie, de l’homophobie ou du racisme. Des murs de Pompéi à Internet, on constate la permanence de règles dans l’insulte. Julienne Flory s’attache à les décrypter. Elle explique leurs origines et leurs manières de faire appel à la famille, au corps, à la sexualité et à la soumission que l’"injurieur" intime à l’"injurié".
Même s’il s’agit de marquer une rupture avec les usages, le plus souvent l’injure n’a rien de commun avec la révolution. Elle est de plus en plus la manifestation d’un dépit, d’un dégoût ou d’un mépris. On s’éloigne ainsi de cette branche discréditée de l’éloquence dont on mesure la richesse dans le Traité des injures publié au XVIIIe siècle et qui laissait penser qu’il s’agissait d’un art. Le champ lexical s’est resserré sur quelques formules ordinaires. Chacun y a recours pour évacuer quelque chose. En cela, l’étude de Julienne Flory, pleine d’esprit et de sérieux, nous aide à réfléchir sur la persistance de cette violence verbale. Laurent Lemire