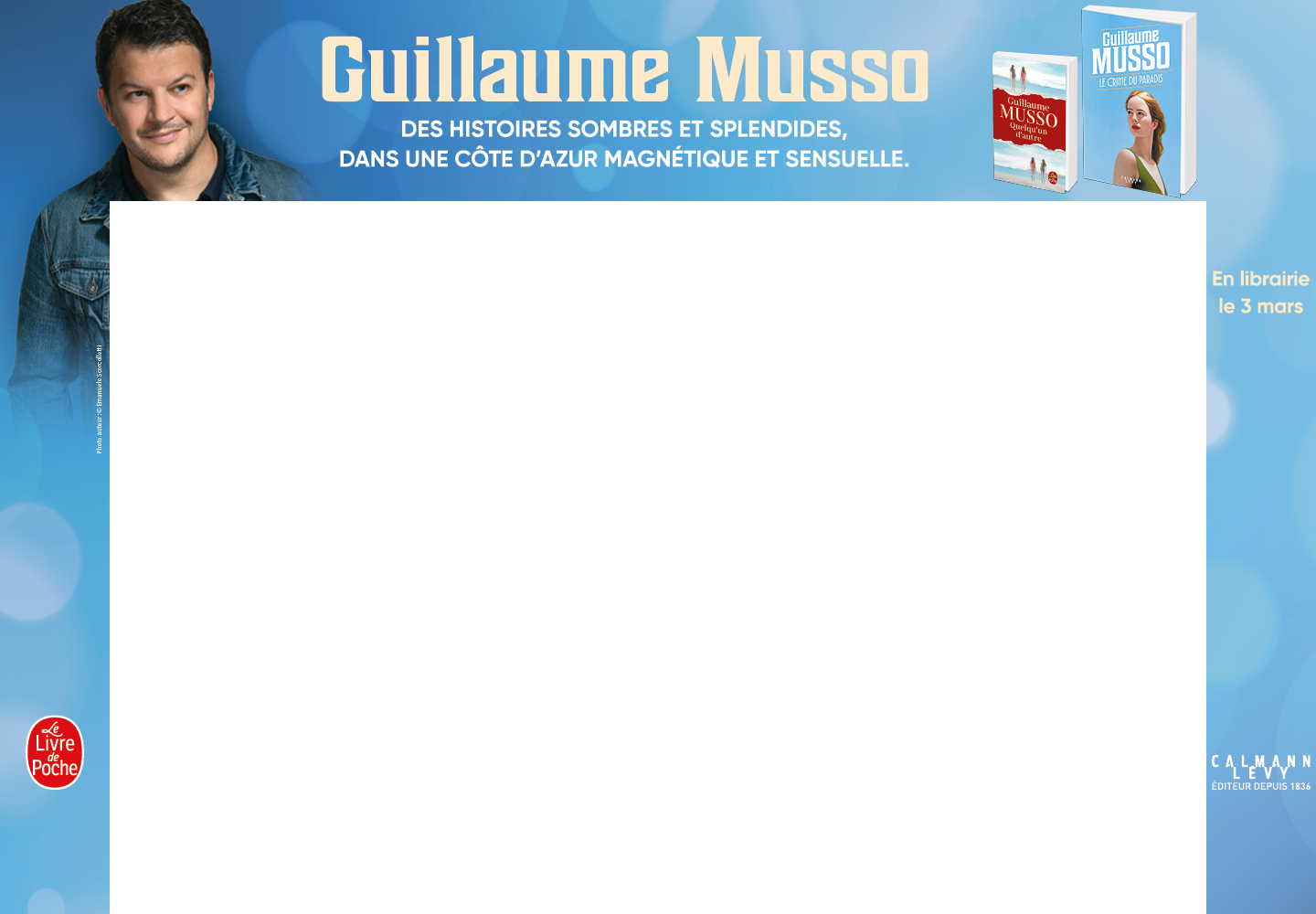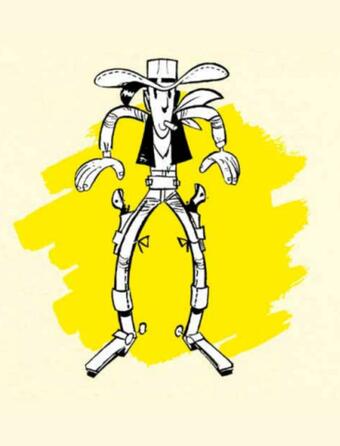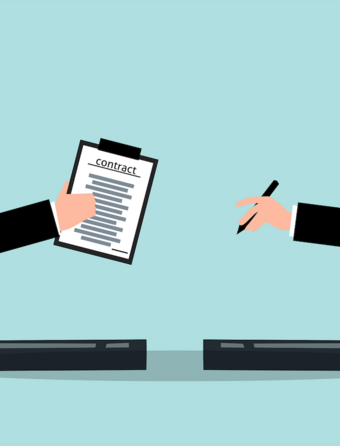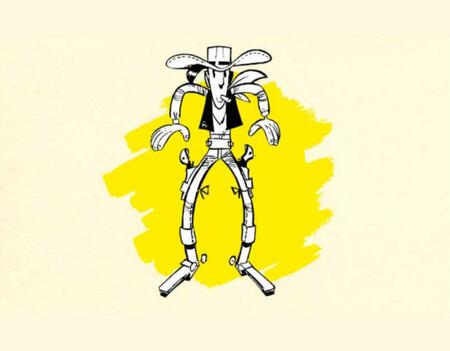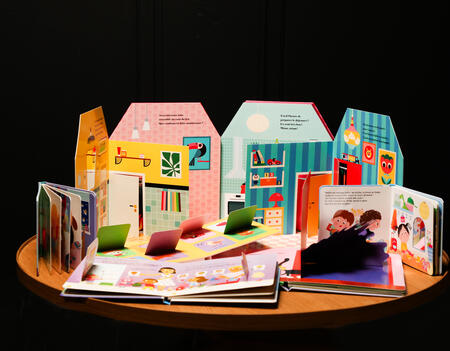On connaissait les travaux scientifiques d'Otto Dov Kulka sur la Shoah et l'antisémitisme. On ne savait pas qu'il en avait été non seulement un témoin - il est né en 1933 -, mais aussi une victime. En effet, à l'âge de 9 ans, il est déporté avec sa famille d'origine tchèque dans le camp de Terezín, puis dans celui d'Auschwitz.
C'est la grande révélation, le choc de ce livre éblouissant et ténébreux à la fois qui embrasse l'histoire, le temps, la mémoire, la foi et exprime l'impossibilité de revenir vers ce qu'il nomme "la métropole de la mort". A partir d'entretiens, de pages tirées de son journal et de quelques photographies, Kulka raconte sa survie dans ce "camp familial" créé à Auschwitz en 1943, la mort de sa mère ou celle de cette jeune femme de 20 ans qui laisse à son père trois poèmes avant d'entrer dans la chambre à gaz. Et toujours, à chaque ligne, cette "Grande Mort qui gouverne tout".
Car c'est bien de cela qu'il s'agit. De la mort, présente à tout instant, contrôlée par les nazis. L'historien rend bien compte de cette cité où la peur vous tenaille en permanence et où la vie se mesure en fonction de la distance du crématoire.
Tout cela lui est revenu comme une bouffée, lors d'une visite en Pologne en 1978. "Ce n'était plus un paysage d'enfance, c'était un paysage de - je n'ai pas envie de dire le mot - mais c'était un paysage de cimetière." Mais il n'avait jusqu'alors pas envie d'en parler. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps, pourquoi n'avoir jamais voulu voir le Shoah de Claude Lanzmann ? L'historien s'en explique sans détour.
Dire que ce livre est fort serait bien en dessous de la vérité. Kulka dépasse le témoignage pour ne garder que le trauma. Il le fait avec ses références à Kafka, avec la volonté de rester un vivant dans cet univers de mort. Il ne s'agit donc pas d'un énième récit, mais de quelque chose de plus compliqué, une sorte de dialogue entre l'enfant qu'il n'est plus et l'historien qu'il est devenu. Installé en Israël depuis 1949, professeur émérite à l'université hébraïque de Jérusalem, Otto Dov Kulka retisse les liens entre le savant et sa propre mémoire. Qu'a-t-il tiré de l'occupation de son présent par ce passé qui lui revient et lui échappe constamment ? Un passé comme un ressac qui façonne son existence de survivant, comme si même le passage du temps n'avait aucune importance dans ce perpétuel mouvement.
"L'histoire des historiens n'a pas d'odeur", >écrivait Georges Hyvernaud dans La peau et les os où il rapportait sa détention dans un oflag. Chez Otto Dov Kulka, cette odeur, c'est la mort. C'est cette impossibilité d'entrer dans ce lieu qui constitue ces Paysages de la métropole de la mort.