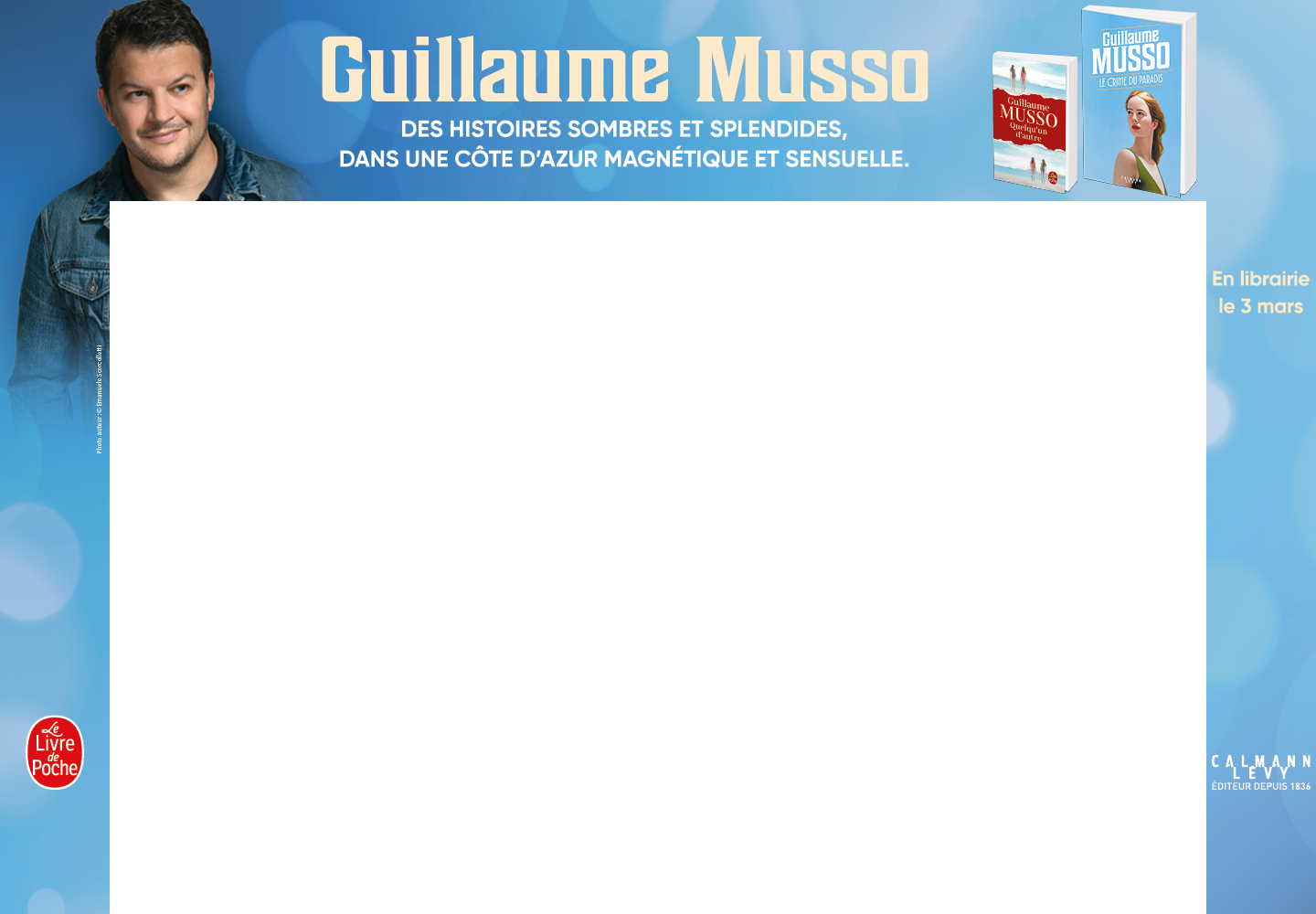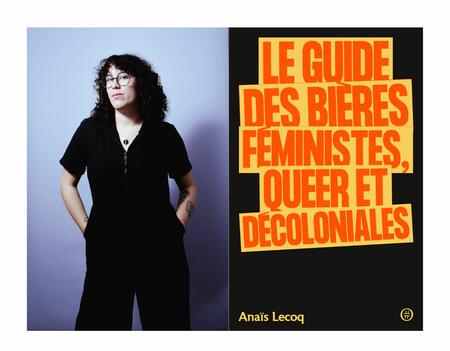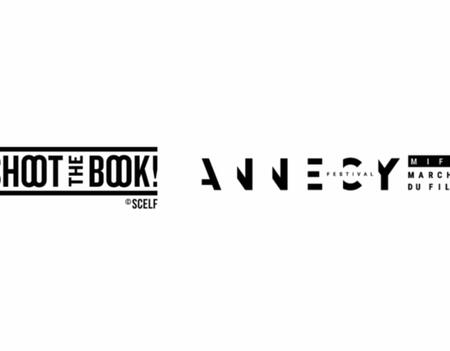Dès son premier succès en France, Les enfants de minuit (Stock, 1983), où Salman Rushdie contait, sous forme de roman-fleuve multiple, polyphonique et sophistiqué cette nuit du 15 août 1947 où l'Inde accéda enfin à son indépendance, on sait que Salman Rushdie est un écrivain unique, qui ne fait rien comme ses confrères. De son plein gré ou malgré lui, bien entendu.
Salman Rushdie- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Ainsi cette ignoble affaire des Versets sataniques, qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille durant plus de dix ans, faisant de lui un paria universel, persona grata seulement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis et encore dans des conditions drastiques. On ne se remet jamais d'un tel traumatisme, même si l'écrivain a conjuré la fatwa en poursuivant son oeuvre, se déplaçant même - discrètement - pour en assurer parfois la promotion, même si, depuis 1997, il peut enfin voyager librement, y compris en Inde, sa propre patrie.
Comme ses Enfants de minuit, Rushdie est né à Bombay en 1947, dans une famille musulmane partie ensuite vivre au Pakistan - "les pires années de ma vie", dit-il aujourd'hui. Mais s'il a pu retrouver sa nationalité - pour plus de commodité, il est aussi devenu citoyen britannique lors de son long exil forcé - ses Versets sataniques sont toujours interdits de publication en Inde. Et l'on vient d'apprendre, par la réalisatrice elle-même, que le film tiré des Enfants de minuit, qui devrait sortir prochainement dans plusieurs pays occidentaux, n'a pas trouvé de distributeur en Inde.
Pour raconter cet enfer tel que lui, ses ex-femmes et leurs deux fils, l'ont vécu au jour le jour, Salman Rushdie ne pouvait se contenter d'un récit partiel. Il lui fallait remonter à la source, à son arrivée en Angleterre, pensionnaire à Rugby puis élève à Cambridge, au milieu des années 1960. C'était son voeu, sans doute pour s'éloigner de son père Anis, un riche héritier devenu avocat ruiné et alcoolique, qui avait choisi le nom de leur famille d'après celui du philosophe arabe que les Occidentaux appellent Averroès, mais qui se nommait en réalité Ibn Ruchd. Un sage, un homme de tolérance, un voyageur militant pour le dialogue entre les civilisations, donc les religions. Quel plus beau symbole ?
Cette "autobiographie" s'ouvre avec l'affaire des Versets sataniques, versets que le jeune Salman avait découverts dès 1968, lorsqu'il était en licence d'histoire, en plein swingin'London, bien plus préoccupé, lui, "cet étrange écrivain indien avec des cheveux longs", de faire la fête, d'écouter Dylan et les Rolling Stones, et de tenter de séduire des filles que par l'islam. C'est à ces années-là que remonte son athéisme.
Ensuite, tout en flash-back, le héros, à la troisième personne, déroule le long récit de son parcours : Bombay, Pakistan, puis Londres et Los Angeles, où il habite encore en partie, parce que là-bas il peut être anonyme. C'est à Los Angeles qu'il a vécu le 11-Septembre, avec une culpabilité et un trauma particuliers, tout personnels. Et le livre s'achève en 2002, quand la police anglaise, qui veillait sur lui et les siens depuis treize ans, cesse sa mission avec une "brusquerie" qui, écrit-il, "le fit rire tout haut". Comme la plupart des ouvrages de Rushdie, Joseph Anton est un pavé foisonnant, composite - certains passages ont été publiés sous forme d'articles dans la presse américaine -, où l'on se perd parfois dans les détails. Mais c'est ainsi qu'il travaille, incapable de canaliser sa formidable prolixité. Et puis, cette fois, il avait tant à raconter, et qui lui tenait à coeur. Un ouvrage, courageux, à un moment où le monde musulman subit une nouvelle offensive intégriste, qui vaut à Salman Rushdie un renchérissement de la fatwa qui est toujours sur sa tête.
Joseph Anton. Une autobiographie, Salman Rushdie, Plon (Feux croisés), traduit de l'anglais (Inde) par Gérard Meudal, tirage : 40 00 ex. 24 euros, 736 pages, ISBN : 978-2-259-21485-8. Sortie : 20 septembre.