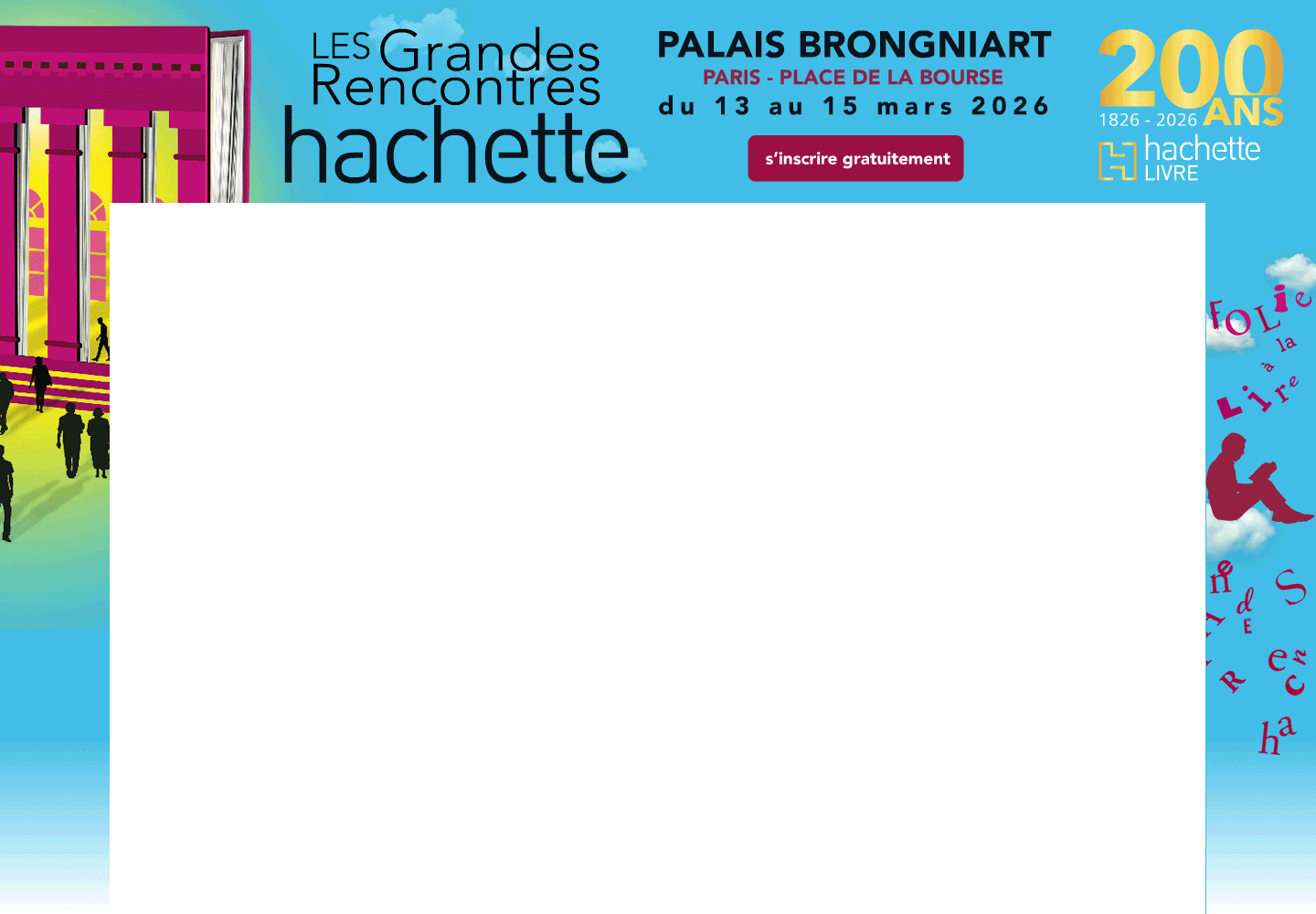Vous aurez sans doute remarqué que de plus en plus de « philosophes » interviennent dans les médias. Mis à part les professeurs de philosophie, qui sont surtout des historiens du domaine, ils appartiennent à des sphères très variées : la médecine, le journalisme, la politique, l’écologie, le théâtre… Ils se distinguent par une agilité surprenante à mettre en relation diverses perspectives afin, disent-ils, d’aider le public à mieux comprendre le monde. Prenant souvent prétexte d’un livre de circonstance qu’ils ont vite écrit, ils s’illustrent par une capacité de séduction qui cloue le bec à bien des spécialistes.
Il fut un temps où on les appelait intellectuels. Dans l’Antiquité, Platon les appelait sophistes. Non pas qu'ils fussent obligatoirement des charlatans, mais leur discours généraliste visait d’abord à fournir un guide dans l’action ou les affaires. Aujourd’hui, le phénomène se démocratise. Sans doute est-il dû à l’augmentation du niveau d’éducation et, surtout, à la traduction numérique de toutes choses en information et en discours sur l’information. La conséquence en est, pour les plus doués de ces « philosophes », une aura qui impressionne les décideurs tout autant que le grand public.
L’essence de la philosophie consiste à produire non pas simplement des arguments persuasifs mais des « concepts »
Le phénomène a toujours existé et il est heureux que l’espace public bruisse d’une conversation toujours plus riche. La nouveauté est que celle-ci se pare du prestige de la philosophie, c’est-à-dire d’une discipline qui prétendait pourtant, depuis Parménide et Platon, se distinguer d’un discours sur tout et rien. Gilles Deleuze a eu raison de rappeler que l’essence de la philosophie consiste à produire non pas simplement des arguments persuasifs mais des « concepts », c’est-à-dire des condensés de pensée semblables à des théorèmes, capables, comme des clefs, d’ouvrir et de déplier la diversité du réel. C’était le cas, par exemple, du cogito cartésien, de la monade leibnizienne, de l’a priori transcendantal kantien ou de l’éternel retour nietzschéen. Rien de tel aujourd’hui ni d’aussi exigeant, mais un tissu d’analogies qui, de proche en proche, tressent de chatoyants motifs.
Cette évolution ne tient pas à une supposée dégradation du discours ambiant mais à l’épuisement de la philosophie. En effet, à l’heure des sciences cognitives et de l’ingénierie numérique le projet proprement philosophique de penser la pensée par les moyens de la pensée perd de sa consistance. Il ne s’agit pas, cependant, de persifler les modes intellectuelles du moment au nom de la vraie philosophie, puisque celle-ci n’existe plus.
La mort de la philosophie n’est pas la mort de la pensée
Sa dernière incarnation aura été la philosophie analytique anglo-saxonne qui, finalement, s’est résolue à faire le lit des sciences cognitives. D’ailleurs, Barbara Cassin (L’effet sophistique, Gallimard, 1995) a eu raison de réhabiliter les sophistes, dont on s’aperçoit qu’ils n’étaient pas moins utiles que les discoureurs, tandis qu’inversement les idées platoniciennes pouvaient aisément nous conduire dans des impasses intellectuelles et politiques. En fait la mort de la philosophie n’est pas la mort de la pensée. Mais, alors, pourquoi s’en prévaloir ?
Peut-être par goût du mystère ou par une sorte de complotisme haut de gamme qui nous fait croire qu’il y aurait un logos caché dans les plis du réel. Plus vraisemblablement, parce que le confort typiquement occidental de la posture philosophique calme notre désarroi devant un monde devenu pour nous incompréhensible et menaçant malgré l’universalisation de l’héritage de l’occident, comme l’écrit l’indien Pankaj Mishra dans L’Âge de la colère (Zulma, 2019).
J’ai bien conscience en écrivant ces lignes de tomber sous le coup de mes propres critiques. Que de fois ne m’a-t-on pas reproché d’aborder les bibliothèques avec une tournure d’esprit trop philosophique ? Mais, mon d’admiration pour les philosophes du passé m’a toujours empêché de prétendre en être un. Il est vrai, pourtant, que la bibliothèque est un objet doublement philosophique : d’une part, elle ambitionne avec Borgès (un bibliothécaire) d’être la clef de toutes les clefs et, d’autre part, a contrario, sa pratique de la nouvelle ingénierie de la connaissance lui permet d’assister, des premières loges, à la fin de la philosophie et à l’essor d’un nouveau monde de data.
C’est cette contradiction qui m’a motivé à devenir bibliothécaire. La bibliothèque me paraissait et me paraît toujours l’un des lieux où s’exprime le mieux le changement de nos paradigmes culturels.
Nous entrons dans une ère de « mentalisation » généralisée
L’obsolescence de la philosophie n’implique en rien, cependant, l’anti-intellectualisme et son corollaire le populisme. Elle n’interdit pas que l’on puisse développer une pensée générale sur le monde. Nous entrons, au contraire, dans une ère de « mentalisation » généralisée. L’intelligence - artificielle ou non - devient l’air que nous respirons. Il convient donc d’approfondir notre connaissance des mécanismes biologiques, technologiques et collectifs de la pensée afin de les mettre au service d’une société plus consciente d’elle-même et plus respectueuse des potentialités de chacun. Les bibliothèques, en tant que creusets d’une pensée collective à finalité humaine, peuvent y aider.
Elles le pourront d’autant mieux qu’elles poursuivront leur métamorphose en devenant de véritables « maisons du savoir ». Toujours situées au plus près des gens et à la croisée de toutes les formes d’expression, elles doivent jouer un rôle central dans un usage équilibré de ces dernières. Par exemple, poussant le plus loin possible leur fonction de médiathèque, elles accompagneront leur public dans une utilisation raisonnée et créative de l’IA.
Le potentiel des bibliothèques
En effet, quel meilleur environnement qu’une bibliothèque pour s’exercer à changer de focale temporelle et spatiale, pour enrichir l’univers des data en contenus d’orientation, pour s’entraîner collectivement à éviter les bulles cognitives et à trouver les meilleures voies de navigation dans le monde de l’information ?
Cette perspective pratique est dans l’ADN des bibliothèques (un ADN qui est d’ailleurs à l’origine de la révolution numérique). C’est à leur corps défendant qu’elles ont nourri un imaginaire philosophique et peut-être faut-il qu’elles en sortent. En effet, elles ont surtout fait la preuve que la pensée n’est rien sans sa matérialisation dans des objets tels que les livres, dans des process d’indexation et de mémorisation ou dans des modes de socialisation et de transmission. C’est cette matérialité de la pensée que portent depuis toujours les bibliothèques et qui en font toute la modernité. Encore faut-il qu’elles en aient l’ambition et que les pouvoirs publics, plutôt que de les cantonner trop souvent dans une fonction - indispensable au demeurant - d’amortisseur social, prennent à nouveau conscience de leur potentiel proprement intellectuel.