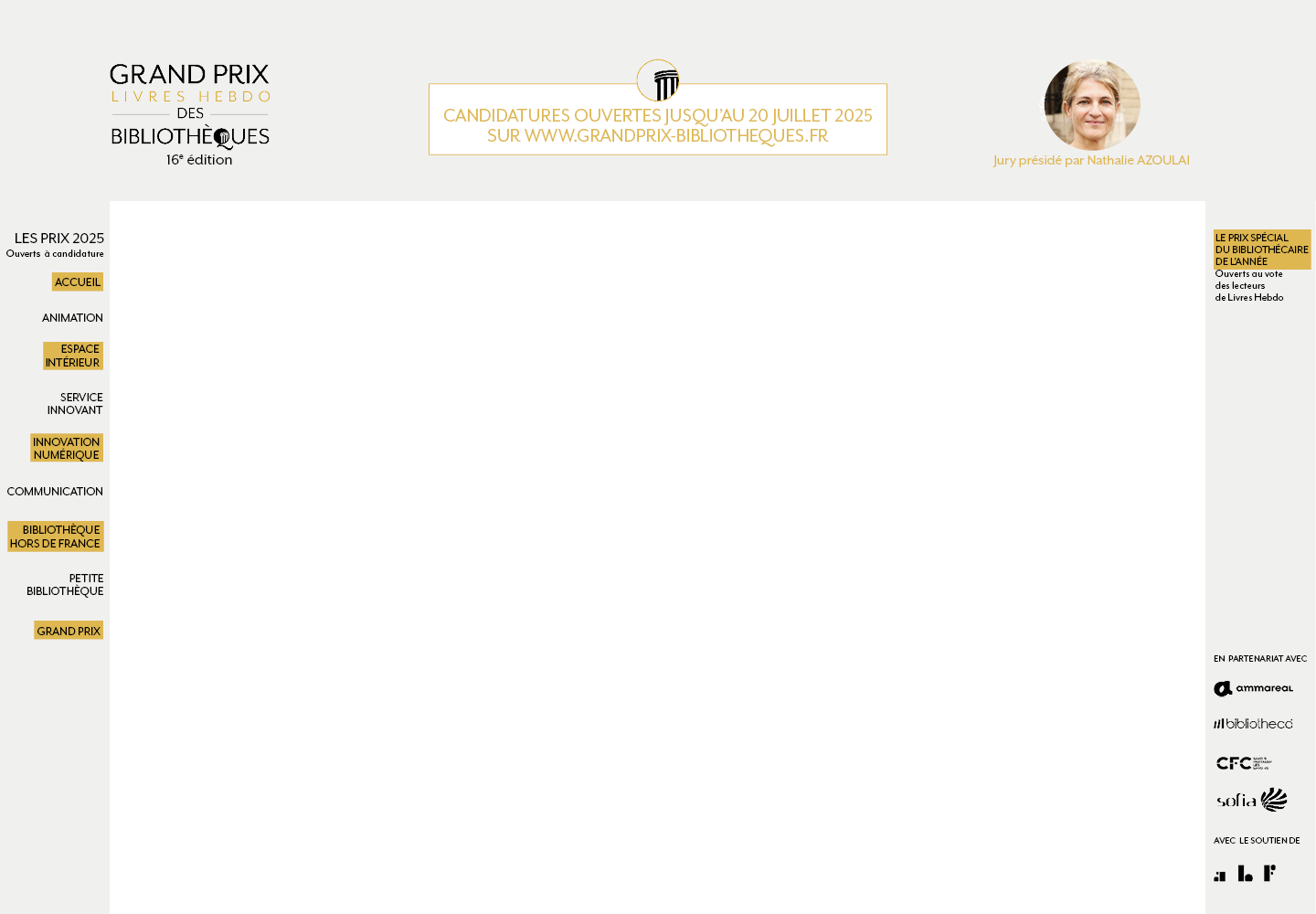Vous décrivez dans votre ouvrage la construction de « l'écrivain-marque », ou de la « marque-écrivain ». Pourquoi rapprocher ainsi l'univers de la littérature et celui de la marchandise ?
À l'origine, nous souhaitions observer la reconfiguration des relations entre la littérature et les médias. La notion de marque est apparue comme une entrée pertinente, parce que la marque permet de singulariser des produits ou des individus dans un contexte de massification. Mais l'enjeu n'est pas purement commercial. Dans le cas des « écrivains-marques », on associe à des figures d'auteurs une image valorisée, qui ensuite peut être instrumentalisée dans un processus marchand. Et certains auteurs ou structures vont aussi se singulariser comme marque en affichant leur refus de la logique de marché.
L'écrivain-marque n'est donc pas forcément un auteur de best-sellers ?
Bien sûr, on est tentés de penser aux écrivains qui vendent le plus. Marc Lévy et Guillaume Musso par exemple, avec leurs affiches publicitaires dans le métro ou sur les flancs des bus, leur PLV et leur nom dans une police trois fois plus grande que le titre de leur nouveauté. Un de mes co-auteurs cite d'ailleurs une journaliste expliquant que l'on achète aujourd'hui « du » Lévy, ou « du » Musso. Ils ont marqué les années 2000, avec une émancipation singulière à l'égard de leur éditeur, d'ailleurs. Mais il peut très bien y avoir une construction de marque pour des structures à plus petite diffusion. Chez Minuit, c'est la marque-éditeur qui tend à écraser la marque-écrivain, avec une forte incitation à la discrétion de l'auteur pour préserver l'identité de l'éditeur, surtout à l'époque de Jérôme Lindon. Plus récemment, on observe un processus relativement similaire avec les éditions POL. Même si Emmanuel Carrère peut, lui, tout à fait être vu comme un écrivain-marque.
En quoi Emmanuel Carrère a-t-il fait de son nom une marque ?
Par le choix de l'autofiction d'abord. Il y a un jeu biographique, qui va dans le sens de la construction d'un mythographie personnelle. Et dans son cas, il y a eu la plainte déposée par son ex-femme, qui l'a conduit à être retiré des listes du Goncourt. Sa vie privée étalée en place publique l'a fait basculer dans la non-fiction, je trouve cela passionnant. Il a aussi plusieurs activités de plume, comme journaliste notamment, et ce qui fait le lien entre ses différentes activités, c'est son nom. Mais l'écrivain-marque le plus emblématique de notre époque est sans nul doute Michel Houellebecq. Il est également dans une pratique autofictionnelle, il a écrit des poèmes adaptés en chanson, il fait du cinéma, il se plie volontiers au jeu des médias et n'a pas hésité à s'inviter dans « L'amour est dans le pré » auprès de Karine Le Marchand... Ce sont des formes de présence plurielles, diverses, compensée par une grande cohérence de la stratégie d'existence publique.
Et que dire d'Elena Ferrante, l'une des auteures les plus vendues de la décennie, dont on ne connaît pas l'identité ?
La logique est la même. Un nom de marque-auteur peut être un pseudonyme, ce n'est pas gênant. Elena Ferrante est a priori un ou une professionnelle de l'édition, qui connaît les rouages du marché du livre. Je ne dis pas qu'elle a pris un pseudonyme pour cette raison, mais elle l'a sans doute créé avec la connaissance des contraintes. Et une fois révélé le jeu de pseudonyme, ça ne fait qu'alimenter le mythe, et le succès des œuvres, qui sont en plus sérielles. Cette construction d'un récit autour d'elle me fait penser au cas d'Édouard Louis. Leurs livres, à l'un comme à l'autre, vont susciter des enquêtes journalistiques. J'étais étonnée que l'on puisse essayer de savoir ce qui était vrai dans En finir avec Eddy Bellegueule, parce que pour moi, la qualité littéraire du livre repose sur ce jeu de vrai et de faux. Le jeu de la marque c'est pareil, c'est un jeu de mise en récit. Cela signifie raconter des choses et donc plus ou moins fictionnaliser. Cette notion de marque nous dit quelque chose sur le fonctionnement social de la littérature. Et la littérature doit se vendre, parce que c'est comme ça qu'elle est lue.
Les réseaux sociaux ont-ils changé la donne dans la médiatisation des auteurs ?
Bien sûr, les réseaux sociaux jouent pleinement un rôle. Pour un écrivain qui a une notoriété, c'est très difficile de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. La romancière Tatiana de Rosnay aime beaucoup ça, elle en joue au point de construire des comptes Instagram pour ses personnages, elle s'y met en scène, mais il y a aussi des écrivains qui n'aiment pas ça, et ne savent pas faire. Ils y sont pourtant fortement incités par leurs éditeurs.
Dans le cas des bandes dessinées patrimoniales, comme Lucky Luke ou Astérix, peut-on parler de « personnage-marque », alors que les auteurs originaux ne sont plus à la barre ?
On va plutôt parler de phénomène de sérialité. Astérix est une série qui peut continuer au-delà de la vie des auteurs d'origine, comme ce qui s'observait avec des romans-feuilletons au XIXe siècle. Quand l'œuvre est construite pour faire série, elle peut elle-même devenir une marque, et écraser la marque-auteur.
On prend un plaisir presque voyeur à découvrir que certains auteurs, David Foenkinos avec Nespresso, Véronique Ovaldé avec Renault, Nicolas Rey avec une marque de lingerie, ont accepté d'écrire des nouvelles pour des marques. Comment l'analysez-vous ?
Je constate qu'en France, d'un côté il y a une extrême valorisation symbolique de la figure de l'auteur, qui s'incarne par exemple dans le Panthéon, un monument vraiment très français. Et d'un autre côté, un impensé majeur sur la rémunération de la production littéraire. L'écrivain reste une valeur prestigieuse, sans qu'il n'y ait plus aucun système de soutien de la part de l'État, de mécénat, comme ça a longtemps été la norme. Quand David Foenkinos accepte d'écrire pour une marque de café, c'est transgressif car il y a cette dimension commerciale. La marque fait appel à l'écrivain-marque pour montrer qu'elle fait partie du haut du panier des cafés. Cela choquerait beaucoup moins aux États-Unis.
Quant à Maxime Chattam, qui a déposé son pseudonyme, c'est le stade ultime de la marchandisation de soi ?
Ce n'est pas répandu, mais ce n'est pas nouveau de déposer son nom d'écrivain. Paul-Loup Sulitzer l'a fait, et la signature d'Émile Zola est un nom de marque par exemple. Ce n'est pas lui qui l'a déposé à l'époque, c'était une association, mais il a joué de la marque à fond, et dans son engagement pour Alfred Dreyfus, il a mis le poids de son nom dans la bataille.