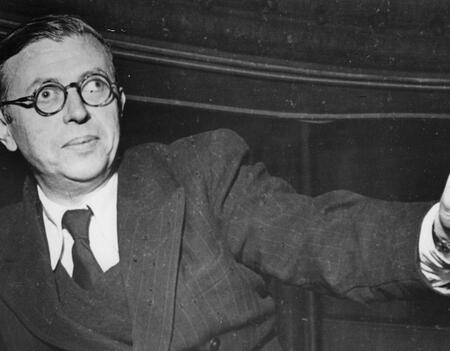Les absents ont toujours tort. Lorsque dans la France des années 1920 et 1930, les Kessel, Mac Orlan, Carco ou même Cendrars redonnèrent au roman d’aventures, aux horizons plus ou moins lointains, leurs lettres de noblesse, il manquait à ce tableau d’honneur le nom de celui qui leur avait peut-être montré la voie des privilèges de l’imaginaire et promettait d’en être l’un des principaux promoteurs. Depuis qu’un jour de 1917, sur le Chemin des Dames, la trajectoire de René Dalize avait inopportunément croisé celle d’un obus allemand, c’est aussi littérairement que celui qui fut le meilleur ami d’Apollinaire (qui lui dédia Calligrammes) était porté disparu. Il l’est resté, même si quelques érudits se souviennent encore que l’Histoire, qui fut pour lui mauvaise fille, en a tout de même retenu qu’il était considéré comme l’introducteur de l’opium dans les cercles parisiens. Mais de sa prolixité, de sa fantaisie, de la prodigalité de ses dons, plus rien ne demeurait.
C’est donc une vraie « bonne action » que viennent d’accomplir Eric Dussert et les éditions de l’Arbre vengeur (qui n’en sont pas, il est vrai, ni l’un ni l’autre, à leur première « résurrection littéraire »). Le club des neurasthéniques qu’ils nous proposent aujourd’hui est un petit bijou de drôlerie envapée qui ne s’interdit rien (ni une épidémie de peste, ni de prendre des trains et puis la mer, pas même une éruption volcanique), hors l’esprit de sérieux. Initialement paru à l’été 1912 sous forme de feuilleton dans les pages du quotidien Paris-Midi, et jamais édité en volume, il y est question d’« un certain nombre de détraqués, victimes de la civilisation intensive du vingtième siècle. Emportés malgré eux en un grand voyage à travers le monde, ces Parisiens arrachés à leur milieu renaissent peu à peu à la vie normale, à la saine nature, à l’amour ». C’est parfaitement réjouissant et tout à fait invraisemblable. Presque autant que le grand massacre à venir qui donne à cette lecture une touche d’émotion. Ces neurasthéniques oubliés sont aussi, sont surtout, de futurs cadavres. Olivier Mony