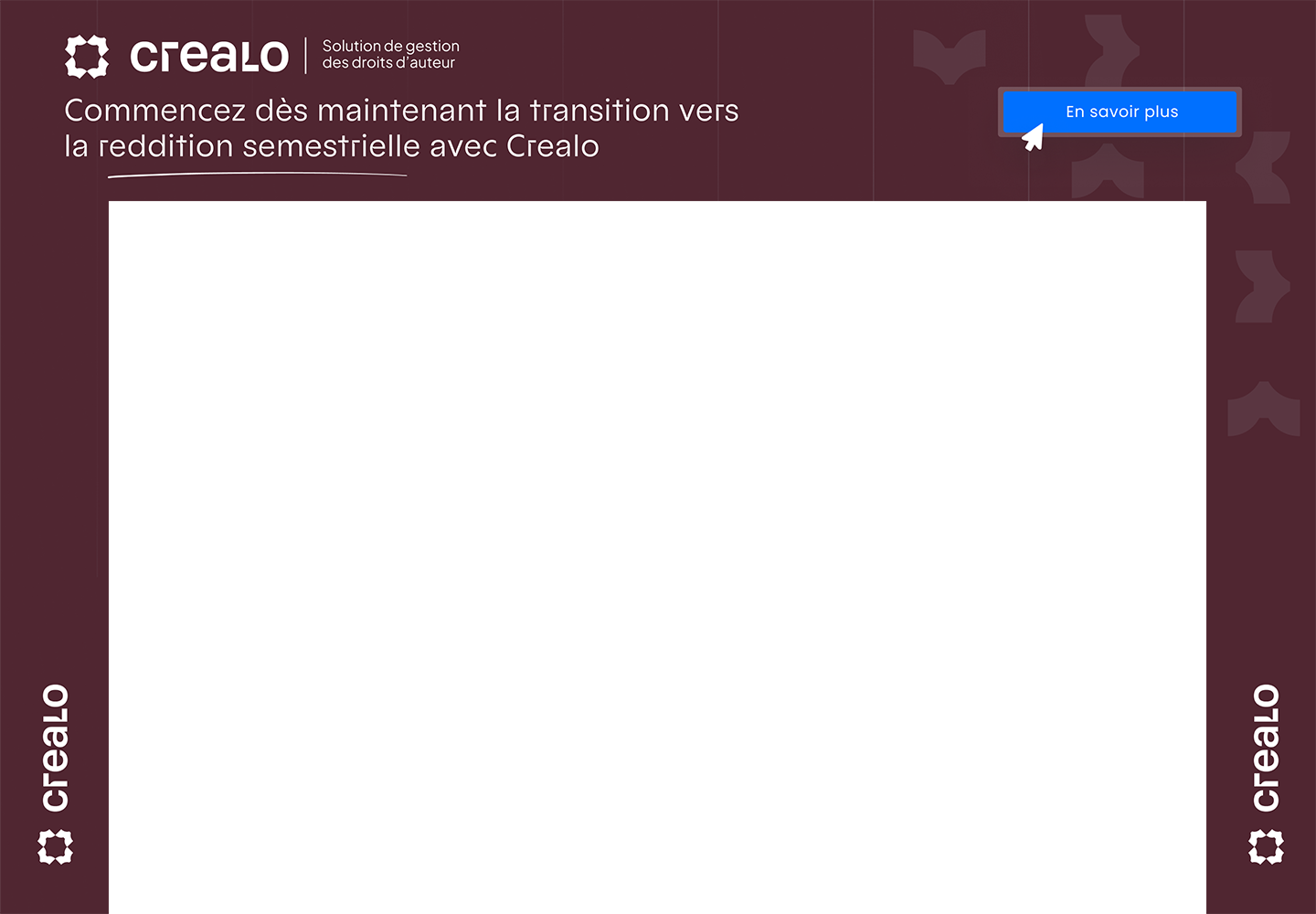Livres Hebdo : Vous fêtez les dix ans des Rencontres philosophiques à Monaco. Comment sont-elles nées ?
Charlotte Casiraghi : Avec Robert Maggiori d'abord, mon professeur en terminale, puis avec Raphael Zagury-Orly, qui est philosophe. Cette aventure est née de nos discussions, et de l'envie de redonner sa place à la philosophie au cœur de la cité. Monaco, en tant que cité-État, offre la possibilité de mener des expérimentations qui ne pourraient pas l'être à plus grande échelle. Les Rencontres sont donc ancrées dans le tissu de la ville, avec des dates tout au long de l'année, dans des lieux divers : lieux de soins, entreprises ou écoles. En dix ans, quelque chose s'est installé, et Monaco est désormais associé à la philosophie.
Charlotte Casiraghi- Photo © ASTRID DI CROLLALANZAPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Dans La fêlure, vous évoquez vos rencontres avec des adolescentes souffrant d'anorexie et votre volonté de leur faire partager des textes. L'avez-vous fait dans ce cadre ?
Non, la professeure Florence Askenazy, chef de service en pédopsychiatrie, m'a proposé de mener un groupe thérapeutique de philo-littérature avec des jeunes filles dans son service. J'ai commencé par une sorte de stage d'observation, pendant plusieurs mois, à l'hôpital Lenval de Nice, et cela fait maintenant trois ans que j'interviens une fois par mois.
Que vous apprend cette expérience ?
Que cet âge est très difficile. Que pour tenter de réveiller leur désir, il faut raconter des histoires. Et quand elles n'ont pas envie de parler, il ne faut pas forcer la discussion. Ça prend du temps. J'ai donc appris à prendre les parcours de vie comme point de départ au questionnement.
Comme dans votre livre ?
Exactement. La dimension biographique est, je crois, très porteuse. Elle permet de voir, à l'échelle d'une vie, que ce soit celles des poétesses Ingeborg Bachmann, Anna Akhmatova et Maya Angelou ou de Colette, tout ce qui peut s'y passer. C'est-à-dire les échecs, les ratages, les difficultés et la manière dont la création peut trouver une place dans tout ça.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un vade-mecum du « mieux-être » par la philosophie ?
J'évoque dans mon livre la résilience mais aussi pour montrer que ce processus n'est pas toujours possible. Les épreuves peuvent aussi nous rendre plus durs, plus abîmés. J'ai choisi des figures différentes, des stratégies différentes, certaines trajectoires sont tragiques, comme celle de Cesare Pavese. Le message n'est pas que la littérature va vous aider à aller mieux, mais qu'elle peut être un lieu de survie.
Les livres peuvent-ils venir à notre secours ?
Je crois qu'avec la littérature, il se passe quelque chose qui permet parfois de trouver un espace de résonance avec ce qui a pu nous blesser. C'est la grande magie de la littérature : que quelqu'un qui a écrit il y a plusieurs siècles puisse vous parler comme s'il était là, au moment même.
Entre le « il » de l'essai et le « je » de l'autofiction, vous passez aussi au « tu ». Est-ce un entre-deux ?
Je dirais que cela répond à une envie de prendre le lecteur à bras-le-corps, de manière « confrontale ». Parce qu'il y a parfois, dans le « tu », cette volonté de provoquer, de lui dire : « Arrête de jouer, regarde. »
Vous convoquez des figures plutôt attendues, comme Marguerite Duras, George Sand ou Virginia Woolf. D'autres moins, comme le navigateur Bernard Moitessier, et même une chanson : Magnolia de J.J. Cale.
Je voulais parler de cette chanson parce que je crois que, parfois, il n'y a qu'une chanson pour dire ce moment de fragilité où quelque chose se fêle en nous. La musique permet d'approcher cet endroit-là. Quant à Moitessier, qui incarne pour moi une ligne de fuite deleuzienne, c'est très personnel. Mon frère, comme lui, comme beaucoup d'hommes dans ma famille, est navigateur. Et puis cela parle du désir de l'extrême, de la mise en danger, qui s'appuie sur quelque chose d'un peu fêlé chez ces personnages.
À quand remonte chez vous cette conscience de la fêlure ?
Peut-être à la découverte de la poésie, à laquelle j'ai été sensible très jeune. Il y a quelque chose de vibratoire, d'atmosphérique dans la poésie, qui permet de sentir les endroits cassés. Je me souviens, lorsque j'ai lu La cloche fêlée, ce poème magnifique de Baudelaire, de ce cri : « Moi, mon âme est fêlée ». Ces vers ont résonné en moi comme une autorisation à me sentir fragile.
Vous distinguez la vulnérabilité de la fragilité ?
Je reprends cette distinction à Jean-Louis Chrétien, qui a été mon professeur à la Sorbonne. Son ouvrage Fragilité m'a accompagnée tout au long de l'écriture. La vulnérabilité est liée à un facteur externe, tandis que la fragilité est constitutive, intérieure. La fragilité dit ce qui peut se briser à l'intérieur, alors que notre époque est celle de la vulnérabilité, du traumatisme.
Sommes-nous à l'ère du trauma roi ?
Jusqu'à récemment, on ne parlait pas de l'intimité de la même manière. Aujourd'hui, on est très vite affecté par ce qui arrive. Notre époque est nourrie d'une grande susceptibilité ambiante. Tout risque de devenir traumatisme. La fêlure n'est pas liée à un événement qui fait effraction : c'est une usure lente, progressive. Elle détermine notre façon de réagir aux circonstances, selon notre histoire personnelle et notre milieu social et culturel, nos fragilités biologiques aussi. Elle relève de la singularité, ne se circonscrit pas : c'est l'endroit du silence.
La maternité est un thème récurrent, que vous traitez sans manichéisme.
Il est question de la maternité qui a hanté Balzac, et d'un texte de Maria Pourchet. Je crois que de nombreuses mères sont traversées par l'inquiétude de ne pas aimer leur enfant, avant même la naissance. Le mythe de l'amour maternel inconditionnel, sacrificiel, produit une grande culpabilité et rend difficile l'expression de sentiments ambivalents. On a peur d'être une mauvaise mère, ou un mauvais père, d'être jugé par la société.
Vous invitez à penser la fêlure, mais faut-il la panser ?
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'« optimisation de soi », d'être « la meilleure version de soi-même ». Je pense au contraire qu'il n'y a pas d'obligation d'optimisation ni de réparation. La littérature nous montre que c'est par ce qui est cassé, par ce qui tremble, que l'on pense et que l'on crée. Il ne faut pas toujours chercher à redresser ce qui boîte. On ne fait pas de littérature avec les gens qui vont bien. La fêlure est peut-être la dramaturgie de nos vies. Heureux les fêlés !
La fêlure
Julliard
Tirage : 30 000 ex.
Prix : 22,90 € ; 384 p.
ISBN : 9782260057406