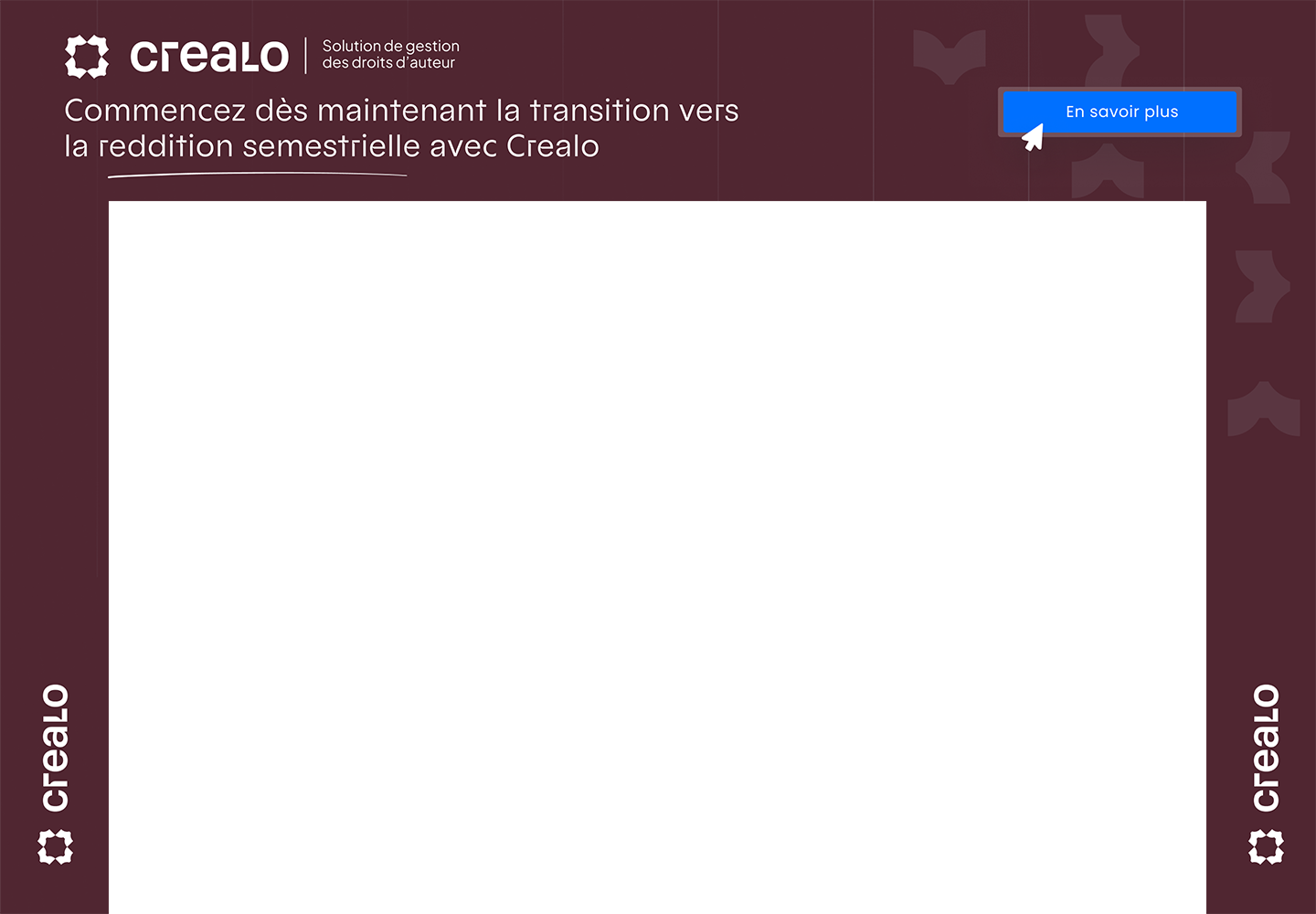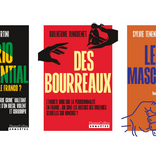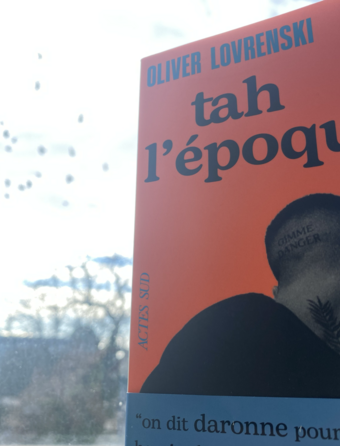Le nombre de livres électroniques consultés par étudiant ou chercheur français via les bibliothèques académiques a augmenté de 207 % en dix ans. Ce qui profite aux éditeurs de revues scientifiques, tels que l'allemand Springer Nature - plus de 300 000 ouvrages dans son catalogue, et une consultation de ses plateformes en croissance de 8 % chaque année - ou au groupe anglo-néerlandais Relx, qui détient Elsevier et sa prestigieuse revue médicale The Lancet.
Christine Weil-Miko, Françoise Rousseau-Hans et Adeline Rege, négociatrices Couperin.- Photo CONSORTIUM COUPERINPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Problème pour leurs clients : leurs tarifs. Pour Sorbonne Université, le budget alloué à la licence nationale Elsevier est plus élevé que celui (déjà significatif) consacré aux ressources documentaires pour les étudiants - Elsevier intéressant davantage les chercheurs. Mais le pis : l'éditeur peut demander jusqu'à 9 000 dollars de frais (dits APC, Article Processing Charges) aux chercheurs financés par l'État pour relire leurs travaux et les publier en accès ouvert, afin que la lecture soit gratuite pour le lecteur.
Interrogé par écrit par Livres Hebdo, Elsevier insiste sur le fait qu'il est « un des plus grands éditeurs en open access au monde, engagé dans le soutien des initiatives en open access. Et offre des options de publication en partenariat avec les institutions et les gouvernements pour défendre et transformer le modèle l'open access afin qu'il soit adapté aux besoins de recherche, de publication des communautés scientifiques les plus larges. » Mais du côté de Sorbonne Université on note que l'État, via la bibliothèque universitaire, paye en parallèle un coûteux abonnement pour accéder à la même revue... « Pour 2023, on a identifié environ 280 000 euros de dépenses d'APC au sein de l'établissement », renseigne ainsi Amélie Church, codirectrice des bibliothèques de Sorbonne Université.
Mais ça, c'était avant ? Car, face à ces pratiques qu'elles jugent déloyales, certaines ont stoppé leur abonnement. En 2019, l'université de Californie se désabonne d'Elsevier. L'Université de Lorraine fait de même avec l'américain Wiley en 2023. Sorbonne Université coupe les ponts avec Science. Puis IEEE Springer en 2018, IEEE en 2019, Springer Nature en 2020, The Royal Society of Chemistry en 2021, la base de données WOS (Web Of Science) en 2024... Et cette année, la négociation de Couperin (organisation qui représente les intérêts de presque 100 universités) a échoué pour les revues psy, « qui ont augmenté de 25 % leurs tarifs sur les trois prochaines années », informe une proche du dossier.
Nicolas Fressengeas, vice-président de l'université de Lorraine.- Photo DIRECTION DE LA COMMUNICATION - UNIVERSITÉ DE LORRAINEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Leur argumentaire : l'alignement sur les pratiques internationales. Springer nous indique pour sa part, également par écrit « investir dans l'IA et autres technologies, afin de délivrer de nouveaux services aux enseignant, étudiants et professionnels de santé, et rendre le processus de publication plus rapide, sûr et efficace. » Mais presque 20 négociations entre Couperin et des éditeurs n'ont pas été conclues en 2024-2025.
De quoi faire pression sur les éditeurs ? La revue Nature n'est éditée que par Springer, et permet de gagner des points dans les classements internationaux des universités, Elsevier a le monopole sur la revue Masson en médecine. « Difficile de ne pas publier dans les revues d'Elsevier. Pour un grand nombre de communautés, cela induirait trop de changements », résume Nicolas Fressengeas, vice-président de l'université de Lorraine chargé du numérique, des données et de la science ouverte. La solution selon ? continuer à publier dans ces revues, mais gratuitement et en accès ouvert.
Accords transformants
Formule abonnement + APC = ? C'est l'esprit des « accords transformants » (obscur nom officiel), pratiqués par Wiley, Springer, et Elsevier dans l'accord d'avril 2024 avec le ministère de la Recherche français, qui a voulu faire poids en représentant les 241 établissements sous sa tutelle. Montant du contrat : 33 millions d'euros, à payer tous les ans pendant quatre ans, avec une hausse du tarif limité à 1 %.
L'accord englobe l'abonnement à près de 1 800 titres (Freedom Collection and the French Medical Library collection), et les APC pour un peu plus de 11 000 articles que publieront en théorie les chercheurs en France dans l'année. Ainsi plus besoin pour les labos de verser des APC : tout est compris dans l'accord. Pour Springer, au 1er janvier 2025, il restait 390 droits de publication en accès ouvert immédiat à consommer d'ici le 31 décembre 2025.
Mais est-ce vraiment avantageux pour les bibliothèques ? Ces forfaits globaux peuvent brouiller les prix des différents services : prix unitaire des revues, frais de publications, accès aux archives... « Quelquefois, l'abonnement titre par titre peut être plus cher qu'en bouquet, s'indigne Françoise Rousseau. Cela incite à négocier ce type d'accords forfaitaires, même si tous les services ne sont pas toujours utiles. » « Et si le prix du bouquet est plus cher l'année suivante, c'est justifié par le fait qu'il comprend plus de titres qu'avant. Or nous n'avons jamais demandé cet énorme bouquet », relève de son côté Amélie Church.
Bras de fer
La Sorbonne a testé, l'été dernier et à ses dépens, plusieurs semaines sans accès à Elsevier. « Trois personnes seulement nous ont envoyé un message. Quand on se désabonne, les chercheurs et étudiants trouvent d'autres solutions », avance Amélie Church. En se connectant par exemple via une autre université abonnée.
Reste, pour les bibliothèques mécontentes, à soutenir des alternatives et à sensibiliser les chercheurs : leur rappeler que la loi pour une République numérique de 2016 leur permet de publier en accès libre le résultat de leurs recherches (si financées pour moitié par des fonds publics), même s'ils ont cédé à une revue (qui paraît plus d'une fois par an) des droits exclusifs d'exploitation. La loi française concédant un embargo de six mois à un an après leur publication dans la revue. La Commission européenne va plus loin, en invitant les chercheurs financés par ses programmes Horizon Europe à publier leurs articles sur Open Research Europe, sans délai, en gardant les droits à vie.
Mais l'Europe peut-elle peser dans l'écosystème mondial ? Chez Couperin, Adeline Rege rappelle la bataille pour « faire reconnaître aux éditeurs anglo-saxons qu'ils ne peuvent interdire la fouille de leurs textes à des fins de recherche, autorisée par la directive européenne du 17 avril 2019, transposée en France par l'ordonnance du 24 novembre 2021 ». Les bibliothécaires sont également attentifs aux cookies et autres marqueurs informatiques que les éditeurs de ressources électroniques peuvent déposer au cours de la navigation, ajoute la négociatrice Couperin, Christine Weil-Miko. « Ces données personnelles, les éditeurs se permettent de les collecter, voire de les partager à des sous-traitants qui parfois ne répondent pas à la RGPD. On essaie de limiter au maximum ce traçage. » Sans réelle surveillance possible.
Payer du début à la fin
« Les résistances sont très fortes chez les éditeurs, car les choses sont installées, et les enjeux financiers extrêmement importants », résume Nicolas Fressengeas. Mais les résistances sont aussi de plus en plus fortes du côté des institutions de recherche. « C'est nous qui faisons le travail de recherche, d'écriture, et même d'édition. C'est fort de café de payer la revue. On est en train de casser ce cercle vicieux. Mais on ne peut pas le faire au niveau de l'université, d'une région, même nationalement : c'est un mouvement international. »
Mais tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes moyens. Les publications chinoises et indiennes sont en plein boom chez Springer Nature, « et globalement chez tous les éditeurs », abonde l'éditeur allemand. Et les dix plus gros marchés sont la Chine, puis les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, l'Australie, le Canada, l'Espagne et la France.
Quid en particulier de la Chine ? « Elle achète un maximum de contenus pour traiter ensuite cette masse de données. Pour faire ce travail de data mining, ils mettent pas mal d'argent sur la table », signale Françoise Rousseau, complétée par Adeline Rege : « Les éditeurs revendent leur contenu aux entreprises qui veulent entraîner leurs intelligences artificielles. » L'été dernier, l'éditeur Taylor & Francis vendait ses données à Microsoft IA pour 10 millions de dollars, sans en informer les auteurs... Et en janvier, la start-up chinoise DeepSeek présentait une IA générative open source cassant les prix du marché, affolant la tech américaine. Quelques jours avant, Donald Trump leur promettait 500 milliards de dollars d'investissements dans l'IA d'ici 2029. Le président républicain touchera-t-il au Nelson Memo, directive qui prévoit que toute recherche financée par des fonds fédéraux en 2026 devra être en accès ouvert... ?
La Chine et les États-Unis jouent dans la cour des géants et influencent un marché de l'information scientifique de plus en plus vertigineux. Et les bibliothèques françaises cherchent à faire entendre leur voix. Comme le résume Jean-François Lutz, appui aux chercheurs à l'université de Lorraine, « c'est en bloc que la négociation peut se mener ». La France, il y a un an, a dû contraindre ses universités à être abonnées à Elsevier. Mais avait-elle le choix ?