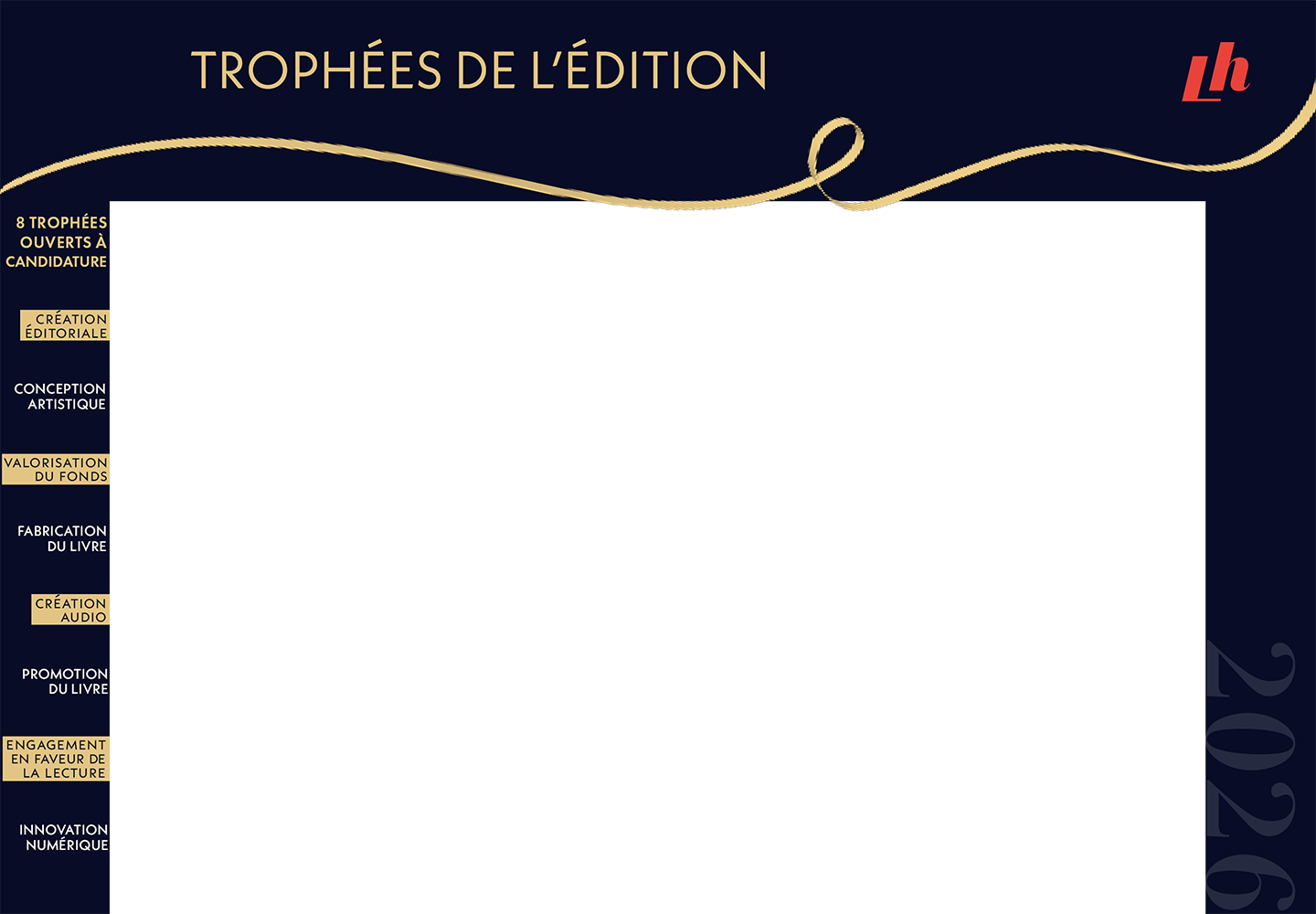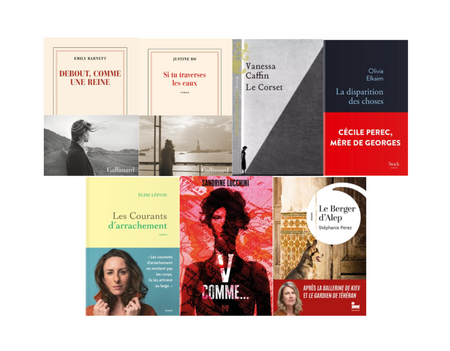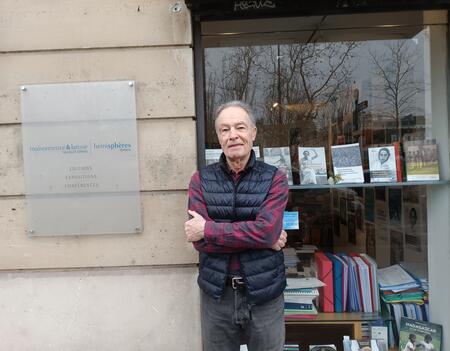Libre. Dominique Simonnot est une femme libre. Et c’est sans doute pourquoi elle est aussi attachante pour certains qu’exaspérante pour d’autres. Elle dit ce qu’elle pense. Sans filtre. N’hésitant pas à s’engueuler avec le garde des Sceaux qui l’a nommée. Et dans l’univers feutré des institutions, elle détonne. Ça tombe bien. Elle est Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL). Et il en faut de la liberté pour tenter de faire bouger les choses dans ce « cauchemar » dont se plaint même Nicolas Sarkozy.
Lire aussi : Dominique Simonnot : « Je n’ai pas fini "Le deuxième sexe" de Simone de Beauvoir, j'en ai eu marre »
Issue d'une famille d'avocats, Dominique Simonnot a obtenu une licence de droit privé à la Sorbonne en 1975. Elle a rapidement été fascinée par le monde judiciaire. Elle a eu pour professeur Robert Badinter, qui a été son examinateur en procédure pénale. Il lui demanda : « Mademoiselle, vous pensez mériter la moyenne ? Eh bien, je ne vous la donne pas. ». Elle s’en souvient avec ironie : « Inutile de dire que je le vénérais. Aujourd’hui, je suis assez en colère d’entendre les trémolos et les serments mensongers célébrant la mémoire de Badinter, alors qu’il hurlerait en voyant l’état des prisons et la médiocrité du débat autour de la politique pénale. »
La prison, Dominique Simonnot la connaît depuis longtemps. Avant de devenir journaliste, elle a exercé le « boulot » d'éducatrice pénitentiaire (l’ancienne appellation de Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation) pendant plus de dix ans, de 1979 à 1991, au comité de probation de Nanterre. Son regard acéré sur la justice s'est exprimé pendant des années à travers ses chroniques des comparutions immédiates. D’abord pour Libération (1998-2006) sous le titre Carnets de justice, puis pour Le Canard enchaîné (2006-2020) sous le titre Coup de barre. Ces audiences l'ont « toujours passionnée », représentant selon elle « un condensé de tout ce qu’a raté la société », sous la forme d’une « fast justice ».
« Gênée par la volonté de répression qui a envahi notre société »
Qualifiée de « disruptive » par certains proches de l'administration pénitentiaire, Dominique Simonnot n'hésite pas à se définir elle-même en femme pragmatique : « Je ne suis pas une intellectuelle, j’aime le concret ». Son parcours est marqué par des engagements forts, souvent conduits avec humour, comme le démontre son livre Plus noir dans la nuit : La Grande grève des mineurs de 1948 (Calmann-Lévy, 2014). Où elle donnait une voix à ces mineurs brutalement licenciés des houillères et injustement condamnés.
La lecture de La femme eunuque de Germaine Greer fut, par exemple, « une révélation » pour elle et ses amies d'alors. Elles se sont même déclarées « en guerre contre les hommes et en grève du sexe ». Elle se souvient encore aujourd'hui de « la stupéfaction de nos petits copains, quelle rigolade ! ». Bien qu'elle chérisse le mouvement #MeToo, elle confie être « gênée par la volonté de répression qui a envahi notre société ». Elle est également honnête sur ses préférences littéraires, avouant n'avoir « pas fini » Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, préférant d’autres icônes féminines « toutes belles, aventureuses, téméraires et libres » comme Colette ou Joséphine Baker.
Une attention particulière aux bibliothèques des lieux de privation de liberté
La lecture occupe une place essentielle dans sa vie. Elle lit tous les soirs jusque très tard. Elle révèle que les livres ont la capacité de la faire pleurer, alors qu’elle « ne pleure jamais ou presque dans la vraie vie ». Mieux encore, la lecture « me fait rire toute seule dans des moments lugubres ou pas du tout adaptés ». En tant que Contrôleuse générale, son amour des livres se traduit par une attention particulière : elle veille à ce que les bibliothèques des lieux de privation de liberté (prisons, hôpitaux psychiatriques, etc.) soient ouvertes et bien gérées.
« Certaines sont encore fermées depuis le Covid, faute de surveillants pour y amener les détenus. On dit qu’elles ne sont pas fréquentées, mais c’est plutôt qu’elles ne sont pas ouvertes. Nous rencontrons, dans beaucoup de prisons, des détenus affectés à la bibliothèque, qui s’en occupent avec ferveur et sont fiers de conseiller les autres. Je me souviens d’une détenue devenue érudite à force et d’un jeune très abîmé et enfermé pour très longtemps, pour qui bien tenir “sa” bibliothèque était devenu une raison de vivre. »
Enfin, même si son poste de Contrôleuse générale n'a pas la capacité de contraindre l'État, elle y voit un prolongement de son « âme de journaliste ». Elle estime que c'est « drôle comme les contre-pouvoirs ne sont pas appréciés du pouvoir », mais elle juge de son « devoir » d'aller sur le terrain, même dans les commissariats.
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’une de ses maximes favorites vient du poète René Char et illustre son énergie et son culot : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront ».