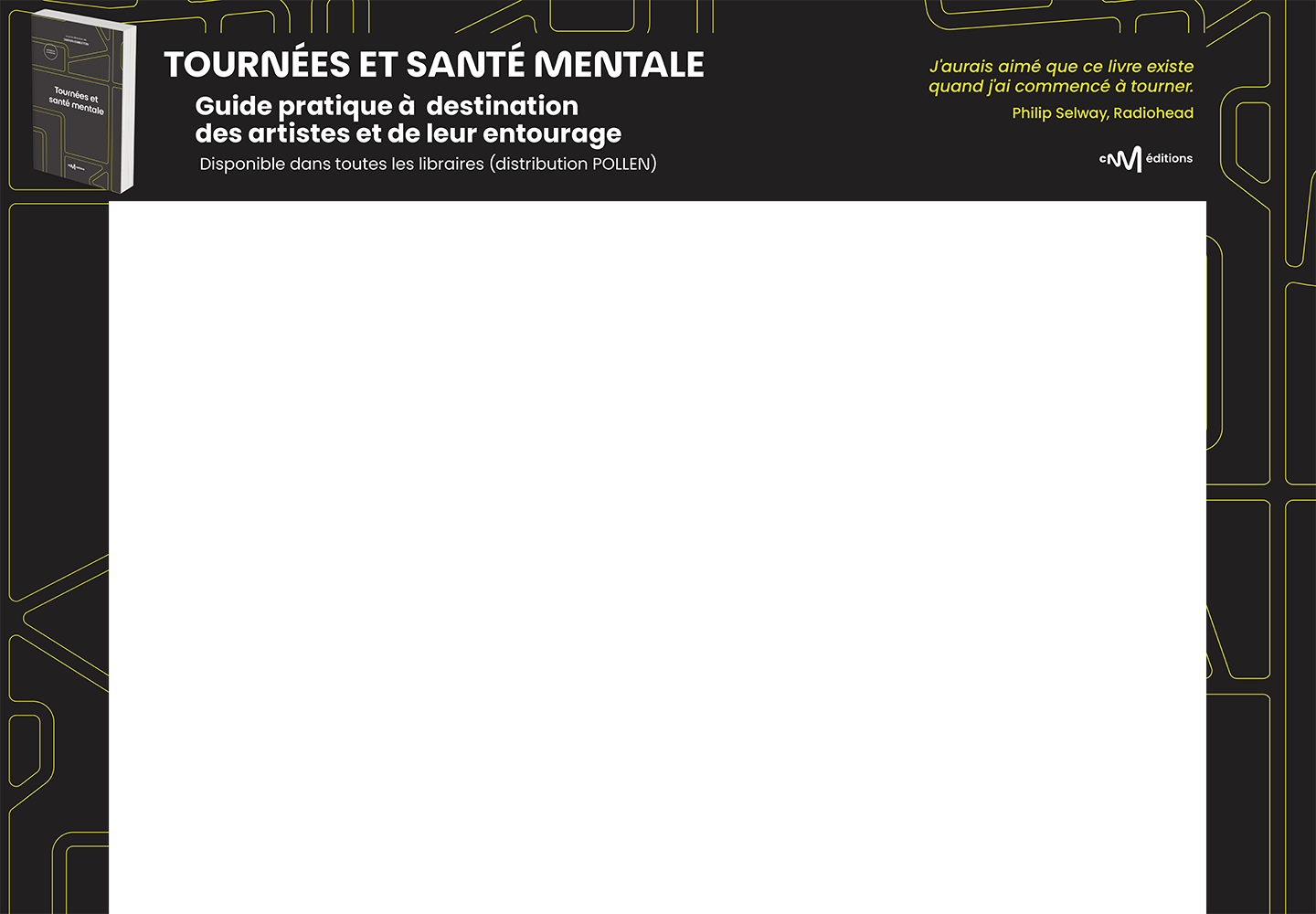Certains litiges ne souffrent aucun délai. Un préjudice irréparable menace, une situation devient intolérable : il faut agir vite. C’est le domaine de prédilection du référé, cette procédure d’exception qui permet d’obtenir une décision en quelques semaines, parfois en quelques jours. Mais cette célérité a un prix : le juge des référés ne peut intervenir que dans certains cas précis prévus par la loi, notamment lorsque la réponse s’impose avec évidence ou lorsque l’urgence commande une mesure provisoire. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-22.932) illustre parfaitement les limites de ce pouvoir.
Dans cette affaire, une société de pompes funèbres dénommée « Entraide funéraire » reprochait à sa concurrente, la « Société Service catholique des funérailles », d’utiliser le terme « catholique » dans son nom commercial. Elle y voyait une violation du principe de laïcité applicable au service public des pompes funèbres, constitutive d’un acte de concurrence déloyale. La demande était simple : interdire l’usage de cette dénomination. La Cour de cassation, par des motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d’appel, a rejeté cette prétention, estimant que le juge des référés ne pouvait trancher une question aussi complexe en urgence.
Le juge des référés ne peut se lancer dans des analyses juridiques approfondies
La réponse tient à la nature juridique de l’entreprise défenderesse, la « Société Service catholique des funérailles ». On sait que les principes de laïcité et de neutralité du service public, qui résultent de l'article 1er de la Constitution sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Pour autant, dans ce cas d’espèce, cette société n’était pas un service public délégataire, mais une société privée bénéficiant d’une simple habilitation préfectorale pour exercer son activité.
Certes, depuis la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur des pompes funèbre est qualifié de service public. Mais, selon le Code général des collectivités territoriales, ce service peut être assuré non seulement par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, mais aussi que par toute autre entreprise ou association bénéficiaire d’une habilitation préfectorale. Or, selon la loi du 24 août 2021, seuls les organismes auxquels la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public sont tenus au respect des principes de laïcité et de neutralité.
Cette distinction, bien que subtile, est essentielle. Le juge des référés statue sur l’urgence ou l’évidence, il ne peut se lancer dans des analyses juridiques approfondies, réservées au juge du fond. S’il est évident que les personnes privées délégataires d’un service public sont soumises au principe de laïcité, tel n’est pas le cas s’agissant, comme la « Société Service catholique des funérailles », d’une simple habilitation délivrée par l’autorité publique. Dès lors que cet assujettissement n’était pas certain, le trouble invoqué ne pouvait être qualifié de manifestement illicite, condition indispensable pour que le juge des référés intervienne.
Le référé n’est pas un raccourci pour éviter un procès au fond
Cet arrêt rappelle les conditions bien établies d’intervention du juge des référés. Le référé n’est pas un raccourci pour éviter un procès au fond : il suppose soit une urgence avérée, soit une réponse qui s’impose sans discussion possible. Or, le principe de laïcité ne s’applique pas uniformément à tous ceux qui touchent au service public.
En matière de concurrence déloyale, comme dans toute autre matière, le référé ne peut être utilisé que si la violation des règles apparaît avec une clarté absolue, ce qui exclut toute question juridique dont la réponse exige une analyse approfondie.
Entre célérité et précipitation, entre évidence et certitude, le juge des référés marche sur une ligne de crête. L’arrêt du 13 novembre 2025 montre qu’il doit savoir conserver son équilibre. Il doit être certain de savoir qu’il est certain de savoir, ou qu’il n’est pas certain de ne pas savoir.
La justice rapide n’est pas la justice expéditive : elle intervient sans attendre quand c’est nécessaire, elle tranche immédiatement quand la solution est évidente. Mais elle s’arrête au seuil de la complexité et laisse au juge du fond le soin d’explorer ce qui demande réflexion. Cette retenue n’est pas une faiblesse, c’est la condition même de sa légitimité.
Vincent Vigneau

Olivier Dion - Vincent Vigneau
Vincent Vigneau est magistrat depuis 1990 et président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation depuis 2023, après avoir été en poste en Normandie et en région parisienne, notamment à la cour d’appel de Versailles et au Tribunal de grande instance de Nanterre. Il est également membre du conseil de résolution de l’ACPR et préside le conseil de discipline des juges des tribunaux de commerce. Il a par ailleurs été professeur associé à l’université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines de 2001 à 2023. Il a coécrit plusieurs ouvrages juridiques et a publié en 2023, son premier roman, Les fleurs de lin (Les presses littéraires) dans lequel il raconte, à travers le personnage principal, son combat contre le cancer.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.