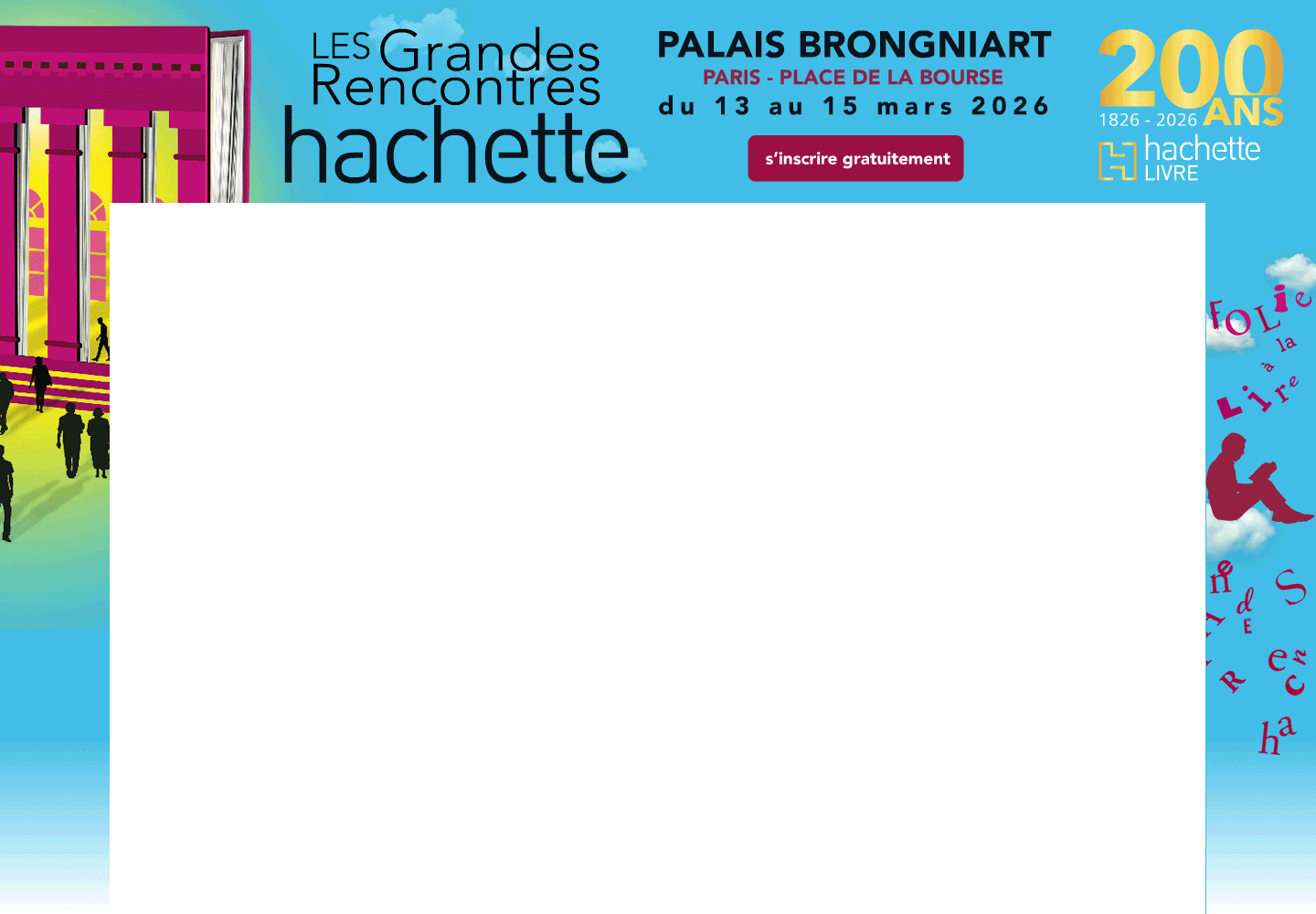Elle a pris tout le monde de court, Irene Vallejo. Cette romancière, philologue de formation, a été à l'origine de l'un des plus gros phénomènes de ventes que l'Espagne ait connu ces cinq dernières années. Avec L'infini dans un roseau, à paraître le 10 septembre aux Belles Lettres, elle a séduit des centaines de milliers de personnes. Les enchères se sont emballées en février 2020, deux mois après la parution de son livre en Espagne, avec des offres d'éditeurs de tous les recoins de la planète. Car cette histoire est bel et bien universelle : l'invention de l'écriture et des livres depuis la bibliothèque d'Alexandrie à Rome, en passant par Athènes. « Peut-être que la raison du succès réside dans le texte lui-même, a déclaré l'éditrice espagnole d'Irene Vallejo, Ofelia Grande, au quotidien El Pais en décembre 2020. C'est un équilibre parfait entre érudition et divulgation, ajouté à la passion de l'autrice qui le défend. Parvenir à approcher un éventail aussi large de lecteurs avec un essai sur l'histoire des livres semblait a priori une mission impossible. Cependant, l'accueil a été unanime. »
EXTRAITS
La Bibliothèque magique d'Alexandrie
« Dans un monde chaotique, acquérir des livres est un acte d'équilibrisme au bord de l'abîme. C'est à cette conclusion qu'arrive Walter Benjamin dans son splendide essai intitulé Je déballe ma bibliothèque. « Renouveler le vieux monde : tel est le plus profond désir du collectionneur quand il est poussé à acquérir de nouvelles choses », écrit-il. La Bibliothèque d'Alexandrie fut une encyclopédie magique qui rassembla le savoir et les fictions de l'Antiquité pour empêcher leur dispersion et leur perte. Mais elle fut aussi conçue comme un espace nouveau, duquel partiraient les routes vers le futur.
Les bibliothèques antérieures étaient privées et spécialisées dans les matières utiles à leurs propriétaires. (...) La Bibliothèque [d'Alexandrie NDLR] s'ouvrit au vaste monde extérieur. Incluant les œuvres les plus importantes en toutes langues, traduites en grec. Un commentateur byzantin écrivit sur cette période : « On recruta des savants de chaque peuple, lesquels, en plus de maîtriser leur propre langue, connaissaient à merveille le grec ; on confia à chaque groupe leurs textes respectifs et, de cette manière, on prépara une traduction de tous. » C'est ainsi que fut réalisée la version grecque connue de la Torah juive, dite la Septante. »
À Athènes : la naissance du commerce du livre
« Sur une tombe qu'on situe entre 430 et 420 av. J.-C. apparaît un jeune homme de profil, plongé dans les mots d'un rouleau qu'il déplie sur ses genoux, la tête légèrement inclinée, les jambes croisées au niveau des chevilles, exactement dans la position qui est la mienne au moment où j'écris. Sous le bas-relief qui représente la chaise, on distingue la forme d'un chien réfugié là, taillé dans la pierre usée. Le bas-relief reflète la quiétude des heures passées entre les livres. Cet Athénien aimait tellement la lecture qu'il l'emporta dans sa tombe.
Entre les Ve et IVe siècles av. J.-C., des personnages jusque-là inconnus sont mis en scène pour la première fois : les libraires. À cette époque, un nouveau mot, bybliopolai (« vendeurs de livres »), apparaît dans les textes des poètes comiques athéniens. D'après ce qu'ils nous racontent, des stands de vente de rouleaux littéraires s'installaient sur le marché de l'agora entre les étals proposant des légumes, de l'ail, de l'encens et des parfums. (...) On ne sait pas grand-chose sur le prix des livres. Le coût des rouleaux de papyrus suggère que la norme se situait entre 2 et 4 drachmes par exemplaire - l'équivalent du salaire journalier moyen d'un ouvrier. Les sommes élevées mentionnées des exemplaires rares - Lucien de Samosate parle d'un livre d'environ 750 drachmes - ne sont pas les prix normaux des livres ordinaires. Pour les élites, comme pour les plus modestes, les livres étaient une marchandise relativement accessible. »
Le papyrus comme moyen de lutte contre l'ennui
« Les papyrus montrent que beaucoup de Grecs sans fonction dans l'administration savaient lire et écrire, s'occupaient personnellement de leurs démarches, rédigeaient des documents commerciaux et répondaient à leur correspondance sans recourir à des scribes professionnels. Par ailleurs, ils lisaient pour le plaisir. Dans une lettre à un ami, un homme désœuvré écrit d'un village égyptien à la vie monotone : « Si tu as copié des livres, envoie-les-moi, afin qu'on ait quelque chose pour passer le temps, car ici on n'a personne à qui parler. » Oui, il y avait des gens qui cherchaient dans les livres une échappatoire à l'ennui rural. On a déterré des vestiges de ce qu'ils lisaient, des extraits de livres, voire des œuvres intégrales ; alors qu'on n'a pas retrouvé de papyrus dans l'humide Alexandrie, qui se vantait de posséder plus de lecteurs que n'importe quel autre lieu au monde. Néanmoins les fouilles des régions sèches nous permettent de fouiner dans les lectures de l'époque. Et si on se fie aux estimations basées sur le nombre de vestiges découverts de chaque œuvre, on peut même savoir quels étaient les livres préférés des lecteurs. »
À Rome, les premiers « SP »
« Promouvoir et diffuser la littérature étaient à la charge de l'écrivain - quand on pouvait se le permettre, comme Regulus - ou de ses protecteurs aristocrates - quand c'était un misérable étranger, comme cela arrivait souvent. Il y avait, bien sûr, des personnes qui désiraient lire un livre récent mais ne connaissaient pas personnellement l'écrivain et, par conséquent, ne figuraient pas sur ses listes d'envoi. Dans ce cas, la seule solution était de recourir à quelqu'un qui, en revanche, était dans le circuit, et de commander une copie de son exemplaire. Dès que l'auteur commençait à « distribuer » une nouvelle œuvre, on considérait le livre dans le domaine public et n'importe qui avait le droit de le reproduire. Le verbe latin qu'on traduit aujourd'hui par « éditer » - edere - avait en réalité une signification plus proche de « donation » ou « abandon ». Il impliquait d'abandonner l'œuvre à son sort. Il n'existait rien de semblable, même de loin, aux droits d'auteur ou au copyright. Dans toute la chaîne du livre, seul recevait une rétribution directe, à la ligne, celui qui réalisait la copie (en supposant que ce ne fût pas un esclave domestique), comme celle que prennent aujourd'hui, à la page, les magasins de photocopies. »