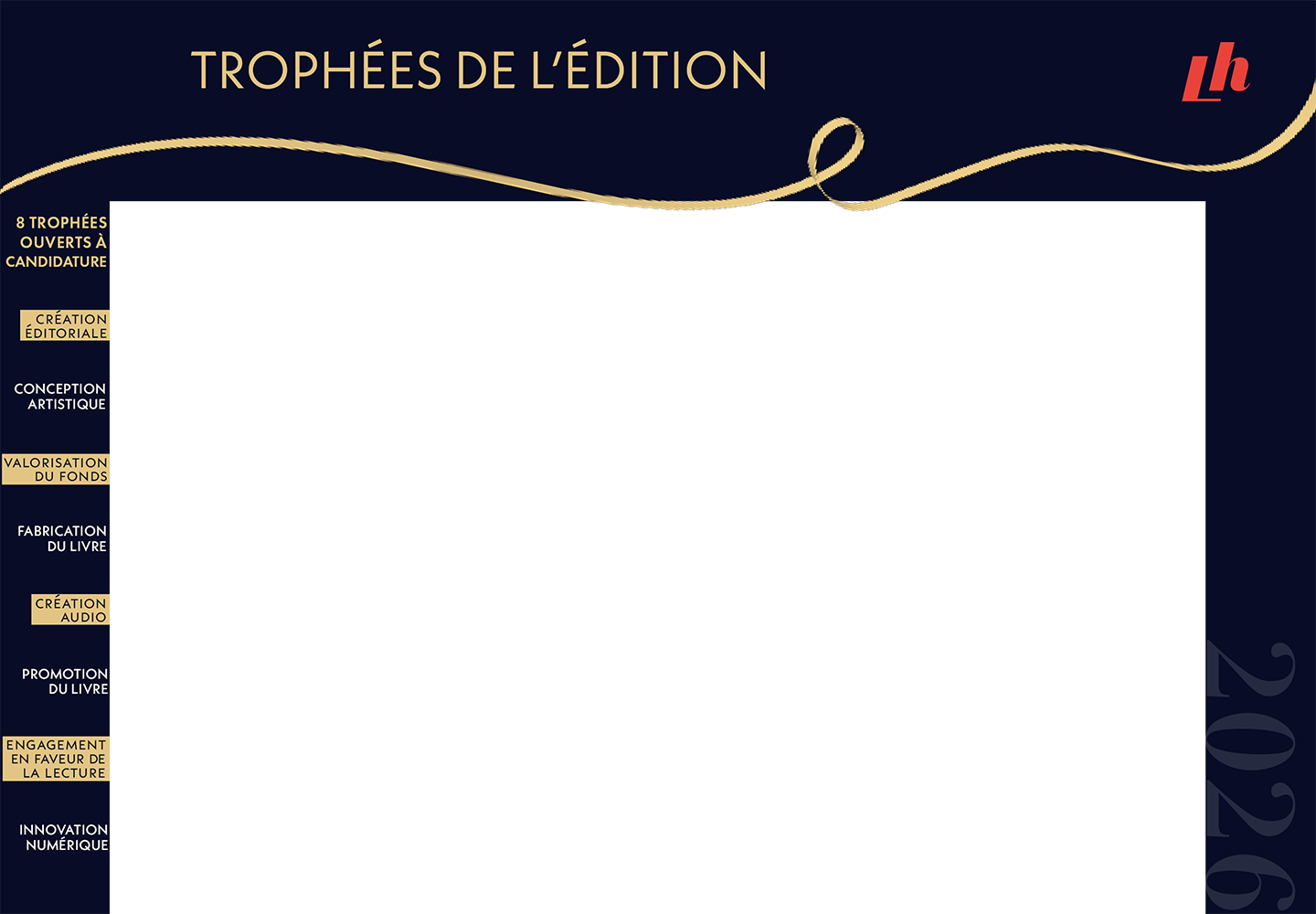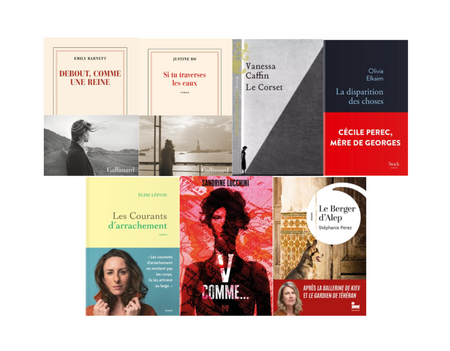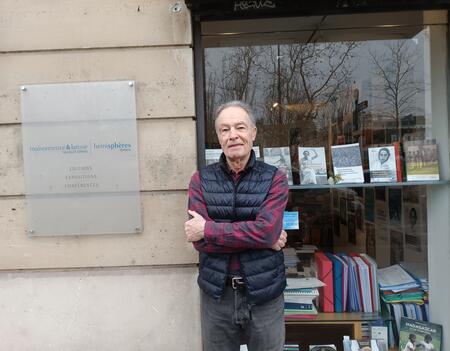Pour ses 38e journées d’études annuelles, l’Association des bibliothécaires départementaux a comptabilisé 233 personnes inscrites le lundi 22 septembre, venant de 59 bibliothèques départementales de France métropolitaine et d’Outre-mer (ainsi que de Belgique), mais aussi de la Bpi, du ministère de la Culture, de l’Enssib, d’Agence du livre et de la lecture…
Lire aussi : Journées 2025 de l’ABD : « Le rôle principal des bibliothèques est de créer les conditions du débat »
Tous rassemblés autour de cette question : comment les bibliothèques peuvent accompagner voire déclencher le changement vers un monde plus équitable ?
Le grand déni
Déclencher, car la population a tendance à l’inertie, remarque Raphaël Besson, docteur en Sciences du territoire, cofondateur du Laboratoire d'Usages Culture(s) Arts Société (Lucas), qui a édité Pour une culture des transitions.
« Les rapports scientifiques racontant l’effondrement du monde ont beau s’accumuler, cela n’a pas eu d’effet mécanique sur l’évolution des individus et des politiques publiques ! », interpelle le chercheur. Il faut dire que les acronymes (ZFE, ZAN, DPE) déployés par l’État ne parlent pas aux citoyens…
Mais la faute est aussi à « la fascination malsaine autour de la puissance technologique ». La pensée, par exemple, que l’IA va résoudre nos problèmes sociaux. Or elle en crée, en nécessitant des travailleurs du clic et des serveurs hautement énergivores. Autre exemple de désir incompatible avec l’intérêt général : celui, porté par 84% des Français, d’avoir leur maison individuelle avec jardin.
Changer les imaginaires
Il faut donc remplacer ces imaginaires par d’autres. Problème, relève Stéphan Dégeorges, directeur du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de Haute-Savoie : il faut collectivement dessiner un avenir désirable, lutter d’une voix commune contre le désenchantement. « Si on met chacun face au réchauffement climatique, on n’y arrivera pas. Mais si on a une vision et différentes étapes pour y arriver… »
La journée d’étude de l’ABD du 22 septembre résumée en fresque par Pascale Merle.- Photo FANNY GUYOMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
La force des bibliothèques
C’est là qu’interviennent les bibliothèques, en inscrivant leur engagement dans leur projet d’établissement (PCSES), à l’aide de ressources nationales pour gagner en efficacité. Et en se formant à des méthodes de travail qui permettent de sortir des idéologies dépassées, esquisse Raphaël Besson. Comme le benchmark, qui s’inscrit dans une pensée capitaliste en invitant à se mesurer à ses concurrents.
Les points forts des bibliothèques : ce sont des lieux hybrides, malléables, fréquentés, de surcroît par une diversité de personnes. Arrosez le tout de romans et de débats qui nous forcent à l’altérité, et le tour est joué.
À cette condition : « Dépasser les oppositions binaires et apprendre à habiter le gris », pointe Raphaël Besson, mentionnant l’ouvrage Gris, une théorie politique des couleurs de Peter Sloterdijk (Payot). « Ça ne veut pas dire être neutre. Le gris n’est pas non coloré ou indécis. » C’est la couleur des ombres nuancées.
Comment rendre le livre vert(ueux) ?
Déjà, ne pas parler de « vertu », de « bien » ou de « mal », mots qui ne sont pas mobilisateurs, introduit Fanny Valembois, consultante au Bureau des acclimatations sur les enjeux énergie-climat pour les organisations culturelles. À la place, souligner les conséquences d’un non-changement. Dire par exemple que si le coût des énergies devient insupportable, les bibliothèques devront fermer, les éditeurs augmenter le prix des livres…
Un levier : se former aux questions de l’écologie. Il existe par exemple des formations à l’accompagnement au changement : savoir parler aux équipes qui résistent face au changement, et cela peut se comprendre !
Mais « quand les formations deviennent plus pointues, elles ont du mal à se remplir », observe la consultante. Et les formateurs sont en nombre insuffisant. C’est pourquoi il est nécessaire de mutualiser les compétences à l’échelle d’une intercommunalité ou d’un département. Le collectif R2D2 aide sinon à organiser des manifestations écoresponsables.
Ensuite, mesurer les choses, l’empreinte carbone de la bibliothèque par exemple.
Et enfin, « changer ! ». « Monter sur la balance ne fait pas changer de poids ». Tout en étant un peu ambitieux : « "Ce livre a été imprimé sur un papier certifié", c’est la base, l’équivalent de "un enfant n’a pas travaillé dans une mine pour fabriquer ce produit !" »
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Convaincre les « puissants »
Mais les bibliothèques accueillent-elles vraiment tout le monde ? Pas le magnat au pouvoir qui veut fermer les bibliothèques, ce qui a fait l’objet d’un atelier consistant à imaginer des mesures pour le contrecarrer. Comme le signale Stéphan Dégeorges, « quand vous faites une concertation publique, vous avez le risque de mettre de côté les gens mal à l’aise avec l’expression publique : les personnes précaires et l’élite ». Les bibliothécaires iront donc directement les chercher dans leurs milieux socio-économiques.
Atelier en groupe proposé par l’ABD : sauver la bibliothèque d’une fermeture forcée par un décideur politique.- Photo FANNY GUYOMARDPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Et pour convaincre les élus politiques qui octroient les financements, y aller à plusieurs structures défendant le même horizon commun et proposant deux ou trois pistes pour l’atteindre, conclut-il.
Budgets à la peine et réponses du ministère
Les contraintes budgétaires reviennent fréquemment dans les discussions informelles. Ici, un départ à la retraite ne sera pas remplacé. Là, une bibliothèque communale ne remplace pas son agent par un autre, donc se reporte sur un bénévole. Ailleurs, un agent de catégorie B prendra la place d’une conservatrice partant à la retraite… Mais la palme revient peut-être au Département qui n’a versé que 25% du budget signé pour 2025 à sa bibliothèque.
Lucie Daudin, cheffe du bureau de la lecture publique du ministère de la Culture, a donc réitéré le discours tenu par Jérôme Belmon, chef du département bibliothèques du ministère, l’année dernière : « Les départements constituent un partenaire privilégié de l’Etat ».
En 2025, plus d’une dizaine de contrats départementaux lecture auront été signés grâce à l’enveloppe de 800 000 euros supplémentaires par rapport à 2024.
Les départements sont également prioritaires pour bénéficier du programme Premières pages. Fin 2024, 59 départements y étaient intégrés.
Quant à l’idée d’une plateforme de ressources numériques nationales permettant de faire des économies d’échelle, elle avance petit à petit. La Bpi se penche sur le sujet, et l’association Images en bibliothèques a lancé un questionnaire sur l’audiovisuel en lecture publique. En attendant une éventuelle concrétisation (« qu’on attend depuis dix ans », glisse un bibliothécaire), la bibliothèque de l’Isère a présenté la librothèque, un blog regroupant des ressources gratuites du web qu’elle développe avec la bibliothèque départementale des Côtes d’Armor et toutes les volontaires. « Il n’y a pas forcément besoin de sortir le chéquier pour proposer des choses intéressantes ! »