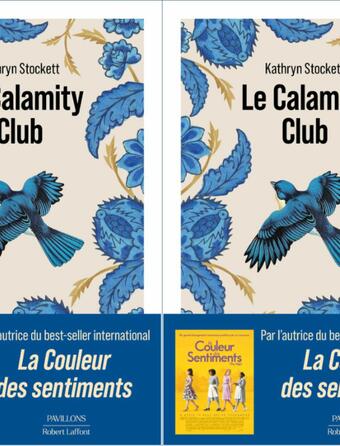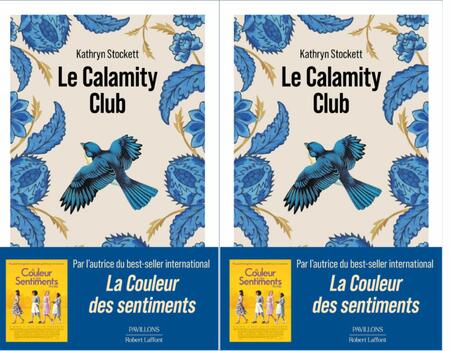Là-bas, chez nous. Depuis toute petite, elle entendait cette expression revenir dans la bouche des «vieux» de sa famille. «A la ferme», ajoutaient-ils. Anne Plantagenet qui n’avait jamais connu ses grands-parents ailleurs qu’à Dijon savait qu’il ne s’agissait pas d’une ferme en Bourgogne ou dans une autre région. L’ailleurs, le chez nous qu’ils revisitaient sans cesse dans leurs conversations, était à Misserghin en Algérie, près d’Oran. Anne Plantagenet a vécu dans l’exil par procuration de sa famille paternelle. L’auteure, née en 1972 dans l’Yonne et qui a grandi en Champagne, a longtemps porté cette autre rive de la Méditerranée en elle. Comme une peau avec laquelle il faut bien vivre et dont il faudra sans doute un jour se départir pour muer.
Dans une atmosphère de bougie parfumée, avec son piano, entourée de bouquins et de dessins d’enfants, dans cet appartement clair du 9e arrondissement de Paris, la traductrice de Lucía Puenzo, David Trueba ou encore Ildefonso Falcones (elle est l’auteure d’une vingtaine de traductions de l’espagnol) nous accueille entre plusieurs projets - elle réalise un documentaire sur Emmanuel Carrère. En janvier paraît Trois jours à Oran, récit d’un voyage en Algérie avec son père «né là-bas» et «rapatrié» à 16 ans et qui n’avait pas foulé le sol natal depuis plus de quarante ans. Son huitième livre - elle débute en 1998 avec un roman Un coup de corne fut mon premier baiser publié aux éditions Ramsay - et son premier sur ce pays des racines rêvées. Et pourtant l’Algérie n’a cessé de l’obnubiler. L’Espagne, l’Andalousie, avait été par les livres une manière de se rapprocher de la Méditerranée et de cette terre pleurée de la mythologie familiale. Même Nation Pigalle (Stock, 2009, sortie concomitante chez J’ai lu), son roman choral sur le tourbillonnant quartier du haut 9e, contient un chapitre sur l’Algérie. Mais l’Algérie en tant que livre, jamais. Longtemps elle a été «le livre impossible» : «J’ai toujours voulu écrire sur l’Algérie, ce roman algérien, je savais que je devais l’écrire. Longtemps, j’ai cherché comment. J’avais envoyé plusieurs manuscrits qui ont tous été refusés.» Trop d’affects et de confusion, sans doute. L’Algérie, pour Anne Plantagenet, c’est avant tout sa grand-mère, Antoinette Montoya, qu’elle adorait, femme haute en couleur avec son renard et ses sourcils épilés, qui parlait de Misserghin comme d’un éden perdu et dont le verbe magnifiait le passé colonial de petits fermiers somme toute modestes… L’Algérie pour elle, c’est enfin de se retrouver par atavisme, ou plutôt de refuser de l’être par conviction, du mauvais côté de l’histoire. Cette origine méditerranéenne de honte mêlée - ces pieds-noirs, caricaturés et aussi caricaturaux, larmoyants, racistes, regrettant l’Algérie française, soutenant jusqu’au bout l’OAS…
Images d’archives
«Du côté de ma mère, c’était plus simple. Son père était un ouvrier italien communiste et antifasciste.» Anne Plantagenet se souvient des tensions pas toujours sourdes à l’adolescence, quand elle formait ses propres convictions et arborait la main de Touche pas à mon pote. Mais la complexité du réel vous rattrape. Aussi quand passent des images d’archives de ces familles entassées, embarquant dans la panique pour la métropole, comment être indifférente ? Et l’auteure de Trois jours à Oran d’avouer : «Et malgré tout ce qui peut m’horripiler chez les pieds-noirs et fait que lorsque le gouvernement français admet peu à peu les exactions et les crimes qui ont été commis pendant la guerre d’Algérie par les autorités républicaines, et que les journalistes s’empressent d’annoncer que “bien sûr les rapatriés s’insurgent”, je me désolidarise totalement d’eux, ces images de l’exil me font pleurer et je scrute au ralenti les visages un à un, cherchant quelqu’un que je connais.»
Elle n’a pu aller en Algérie qu’en 2005. Il aura fallu que l’aïeule adorée meure en 2003, suivie du grand-père l’année suivante. «Je ne me sentais pas assez courageuse pour confronter ma vision de l’Algérie avec la leur. C’est leur mort quim’a donné l’impulsion pour le voyage et le livre.»
2003 : péril en la demeure. Au moment où sa grand-mère fait une chute qui provoquera son déclin et sa fin, Anne Plantagenet rencontre P., «l’homme qui n’est pas [son] mari», et en tombe passionnément amoureuse. Mariée, mère d’un enfant de deux ans, tout tremble sur les fondations d’une existence qu’elle avait crue solidement arrimée. Trois jours à Oran est l’histoire d’une fille qui retourne dans le pays où est né et a grandi son père. Portrait du père, des grands-parents. Livre du traumatisme du déracinement, il est aussi le récit d’un amour dévorant qui vous révèle. Le plus dur est de s’affranchir. Cette narration à double hélice, fluide et pudique, Anne Plantagenet a mis huit ans à l’écrire. Sean J. Rose
Trois jours à Oran, Anne Plantagenet, Stock, 120 p., 17 euros, parution le 3 janvier, ISBN : 978-2-234-07090-5.