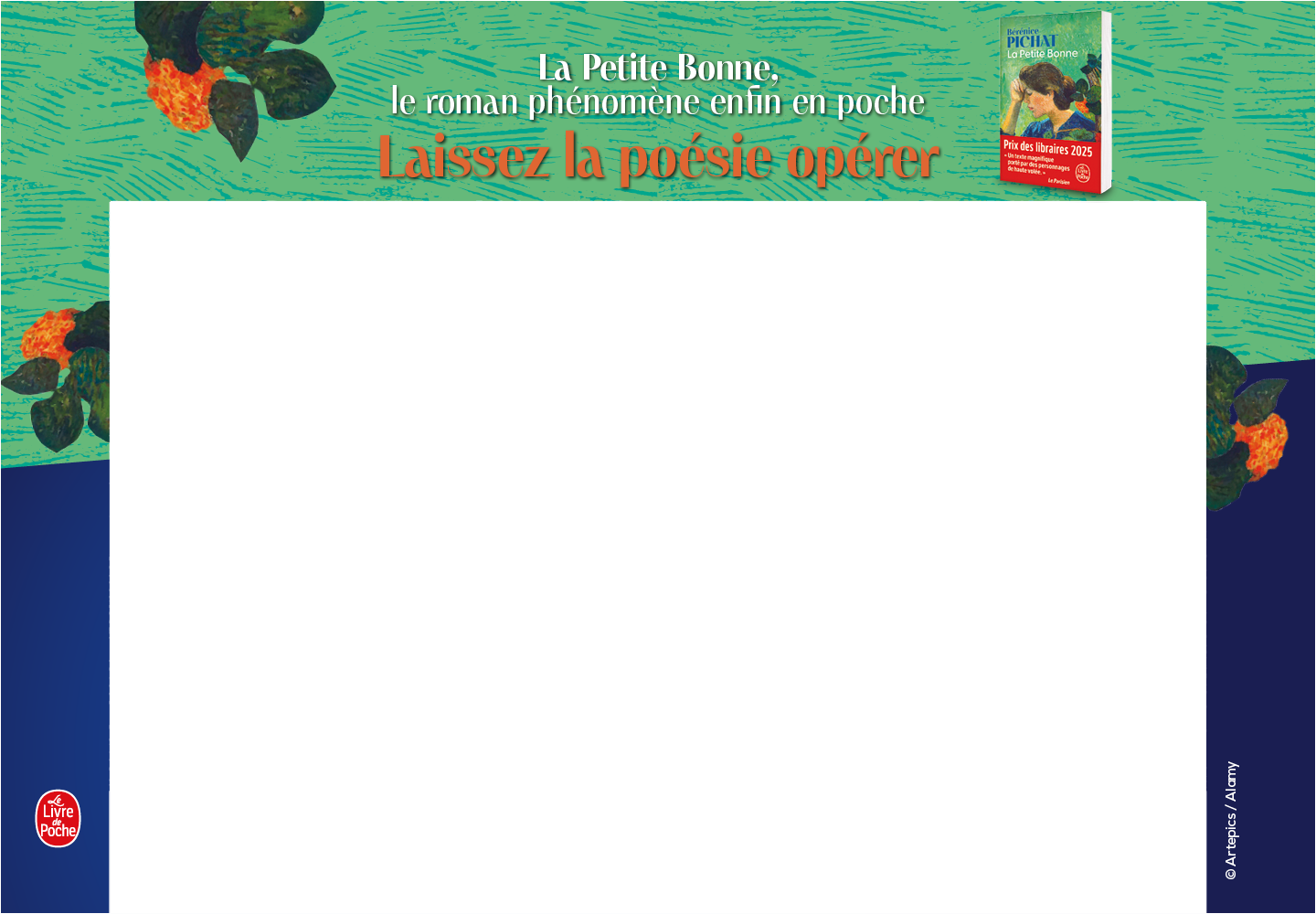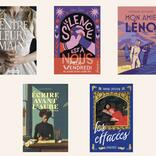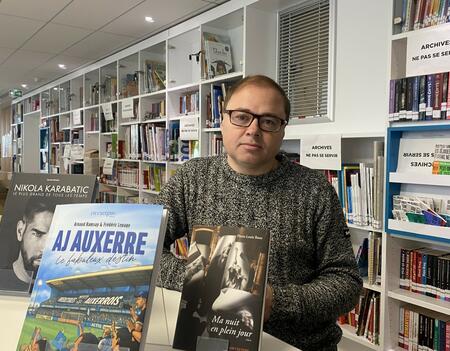Le monde du livre se dote d’un nouvel outil de dialogue entre auteurs et éditeurs. Le 6 novembre s’est déroulée l’assemblée constitutive de l’Association de médiation des auteurs et des éditeurs de livres (Amael). Autour de la table étaient rassemblées plusieurs organisations représentatives des auteurs, la Société des Gens de Lettres (SGDL), le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), la Société des auteurs de jeux (SAJ), l’ADAGP, la Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe (SAIF) et la Société civile des auteurs multimédia (Scam), ainsi que le Syndicat national de l’édition (SNE).
Une instance issue d’un long travail interprofessionnel
L’Amael est le résultat de plusieurs années de discussions interprofessionnelles, amorcées en 2014 lors de la réforme du contrat d’édition intégrant les œuvres numériques. Ces débats, souvent marqués par des tensions sur la rémunération des auteurs et la transparence des éditeurs, avaient conduit le ministère de la Culture, sous la direction de Roselyne Bachelot, à désigner Pierre Sirinelli, professeur de droit privé, comme médiateur en 2021 puis en 2022.
À l’issue de ces négociations, un accord avait été signé en décembre 2022, aboutissant à quelques avancées comme la publication semestrielle des comptes des éditeurs ou l’amélioration de la périodicité des paiements et l’obligation de communiquer les informations relatives aux sous-cessions. Mais cet accord avait déjà suscité des réserves, notamment du Conseil permanent des écrivains (CPE) et de la Ligue des auteurs professionnels, absents aujourd’hui de cette nouvelle structure.
La création de l’Amael était attendue de longue date. Elle figurait dans la feuille de route de la loi sur l’accord d’édition signée en 2014.
Une triple mission de médiation
L’Amael repose sur trois objectifs principaux : faciliter le règlement amiable des litiges entre auteurs et éditeurs ; identifier les causes les plus fréquentes de conflits, en publier chaque année un rapport et proposer des pistes de solution ; et enfin permettre la révision des conditions d’exploitation numérique des œuvres, comme le prévoit l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le SNE.
Si les statuts de l’association ont été déposés, l’instance ne sera pleinement opérationnelle qu’en 2026, avant la fin du premier semestre espèrent ses fondateurs. D’ici là, des médiateurs indépendants seront sélectionnés et formés. Leur nombre n'est pas encore déterminé. Tous les auteurs et éditeurs pourront saisir cette instance en cas de conflit sur un contrat d’édition, même sans être affiliés à une organisation signataire.
L'objectif est de régler rapidement les litiges soulevés. Julien Chouraqui évoque un délai traitement raisonnable. « On ne peut pas laisser des différends s'éterniser, souligne-t-il. Trois mois pour aboutir à un résultat serait un bon délai. C’est ce vers quoi nous allons tendre. »
Participation financière
Le recours à la médiation nécessite une participation financière de 150 euros, ce que ne souhaitaient pas les organisations représentatives des auteurs. Estimant le dispositif inadapté, la Ligue des auteurs professionnels a par exemple décidé de se retirer du projet, ainsi que, entre autres, l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF). « Cette participation de 150 euros nous paraît hors sol, justifie Stéphanie Le Cam, directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels interrogée par Livres Hebdo. Nous avons déjà une permanence juridique efficace, et la plupart des litiges que nous traitons ne justifient pas un tel investissement. Les demandeurs sont majoritairement des auteurs, souvent précaires. »
Au SNE, Julien Chouraqui défend le principe de la participation financière. « Elle permet de s’assurer de la volonté de chacun de participer pleinement à la médiation, assure-t-il. Dans tout processus, l’engagement personnel est plus fort dès lors qu’il y a une dimension pécuniaire. C’est une dimension psychologique qu’il ne faut pas ignorer. »
Les éditeurs indépendants absents
Au-delà de la question financière, d’autres critiques portent sur la gouvernance de l’Amael. La Ligue des auteurs professionnels regrette notamment l’absence du Syndicat des éditeurs alternatifs (SEA) et de la Fédération des éditions indépendantes (Fedei).
Un constat partagé par la SGDL. Également interrogé par Livres Hebdo, son directeur général Patrice Locmant rappelle que « dans la majorité des cas, les auteurs viennent de petites ou moyennes maisons, souvent absentes de ces instances de négociation ». La société regrette elle aussi la non-gratuité des médiations. Pour autant, malgré ces réserves, elle compte bien parmi les signataires et préfère « agir de l’intérieur ».