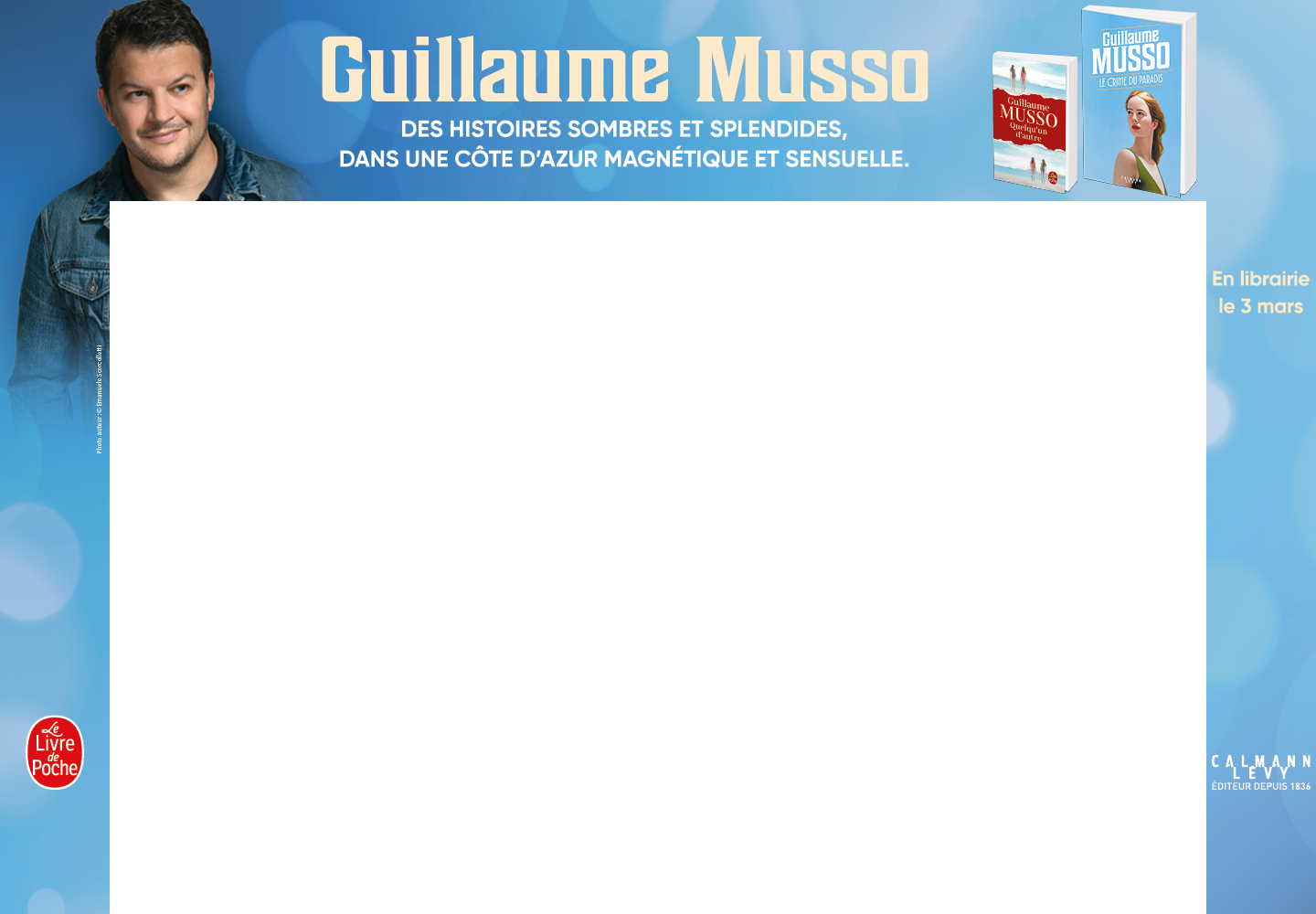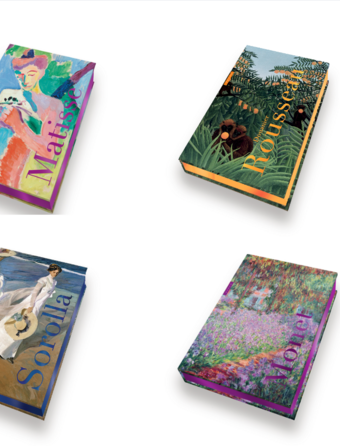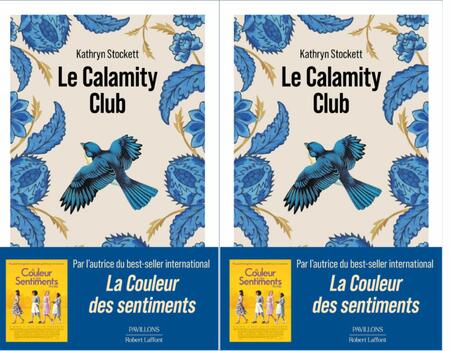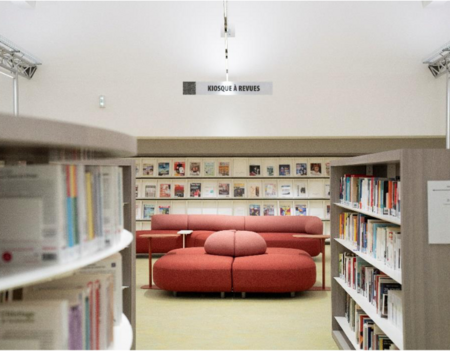Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Jusqu'alors, ce type de sujet sensible était l'apanage des Anglo-Saxons. Jusqu'alors, sur les tirailleurs sénégalais, on ne disposait que de l'étude de Myron Echenberg, de l'université McGill à Montréal, traduite en 2009 chez Karthala. Et puis Julien Fargettas vint. Cet officier dans l'armée de terre s'est imposé en quelques années comme un spécialiste de l'histoire des "coloniaux". A 36 ans, après plusieurs articles dans des revues spécialisées, il publie à destination du grand public un ouvrage important tiré de sa thèse de doctorat.
Dans ce livre, Julien Fargettas a réuni une quantité impressionnante de documents pour raconter, par le menu, l'histoire de ce corps créé sous le second Empire, en 1857, et dissous après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'est la Grande Guerre qui change son image exotique et lointaine puisqu'il intervient dans les tranchées, en première ligne, au milieu des poilus.
Après le traité de Versailles, les troupes d'occupation françaises dans la Rhénanie et dans la Ruhr sont en partie constituées de coloniaux. Les Allemands protestent avec une rare violence xénophobe contre ceux qu'ils qualifient de "honte noire". Mais c'est surtout pendant la Seconde Guerre mondiale que les tirailleurs interviennent massivement, d'abord en 1940, puis en tant que force d'appoint lors de la libération de la France.
Julien Fargettas raconte la vie quotidienne de ces soldats, leur recrutement entre 1939 et 1940 (plus de 100 000), leurs statuts, leurs religions, leur alimentation, les maladies dont ils souffraient, les relations conflictuelles avec les autres troupes coloniales du Maghreb, les exactions commises avec les coupe-coupe, jusqu'aux fantasmes sur leur sexualité en relation avec un racisme toujours latent envers ces hommes considérés comme de "grands enfants".
On apprend ainsi qu'une division SS exécuta 51 tirailleurs en juin 1940 dans la région lyonnaise et que les nazis se livrèrent sur ces soldats noirs à des expériences épouvantables dans un hôpital colonial en Gironde.
L'historien revient aussi sur le massacre de Thiaroye, le 1er décembre 1944. C'est là, non loin de Dakar, que les gendarmes français et les troupes coloniales firent feu sur les tirailleurs qui manifestaient pour obtenir le paiement de leur solde. Bilan, 35 morts et un ressentiment lourd à l'égard d'un pays qu'ils ont servi loyalement. S'engage alors, après la décolonisation, une lutte pour faire reconnaître leur statut d'anciens combattants et le versement des pensions.
Doctorant à l'université d'Aix-Marseille (au Centre d'histoire militaire comparée de l'IEP d'Aix-en-Provence), Julien Fargettas poursuit ses recherches sur cette histoire finalement moins oubliée que méconnue. Avec cet ouvrage, il a déjà réussi une étude de référence qui a le double mérite de combler une lacune importante de notre passé colonial et de rendre hommage à la mémoire de ces combattants morts pour la France.