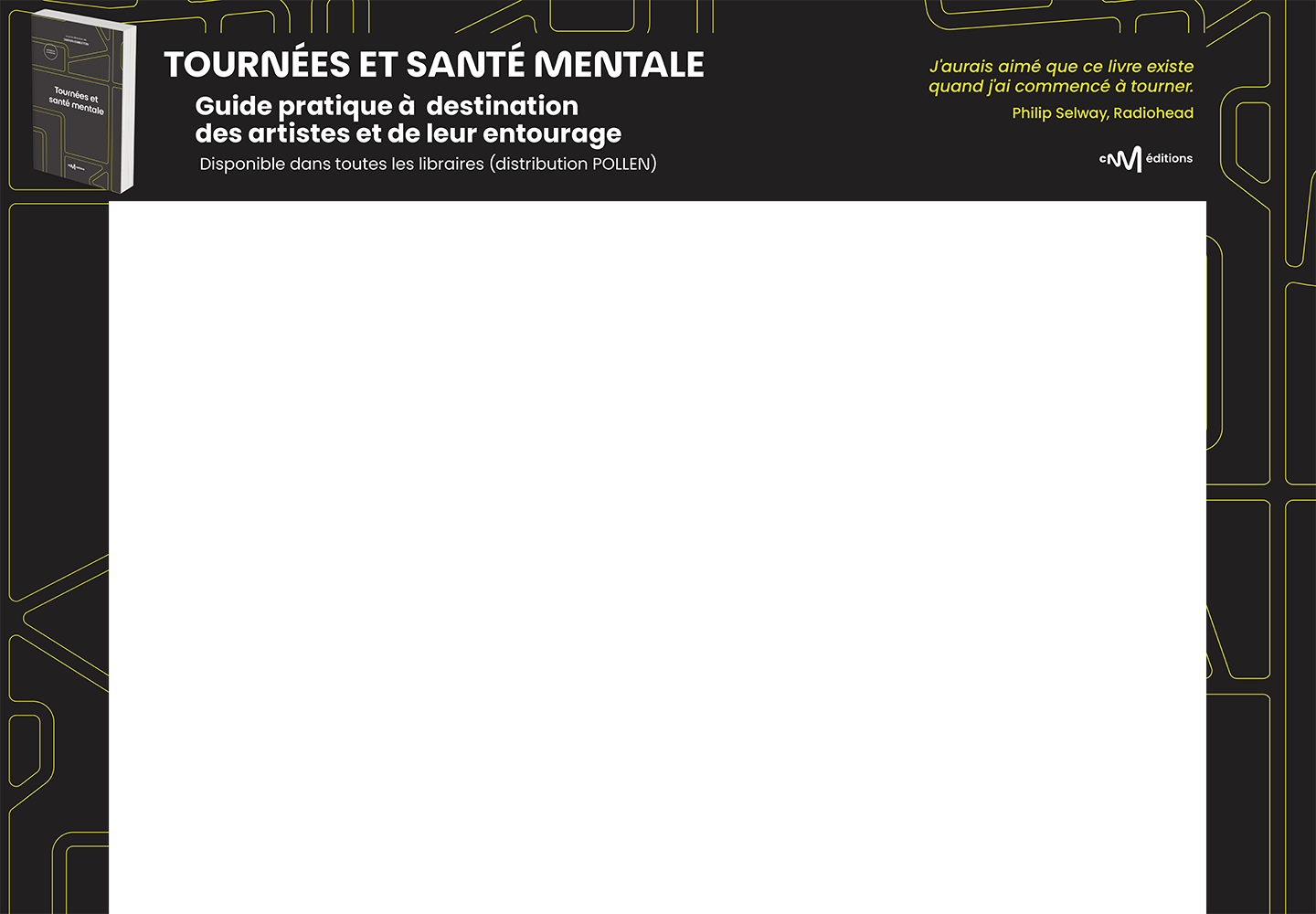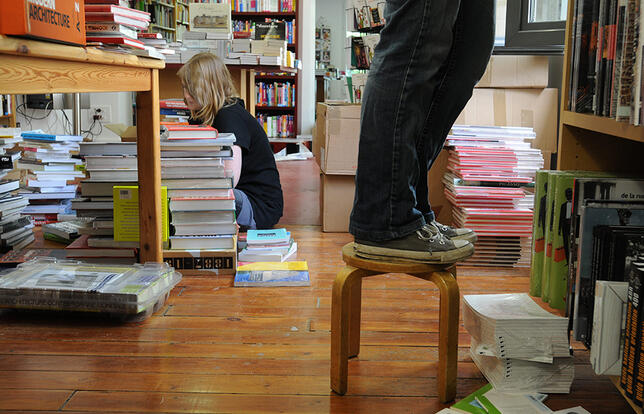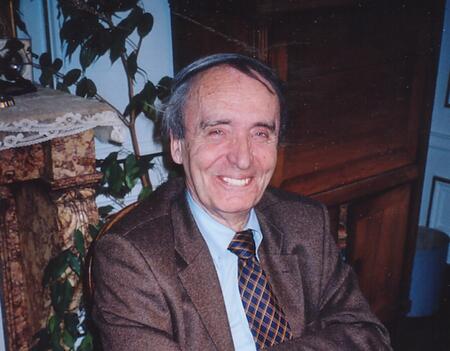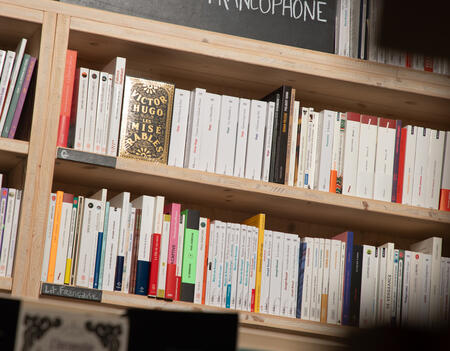Le litige opposait une librairie à l'une de ses salariées, qui avait été recrutée en avril 2016, promue en 2018, et était titulaire d'un mandat de membre suppléante du Comité Social et Économique (CSE) depuis le 1er octobre 2019.
L'employeur avait sollicité l'autorisation de licencier sa salariée protégée, comme l’exige la réglementation, pour inaptitude le 10 mars 2022. Il avait été opposé un double refus de l'administration : une décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail et une décision expresse du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, substituant la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Saisie par l’employeur, le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 13 juin 2024, avait annulé les décisions de refus de l'inspecteur du travail et du ministre ; la salariée protégée avait interjeté appel.
La Cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt important relatif aux conditions de licenciement des salariés titulaires d'un mandat représentatif, annulant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande de l'employeur (Cour administrative d'appel, Lyon, 5e chambre, 16 octobre 2025 – n° 24LY02350). La Cour a confirmé l'illégalité du licenciement pour inaptitude de la salarié libraire, membre suppléante du CSE, en considérant que l'inaptitude était directement liée aux obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives.
Les conditions du licenciement d’une salariée protégée
Les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. En matière de licenciement pour inaptitude des salariés protégés, l'autorité administrative (inspecteur du travail ou ministre) doit contrôler si l'inaptitude justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi, des règles du contrat, des exigences du mandat, et de la possibilité de reclassement.
Cependant, il est impératif que l'administration fasse obstacle à tout licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Ainsi, l'administration doit refuser l'autorisation si l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives.
Une chronologie défavorable à l’employeur
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour a analysé la chronologie des événements, notant qu'avant le 1er février 2021, la libraire salariée ne présentait aucun antécédent disciplinaire et avait même bénéficié d'une promotion en 2018. Mais, la Cour a retenu qu'à la suite d’un courriel du 1er février 2021, rédigé par la salariée protégée dans le cadre de son mandat de suppléante du CSE concernant les rémunérations du dimanche, l'employeur avait réagi par un courriel du 3 février 2021 en la mettant uniquement elle en cause.
L'employeur avait estimé inapproprié le rappel du droit du travail applicable, alors que ce rappel ne relevait que des fonctions de membre du CSE, en lui reprochant de « fragiliser la confiance réciproque » et de nuire au bon fonctionnement de la société. Le 8 février 2021, la salariée recevait un avertissement pour des faits antérieurs qu’elle contestait. La Cour a jugé que le ton choisi par l'employeur et les termes utilisés dans l'avertissement étaient disproportionnés et dénigrants, même en admettant que le comportement de la salariée n'ait pas été exempt de tout reproche.
Par la suite, l'employeur insistait à plusieurs reprises pour conclure une rupture conventionnelle avec la salariée protégée, y compris après son arrêt de travail. La Cour a considéré que cette proposition réitérée, accompagnée de formules insistantes (« la balle est dans ton camp », « tu as le choix, rester ou quitter »), devait être vue comme un acte de pression de l'employeur.
Inaptitude liée aux pressions
L'état de santé de la salariée protégée, qui n'avait aucun antécédent psychiatrique, s'est dégradé à la suite de l'avertissement du 8 février 2021, conduisant à un arrêt de travail à partir du 1er mars 2021 et finalement à un avis d'inaptitude totale le 17 janvier 2022. La Cour s'est donc appuyée sur les éléments médicaux, y compris le certificat du psychiatre évoquant une « insomnie presque totale », une « angoisse à la prise de poste » et l'impossibilité d'une reprise d'activité dans l'entreprise sans risque pour sa santé.
Un rapport de juin 2021 faisait état d'un « management vécu agressif », d'un « burn-out » et d'un « vécu de harcèlement ». À la lumière de ces faits, la Cour a jugé que l'origine professionnelle de la dégradation de l'état de santé de la salariée protégée était établie et que l’employeur avait fait obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives, entraînant la dégradation de sa santé jusqu'à l'inaptitude.
La protection exceptionnelle comme bouclier juridique
Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des refus d'autorisation de licenciement. Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel la protection du salarié mandaté n'est pas levée par la seule constatation d'une inaptitude, si celle-ci trouve sa source dans des agissements de l'employeur visant à entraver ou sanctionner l'exercice normal des fonctions représentatives.
Le lien entre l'entrave au mandat et l'atteinte à la santé psychique de la salariée a été la clé du maintien des refus administratifs. La protection exceptionnelle agit comme un bouclier juridique, s'étendant non seulement aux actes de représentation eux-mêmes, mais aussi aux conséquences pathologiques que l'entrave à ce mandat peut générer.
Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.