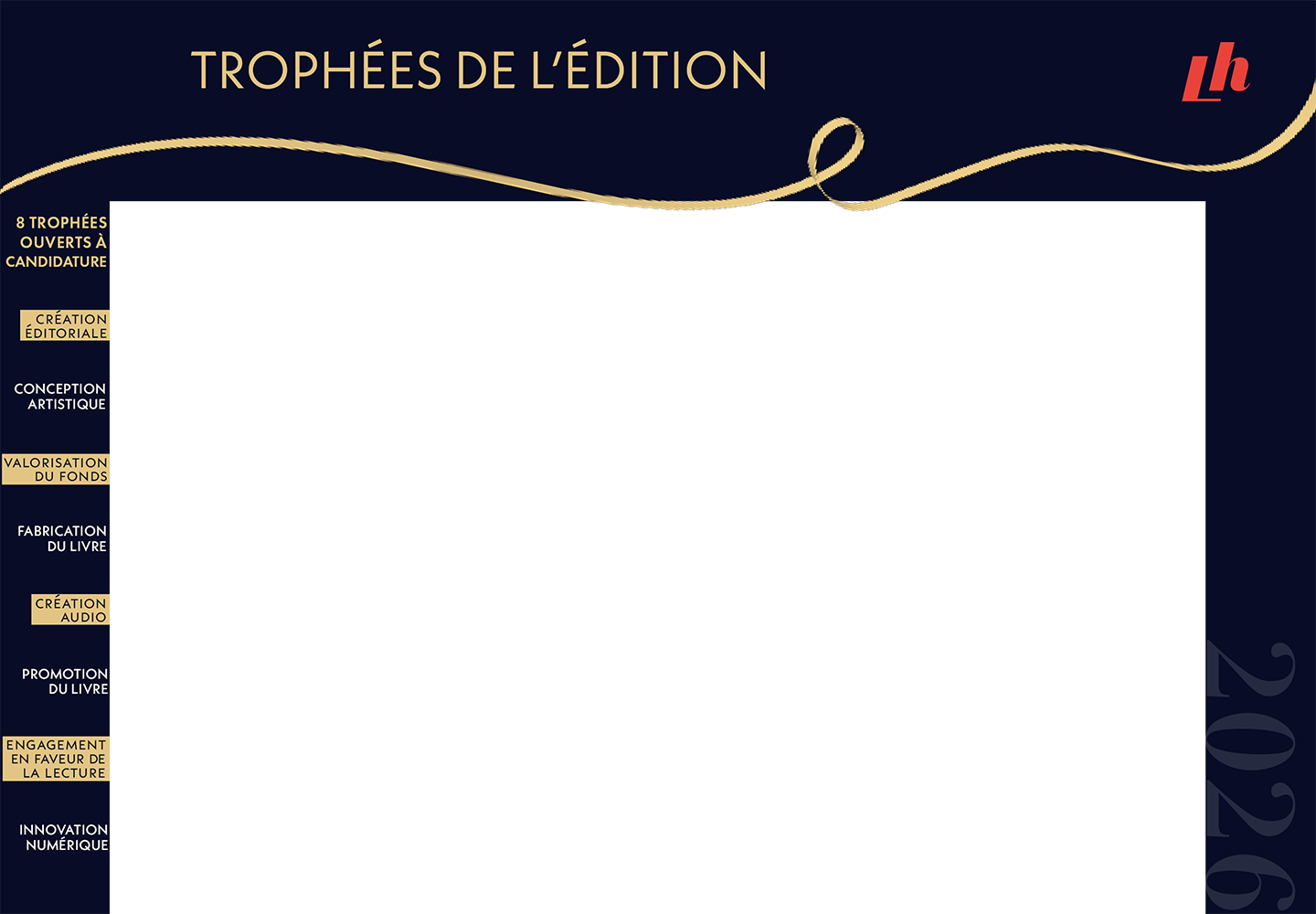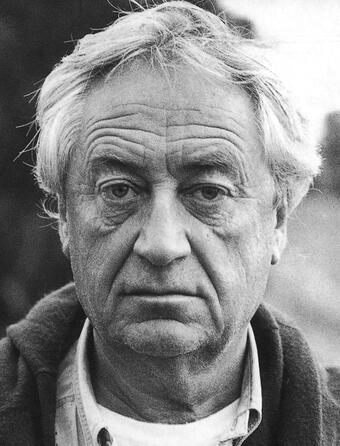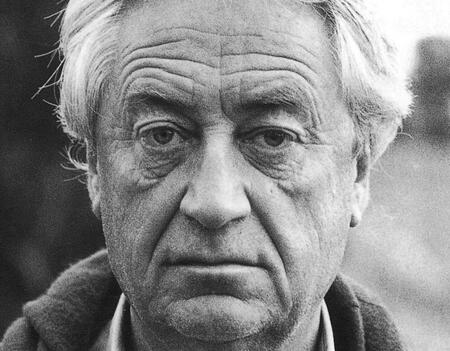L’heure des choix a sonné. Non seulement pour nous, qui nous grattons la tête en nous demandant par quel livre commencer cette “petite (et prolifique !) rentrée littéraire de poche”, mais aussi pour les personnages de ces sept romans, qui affrontent toutes et tous l’épreuve du choix existentiel, chacun à sa façon.
Mêler la grande à la petite histoire
Dans son huitième roman, Frapper l’épopée, Alice Zeniter raconte l’histoire d’une jeune femme, nommée Tass, qui choisit de revenir « pour de bon » sur sa terre natale, la Nouvelle-Calédonie et d’y devenir prof de français. Intriguée (voire obsédée) par deux élèves de sa classe, frère et sœur jumeaux disparus avant la fin de l’année scolaire, Tass décide de mener une forme d’enquête qui l’amène, de manière inattendue, à soulever les questions qu’elle n’a jamais osé affronter sur ses propres origines et les raisons de sa présence ici, sur cet archipel.
À travers ce livre d’une extraordinaire force romanesque, aux accents quasi-mystiques, Alice Zeniter, l’une des écrivaines les plus primées et talentueuse de la scène littéraire actuelle, nous éclaire non seulement sur l’histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur sa propre trajectoire personnelle en dévoilant les raisons intimes qui l’amènent à choisir ce sujet. Un livre inoubliable.
De la satire climatique
Chez Abel Quentin, la notion de choix est collective. Et il y est question de vie ou de mort. Dans Cabane, ce romancier, avocat, lauréat du Prix de Flore en 2021, s’inspire de la véritable histoire de quatre jeunes chercheurs de l'Université de Berkeley qui, en 1972, élaborent l’écriture d’un rapport scientifique sur l’avenir du monde au XXIe siècle. Intitulé « Rapport 21 » dans la fiction d’Abel Quentin (alias « Rapport Meadows » dans la réalité), ce document, rendu public, indique que selon tous les scénarios envisageables, « si la croissance industrielle et démographique suivait son cours », nous assisterions autour de l’année 2050 à une dégradation, voire à « l’effondrement des conditions matérielles de la vie humaine ».
Cette découverte agit comme un coup de massue sur chacun des personnages. L’un s’engage corps et âme pour cette cause militante, d’autres sombrent dans le déni ou encore dans la folie. Et Abel Quentin manie l’effet vertigo de son récit sur cinquante ans avec un souffle qui empêche de refermer le livre avant de l’avoir terminé. Un roman glaçant de réalisme (ou plutôt de réalité). Et saisissant de bout en bout.
Dangereuse liaison
Chez Emma Becker, le vertige devient une grâce. Dans Le Mal joli, son sixième roman, l’écrivaine poursuit l’exploration, déjà amorcée dans ses précédents livres, de l’autofiction et du désir ardent. Emma, son double littéraire, femme mariée et mère de famille, y fait la rencontre d’Antonin, « un aristo de droite qui aime Brasillac », qu’elle aurait aimé détester puisqu’il incarne absolument tout ce qu’elle rejette idéologiquement. (« J’en suis à la phase où on cherche des raisons de détester l’autre, et je sais que ce mec n’est pas fait pour moi, nom de Dieu, ça me ferait mal »).
Aimantée par cet homme, l’écrivaine s’abandonne aux jouissances d’une liaison passionnée qui la consume autant qu’elle la libère. Mais qui aussi la propulse vers l’écriture, en donnant naissance à une réflexion philosophique éclatante de lucidité sur le désir, le sacrifice, l’amour maternel et sur les paradoxes politiques violents qui imprègnent toutes ces aspirations lorsqu’elles s’incarnent dans la vie d’une femme moderne. Un récit puissant, qui parvient à mêler perpétuellement, comme dans une seule et grande phrase, l’espièglerie et l’élégance.
Les dessous d'une œuvre
Chez Grégoire Bouillier, le trouble est esthétique et psychiatrique. Dans Le Syndrome de l’Orangerie, ce romancier, qui nous a habitués à transformer ses obsessions en labyrinthes littéraires, fait l’expérience d’un choc inattendu face aux Nymphéas de Monet. Non pas admiration béate, mais angoisse profonde, proche de la crise de panique. « L’angoisse, découvre-t-il, peut, autant que le beau et peut-être davantage, donner le sentiment du sublime. Provoquer en nous des troubles magnifiquement psychiatriques. La preuve. »
Cette secousse déclenche une enquête à sa manière : savante, joyeusement digressive, portée par son double fictif et détective, Bmore. Quels cadavres se cachent derrière les célèbres Nymphéas de Monet ? C’est la question qui le hante et qui l’empêche d’apprécier la beauté comme les milliers de spectateurs qui contemplent cette œuvre chaque semaine. En traquant la vie de Claude Monet, sa cécité, les épreuves qu’il a affrontées, Bouillier plonge dans l’histoire collective, de Giverny à Auschwitz, de l’art au silence. Le texte file comme une rêverie remplie d’élans inattendus, de fulgurances, de drôleries douces et amères. Un roman-enquête sur la beauté, le choix du point de vue que l’on adopte face à une œuvre d’art, les obsessions qu’elle suscite, qui ne ressemble à rien d’autre — sauf peut-être à Bouillier lui-même.
Une quête proustienne
Thibault de Montaigu n’a pas vraiment le choix lorsque son père vieillissant lui demande d’écrire ce livre. Il le sait, « un écrivain ne choisit jamais son sujet ; c'est l'inverse qui est vrai. » Dans Cœur, son septième livre, le romancier accepte donc, d’abord à contrecœur puis en s’y engageant corps et âme, de raconter l’histoire de son arrière-grand-père, Louis de Montaigu, capitaine de hussards tué au début de la guerre de 1914.
Alternant entre l’enquête sur une épopée héroïque d’une part, remplie d’énigmes, de fausses pistes et de trouvailles et d’autre part une réflexion universelle bouleversante sur l’amour pudique entre un père et son fils, Thibault de Montaigu nous entraîne dans le récit inattendu du pardon que le cœur peut réclamer et délivrer à tout âge, en passant par tous les détours possibles. Un récit lumineux, porté par un style élégant qui, sous couvert d’enquête familiale, nous parle en sourdine de ce « bol-là [qui] se nomme l'amour, peut-être la seule chose qui peut nous retenir en vie quand on se trouve déjà au séjour des sombres. »
Crise de foi
Passons à La Confession. C’est le titre de l’un des romans les plus originaux de ces dernières années, le deuxième signé Romane Lafore. L’écrivaine y met en scène le dilemme intérieur d’une femme sous forme de monologue glaçant. Fervente catholique élevée dans un milieu ultraconservateur et mariée à un Saint-Cyrien, l’héroïne de ce roman, Agnès Lanafoërt, a suivi tous les sacres exigés par son milieu pour se bâtir une existence idéale à ses propres yeux.
Il ne lui reste plus qu’une seule case à cocher pour se sentir entièrement accomplie : avoir son premier enfant. « J’attendais autant de tomber enceinte que de voir se révéler à moi le mystère de la volupté dont tant de femmes parlaient, même les plus pieuses – dont même les curés, les confesseurs parlaient –, et auquel les papes avaient consacré d’entiers encycliques. » Mais voilà, l’enfant ne vient pas. Agnès affronte un vide qu’aucune prière ni plan de vie bien établi à l’avance ne peut combler.
Militante anti-IVG, allant parfois jusqu’à manipuler certaines femmes pour les empêcher d’avorter, Agnès est un personnage pétri de paradoxes que l’on ne rencontre jamais en littérature. La force de ce roman tient à la fois à sa singularité remarquable, à l’ambivalence de cette héroïne et à la sincérité nue de sa « confession ». Car au milieu de sa descente aux enfers, Agnès ose affronter les points de bascule morale et les tiraillements que déclenche son sentiment culpabilité, lequel nous bouleverse presque autant qu’elle. Un roman dont le suspens nous tient en haleine jusqu’aux dernières pages et qui propose un chemin d’émancipation inédit. Du jamais lu.
Mieux vaut en rire
Après avoir traversé le trouble, l’extase, la passion et l’épopée guerrière, voici un livre que l’on garde pour la fin, comme la cerise sur le gâteau. D’abord parce que, comme les auteurs l’indiquent dans le courrier de lecteurs qu’ils ont pré-écrit pour nous faciliter la tâche si on souhaite le leur adresser : « On en prend plein la tronche ». Mais aussi parce que, pour le dire à notre façon, il offre une émotion rare en littérature : le rire aux larmes ! Avec Un roman à succès sur papier recyclé, Simon Drouard et Vianney Louvet créent un objet littéraire indescriptible – c’est-à-dire encore plus fou et tordu que « l’objet littéraire non identifié ».
Cosigné par deux auteurs dont on ne saura rien (à part que l’un des deux admet « de fortes lacunes en astrologie ») et d’un casting de préfaciers de génie - Vincent Dedienne, Guillaume Meurice, Laura Felpin, David Castello-Lopes ou encore Jenny Letellier - le livre se compose d’innombrables dédicaces, avertissements, prologues, avant-propos, épilogues, postfaces, fins alternatives, bibliographies et autres notes de marge et de bas de page en tous genres à lire jusqu’à la dernière miette. Et contre toute attente, il raconte bel et bien une histoire dont le chapitre 1 s’ouvre à la page 87, se termine à la page 113 (soit presque cinquante pages avant la fin) et sur laquelle on ne révèlera rien - pour que la surprise reste entière.
Écrite, entre autres, « en souvenir de Philippe, qui pensait tout bas ce que tout le monde avait déjà dit haut et fort », cette farce se savoure comme un micro-fondant-littéraire : en une seule bouchée, mais avec la détermination de lécher les bords de l’assiette jusqu’au bout. Car une fois le livre terminé, on ne peut s’empêcher d’y revenir pour y déceler un pied de nez (sans méchanceté) à l’édition contemporaine, un éloge de l’absurde qui n’aurait pas déplu à Boris Vian ou à Georges Perec. Existe-t-il meilleur présage pour cette rentrée que de l’amorcer avec un fou-rire sur papier (presque) recyclé ?