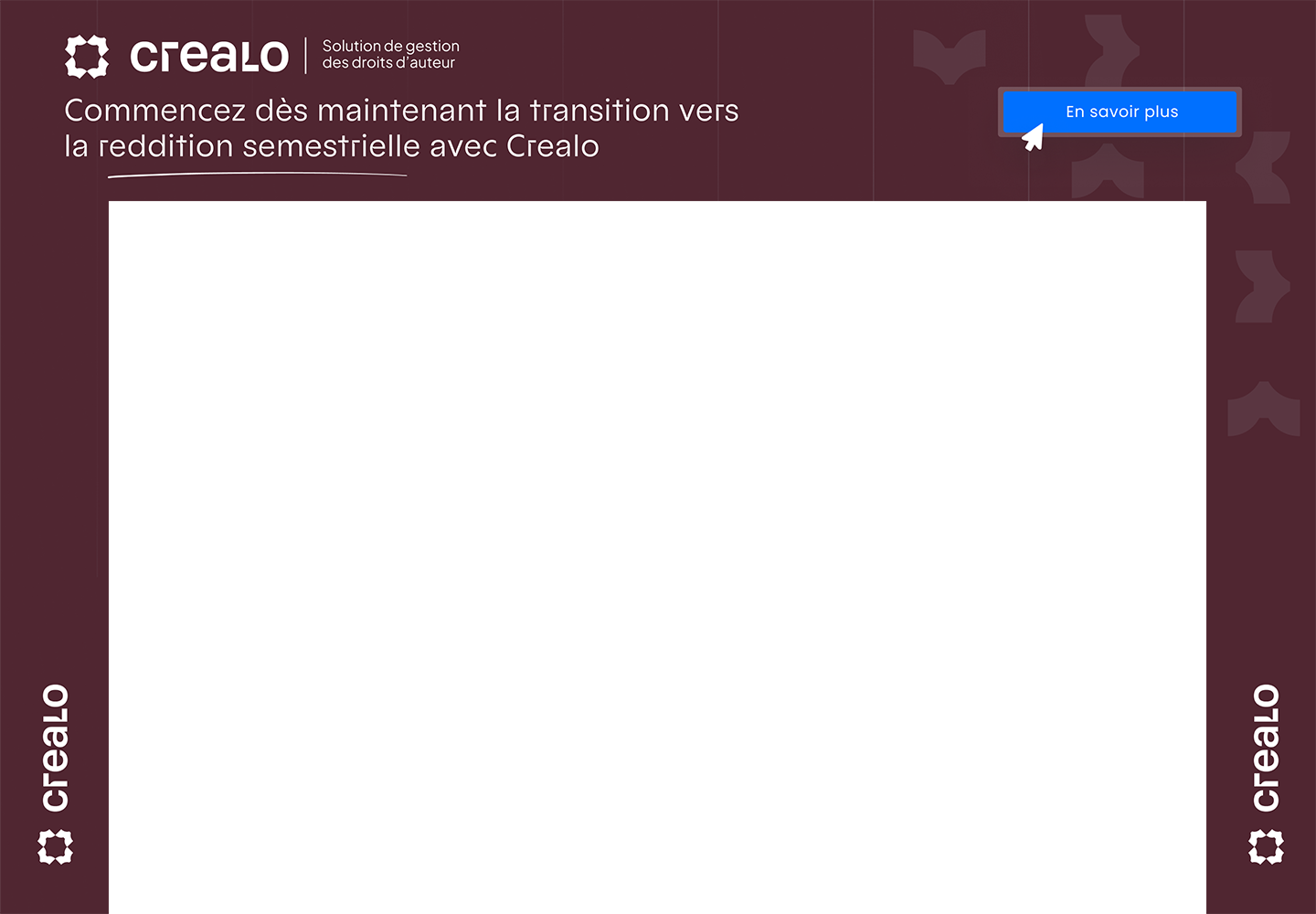Livres Hebdo : Vous vivez désormais aux Philippines. Pourquoi ce choix ?
David Vann : Je vis à Palawan, l'une des îles les plus sauvages et les moins développées de l'archipel. C'est un endroit d'une beauté brute, presque intact. J'y suis arrivé en voilier, exactement comme Bob dans mon nouveau roman, puis j'ai construit une maison et, finalement, un petit resort de plongée, sur la plage. Ma vie ici est simple : j'écris chaque matin, je passe mes après-midis sur ou sous l'eau. C'est un lieu paisible, parfait pour travailler et pour vivre loin du tumulte.
David Vann- Photo © DIANA MATARPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Le contraste climatique avec votre Alaska natal est grand...
Oui, un contraste absolu. J'ai grandi à Ketchikan, dans la forêt pluviale, avec à peine deux semaines de soleil par an. Le reste de l'année, c'était la pluie ou la neige. Je crois que c'est pour cela que j'aime tant la chaleur. J'ai passé la moitié de ma vie à fuir le froid.
Comment les Philippines sont-elles entrées dans votre vie ?
Mon ex-femme était Américaine mais ses parents étaient originaires des Philippines. Pendant seize ans, j'ai vécu entouré de cette culture. J'y ai trouvé une chaleur, une spontanéité, une absence d'agressivité que je ne connaissais pas chez moi. Après notre divorce, je me suis mis à la plongée. C'est devenu une passion. J'ai passé mes certifications ici, puis mon diplôme de divemaster en Indonésie, où se déroule mon roman Komodo. Un jour, j'ai acheté un voilier en Malaisie, j'ai navigué deux mille miles jusqu'à Palawan, et je me suis dit : « C'est ici que je veux vivre. »
Et c'est là que votre nouveau roman, La jeune fille et la mer, a pris racine ?
Oui, parce que je suis désormais en couple avec une femme philippine rencontrée ici, et que c'est une relation très agitée... En cinq ans, elle m'a déjà quitté neuf fois ! Cela m'a fait réfléchir aux dynamiques de pouvoir, aux malentendus culturels, à ce que recherchent les étrangers ici, à ce que les femmes locales attendent d'eux. La trame s'inspire largement des nouvelles de Gabriel García Márquez, dont j'adore le côté carnavalesque et déjanté, notamment L'incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique. Le monde développé semble mythique, on y trouve un lieu pauvre et désespéré, un bateau de croisière, l'intervention étrange et inefficace de l'Église...
Dans La jeune fille et la mer, vous abordez frontalement la question du tourisme sexuel...
Il est impossible à nier ici. Des avions entiers de touristes, venus d'Allemagne, du Japon ou de Corée atterrissent à Manille ou à Cebu. Ils passent quelques jours à multiplier les conquêtes tarifées. Je n'ai jamais participé à cela, je n'ai jamais payé pour du sexe. Mais je voulais écrire sur ce système, sur la manière dont il façonne les relations entre les hommes étrangers et les jeunes femmes philippines. Mon roman raconte l'histoire d'un homme plus âgé, persuadé de vivre une histoire d'amour, et d'une femme bien plus jeune qui, consciente de l'injustice du monde, décide de retourner le rapport de force.
Votre héroïne cherche à s'émanciper, elle est déterminée, mais tout semble se lier contre elle. Sa vie est-elle un reflet de ce que vous constatez aux Philippines ?
Exactement. Les femmes ici n'ont presque aucun droit. L'avortement est illégal, le divorce aussi. Les moyens de contraception sont difficiles d'accès, et les hommes ne paient rien quand ils abandonnent leurs enfants. Les mères célibataires doivent les élever avec un salaire d'à peine un ou deux dollars de l'heure. C'est un système qui fabrique la misère et la dépendance. Mon héroïne incarne cette frustration : elle veut s'en sortir, avoir une autre vie, mais tout lui est interdit.
Par votre héroïne, qui veut à tout prix avoir un enfant métis, vous décrivez la fascination pour la blancheur, presque un fétichisme racial...
Oui, c'est frappant. Beaucoup de femmes rêvent d'avoir un enfant à peau claire, aux yeux bleus et au nez occidental, plus saillant. Les gens utilisent des crèmes blanchissantes, se moquent des peaux foncées, appellent les autochtones « négros ». C'est choquant, mais c'est banal. Le rêve d'un enfant métis vient de là, de l'idée qu'une peau plus claire promet une vie meilleure.
La nature joue à nouveau un rôle essentiel dans ce livre.
Oui, toujours. Dans mes romans, le paysage est un personnage. Ici, la nature est magnifique mais implacable. La flore est luxuriante, mais les typhons frappent sans cesse. La mer est à la fois nourricière et cruelle. C'est un décor paradisiaque et violent, à l'image de mes personnages.
Depuis Sukkwan Island, vos livres ont une tonalité tragique. Est-ce ainsi que vous voyez la réalité ?
Dans la vie, les pires s'en sortent souvent et les meilleurs paient. Depuis Madame Bovary, cette injustice m'obsède. Dans mon roman, Andy, l'homme qui met mon héroïne, Aica, enceinte, est odieux et impuni. Mais pour elle, tous les hommes sont suspects. Dans un pays où la violence domestique est endémique, où les femmes n'ont aucun recours, cette méfiance est presque une forme de survie.
Vous ne croyez donc pas aux dénouements heureux ?
Non. La tragédie, c'est ce qui ressemble le plus à la vie. Nous prenons souvent les pires décisions en croyant faire le bien. Nous sommes mus par des forces que nous ne comprenons pas : la religion, la honte, les blessures d'enfance. Mes personnages ne sont pas mauvais, ils sont simplement dépassés. La tragédie grecque a tout compris : nous vivons nos vies à moitié conscients, et nos fautes nous précèdent.
Vous ne publiez plus qu'en France. Pourquoi, que s'est-il passé ?
J'ai perdu mes éditeurs anglophones après L'obscure clarté de l'air. J'ai eu le tort de me plaindre d'un lancement raté, et j'ai été catalogué « auteur difficile ». Heureusement, Oliver Gallmeister a continué à me publier. Il est d'une loyauté rare.
Vous préparez un retour dans le monde anglophone ?
Oui. Mon prochain roman, From Before Memory, est actuellement chez des éditeurs américains. J'espère qu'il me permettra de revenir dans le circuit. Mais, en attendant, la France m'a offert une seconde vie littéraire. Sukkwan Island a été adapté par Vladimir de Fontenay, le film sortira bientôt, et un autre projet, Goat Mountain, est en préparation. Finalement, c'est grâce aux Français que mes livres continuent d'exister.
David Vann
La jeune fille et la mer
Gallmeister
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laura Derajinski
Tirage: 6 000 ex.
Prix: 23,90 € ; 288 p.
ISBN: 9782351783603