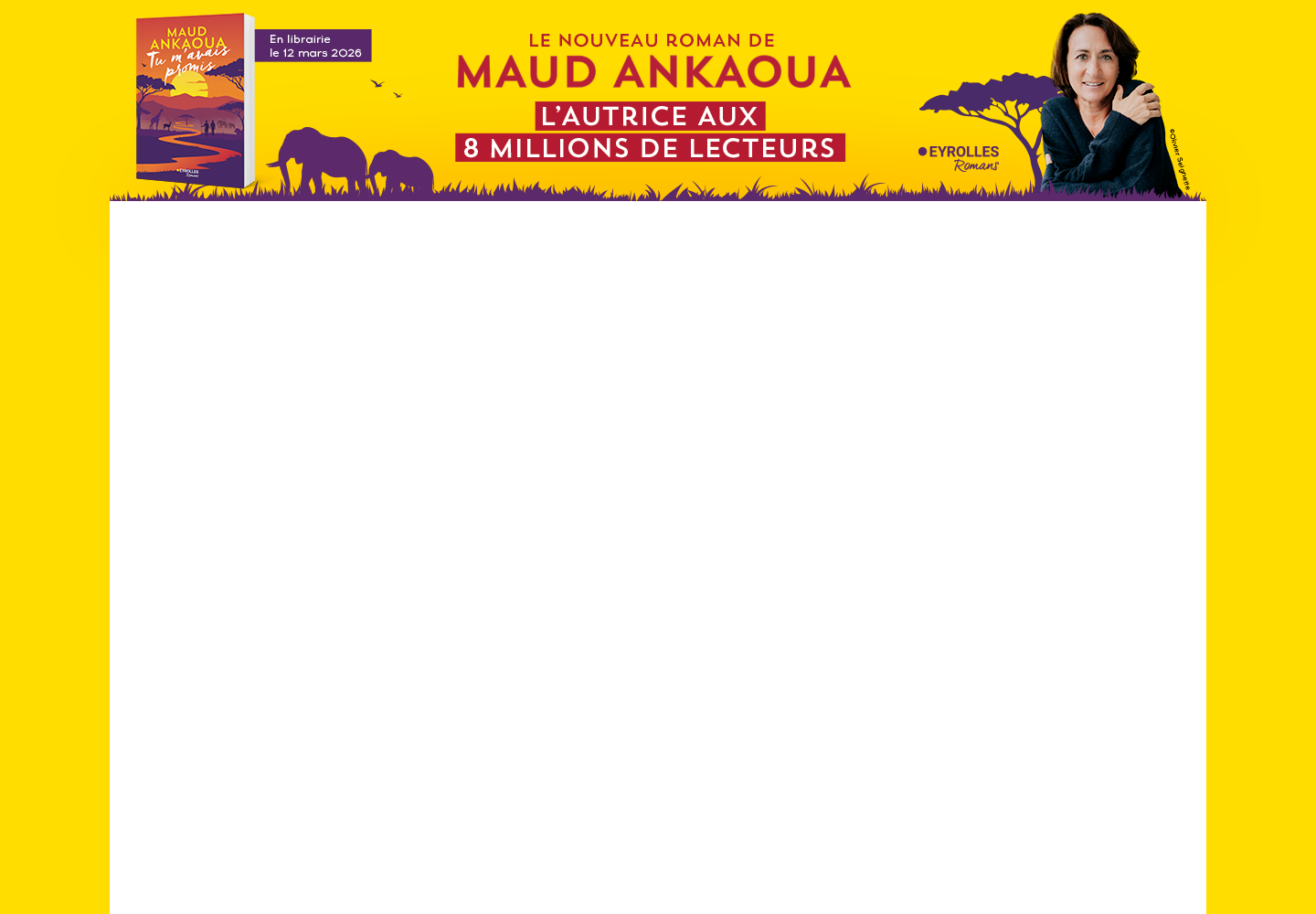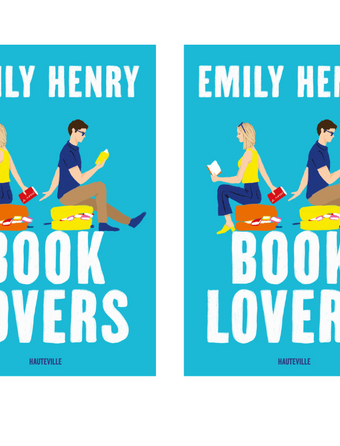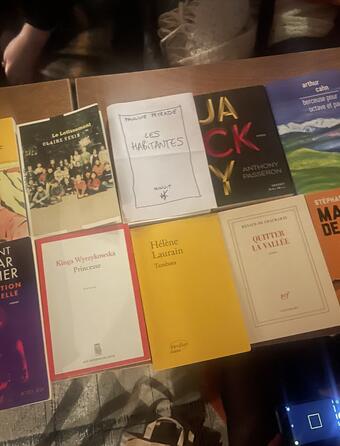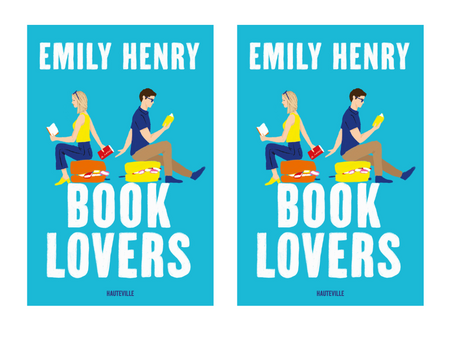Le congrès de l’IFLA peut offrir des formats originaux d’interventions. En plus des
présentations éclairs de 5 minutes, de l’utilisation de
Mentimeter, l’avenir du service de référence a fait l’objet d’un débat lors de la session organisée par la section «
Reference and Information service » le 26 août.
D’après la définition du Dictionnaire de l’information, ce service semble incontournable dans les bibliothèques. Mais deux éléments remettent en question son avenir, ce qui a amené quatre équipes de débateurs à s’affronter sur chaque sujet, le public votant à main levée à l’issue des débats.
Premier présupposé : «
le service de référence va devenir de moins en moins important à cause du développement des contenus en libre accès ». En faveur de cet argument, la pratique de beaucoup d’étudiants est de consulter massivement Wikipédia. Pour les chercheurs, les archives ouvertes ou les journaux en open access constituent des moyens d’accéder directement à l’information. Mais si chercher du contenu est devenu plus facile, les bibliothécaires peuvent toujours apporter leur expertise en gérant les plateformes en open access, puis en donnant eux-mêmes des formations sur ce sujet, sur les logiciels de gestions de références bibliographiques, ou sur les licences Creative Commons.
Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.
Deuxième présupposé : «
la bibliothèque et son service de référence ne peuvent rien contre l’impact des fake news ». Les contributeurs défendant cet argument ont relevé une réalité statistique : dans le monde il y a plus de personnes ayant accès à internet (4,5 milliards d’utilisateurs) qu’à une bibliothèque (2,5 millions de bibliothèques). Les biais cognitifs jouent aussi en faveur des fake news. Les moyens financiers et humains des bibliothèques sont sans commune mesure avec ceux des réseaux sociaux. Enfin se pose la question du risque de limite à la liberté d’expression. Mais l’équipe adverse de débateurs a rappelé que les fake news ne sont qu’une nouvelle appellation d’un phénomène de désinformation existant déjà depuis l’invention de l’imprimerie.
Les bibliothèques ne sont pas démunies: l’IFLA a des ressources sur le sujet, et comme les bibliothèques sont un lieu de débat, quoi de mieux qu’un débat organisé sur ce thème dans nos espaces ? C’est ce qu’a fait la
Singapore Management University Library en invitant le 30 avril 2019 plus de 150 personnes sur ce sujet.
Sans surprise, les bibliothécaires présents dans la salle ont voté à chaque fois pour l’avenir de ce service !