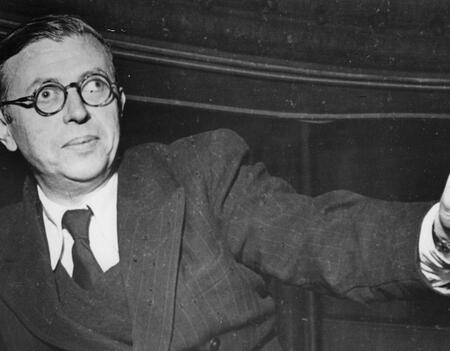Margherita Giacobino, née en 1952 à Cirié, dans la province de Turin, et dont Toutes nos mères est le premier livre traduit en français, a grandi entourée de ses "Magne", ses chères aînées, grands-mères et grands-tantes, femmes aussi puissantes qu’en retrait, appartenant aux invisibles, aux minuscules de l’histoire. Soixante ans seulement sépare la narratrice de ce grand récit intime des origines, de Ninin, la "tête de proue" de cette famille matrilinéaire, une grand-tante née à la fin du XIXe siècle dans un village de montagne du Piémont et morte à 85 ans. Pourtant, plusieurs siècles semblent s’écouler dans cette fresque généalogique, conjuguée dans un présent intemporel, qui donne corps à ces vies qui n’ont laissé que peu de traces.
Restée vieille fille, Ninin, "la mégère indomptée", comme l’appelle affectueusement sa petite-nièce, "écologiste extrémiste avant la lettre", ne gâchant rien, épargnant tout sauf son temps de travail et son dévouement aux autres, est l’une de ces mères, qui élèvera frères et sœurs, puis nièce et petite-nièce. Ninin qui quitte, adolescente, le village pour se faire embaucher dans la fabrique de textile de la ville. Bientôt rejointe par ses jeunes sœurs, Maria et Michin. La première épouse un Italien émigré aux Etats-Unis qu’elle suit en Californie, puis revient d’Amérique quelques années plus tard, seule et hémiplégique. "Maria la povra dona" a laissé derrière elle sa fille, confiée à son père qui meurt peu après. La fillette, Maria Grazia, la mère de la narratrice, est alors renvoyée à 8 ans en Italie où elle débarque en 1935, parlant l’anglais. Elle sera ainsi élevée par trois des sœurs de sa mère invalide, dans un amour "sobre et bourru, mais surabondant, palpable".
D’une mémoire sans support, Margherita Giacobino écrit la légende de ces héroïnes familières. Elle remplit les blancs, interprète, imagine mais aussi enquête sur Internet, consulte les registres d’Ellis Island, revient sur les traces jusqu’aux Etats-Unis, cinquante ans après sa grand-maternelle… L’écrivaine fait entendre le dialecte de l’enfance dont les expressions, modestes leçons de vie, constitueront son "ossature morale". On traverse ainsi le XXe siècle par les marges, par les petites portes : l’économie de pénurie, entre frugalité et indigence, des familles paysannes, l’exode vers les villes, l’émigration de survie en France, les privations de la guerre, les étapes vers l’émancipation…
Le récit déborde d’une loyauté respectueuse à l’égard de ces obscures travailleuses, y compris pour les "Magne paternelles" qui entourent le père de la narratrice, un flambeur, rare figure virile de ce beau portrait de groupe. "Ma mère et mes vieillards m’ont offert la liberté", constate avec reconnaissance Margherita Giacobino qui doit son prénom à la benjamine de ses tantes maternelles, cette Margherita, "Mater Consolatrix à l’ironie tendre" qui était "la seule de la famille à maîtriser l’art du sourire" et à qui la narratrice doit le goût de l’humour, l’un de ses plus précieux legs. Véronique Rossignol