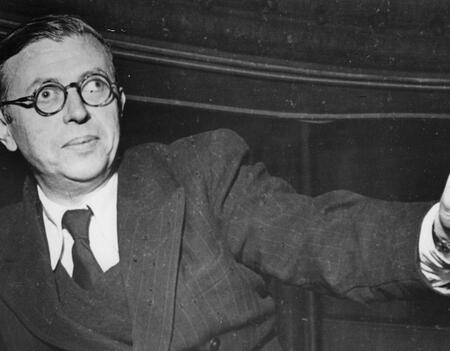Livres Hebdo : Le stand France Livre reste le plus important de la Foire de Francfort avec près de 650 accrédités et 200 maisons d'édition. Comment expliquez-vous cette prééminence du modèle français sur les bords du Main ?
Nicolas Roche : Historiquement, les Français sont des partenaires de Francfort depuis la reprise de la foire après la guerre en 1949. Cette présence massive s'explique d'abord par la vitalité de la création et la puissance de l'industrie éditoriale française à l’international. Les éditeurs français vendent ainsi environ deux fois plus de droits que les Allemands. Les auteurs français rayonnent dans tous les domaines : littérature bien sûr, mais aussi sciences humaines, bande dessinée et jeunesse, des segments ultradynamiques à l'international.
Le modèle du stand collectif illustre également une spécificité française : les éditeurs partagent beaucoup d'informations entre eux. Les responsables de droits échangent constamment sur les nouveaux contacts, les tendances des marchés, sans trahir le secret des affaires évidemment. Cette intelligence collective est profondément française et est souvent soulignée dans nos programmes internationaux. Sur certains marchés, chacun joue pour sa maison d'édition sans partager. Nous, nous jouons très collectif. D'ailleurs, les grands groupes ont rejoint le stand collectif, notamment depuis la crise sanitaire, pour des raisons économiques mais aussi parce que ce modèle est devenu une véritable force.
« Pour la première fois de son histoire, la part des subventions publiques dans le budget de France Livre devrait être inférieure à 50 % »
Vous évoquez une contraction de la foire. Concrètement, comment les éditeurs français adaptent-ils leur stratégie face à un événement qui n'accueille plus 7 000 exposants internationaux comme par le passé ?
La foire reste le grand temps fort international de l’année mais, effectivement, elle doit faire face à une baisse du nombre des exposants, notamment des Américains qui voyagent moins depuis la crise sanitaire. Face à cette réalité, nous avons multiplié les formats et les occasions de rencontres le reste de l’année. La succession de crises géopolitiques et économiques rend les choses plus difficiles : il faut passer plus de temps, multiplier les contacts pour obtenir les mêmes résultats qu'auparavant.
Concrètement, cela fait longtemps que les éditeurs ne se contentent plus de la foire. Une grande partie des responsables de droits sont déjà en ligne pour leur « Francfort digital » fait maison, avec des rendez-vous en visio auprès de partenaires qui ne se déplacent plus en Allemagne. Francfort déborde de son cadre traditionnel. Nous avons aussi créé des événements comme le Paris Book Market pour offrir un rendez-vous en France début juin, accessible à toutes les maisons, y compris les plus petites, sans devoir débourser les frais que représentent une mission à Francfort. Nous organisons des fellowships, des programmes hybrides comme au Brésil le mois dernier, des rencontres à New York pour les livres pratiques et beaux livres… Il faut se démultiplier pour aller chercher les éditeurs là où ils sont, quand on n'arrive pas à les voir dans les rendez-vous classiques.
Cette démultiplication des formats représente-t-elle un coût supplémentaire pour les petites maisons d'édition ? Comment France Livre maintient-il l'accessibilité de ses programmes ?
L’attention pour les petites maisons d'édition est un souci constant chez France Livre, partagé par l’ensemble du conseil d’administration présidé par Antoine Gallimard. Les grilles d'adhésion 2026 vont rester inchangées pour les petits éditeurs, elles n'ont quasiment pas changé pour eux depuis cinq ou six ans. Grâce à l'aide du ministère de la Culture, nous offrons des conditions très préférentielles avec une minoration des frais de participation aux alentours de 70 % aux grandes foires comme Francfort. C'est extrêmement important et j'espère que nous serons à même de prolonger ce soutien sur la durée, malgré le contexte de grande tension budgétaire. Pour la première fois de son histoire, la part des subventions publiques dans le budget de France Livre devrait être inférieure à 50 %.
Vous mentionnez les tensions budgétaires. Est-ce que la situation politique française actuelle impacte-t-elle les échanges entre éditeurs à l'international ?
À Francfort, les responsables de droits ont des rendez-vous toutes les demi-heures. On se concentre sur l'essentiel : les livres à présenter, le pouvoir de conviction vis-à-vis des interlocuteurs. Les sujets de politique intérieure ne sont que très rarement abordés.
« Un environnement politique plus complexe favorise une forme de repli sur soi »
Pourtant c’est une réelle préoccupation de l’interprofession très assujettie aux dispositifs d’aides à la création ou à la traduction…
Que ce soit les professionnels français ou les éditeurs internationaux, tout le monde est convaincu qu'une des forces de l'édition française à l'international réside précisément dans les programmes de soutien publics : l'Institut français, le Centre national du livre pour les programmes de traduction, France Livre, et tous les autres acteurs. Chaque euro investi - notamment par le ministère de la Culture et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui sont des partenaires historiques et essentiels - à un effet de levier extrêmement important, sans doute plus que dans d'autres industries culturelles. Il faut donc être vigilant pour que les incertitudes politiques ne conduisent pas à réduire ces programmes.
Vous identifiez des mutations plus profondes du marché international des droits. Lesquelles vous préoccupent le plus ?
Nous sommes dans le sillage de l'année dernière, avec l'impression qu'un certain nombre de pays ont la tentation de se refermer, d'être moins volontaires pour traduire des textes étrangers, qu'il s'agisse de fiction ou de textes académiques. Pour des raisons économiques d'abord : produire localement coûte souvent moins cher que de payer un traducteur et de la promotion pour des auteurs étrangers. Mais dans certains pays aussi, un environnement politique plus complexe favorise une forme de repli sur soi.
Dans d’autres territoires - qui souvent n’ont pas adopté de loi sur le prix unique du livre, les pure players font plus que concurrencer le modèle traditionnel de diffusion en proposant des remises considérables, remettant en cause la faisabilité de projets de traductions.
Notre rôle chez France Livre, aux côtés des éditeurs, est précisément de lutter contre cette tentation de repli et ces difficultés. C'est d'autant plus crucial que les Français restent performants : nous sommes à près de quatorze mille contrats de cessions de droits et de coédition en 2024. Cette performance doit être appréciée à sa juste valeur : elle résulte des efforts considérables déployés par les éditeurs et leurs responsables de droits pour valoriser leurs créations à l'international.
Comment France Livre mesure-t-il concrètement l'impact de cette stratégie multiforme et l'évolution de ces tendances ?
Nous allons multiplier la mise en place d’indicateurs à l'issue de chacune des opérations que nous menons en France et à l’étranger. L'objectif est d'apprécier au plus près l’impact sur l'activité de nos adhérents, mais aussi sur celle des éditeurs étrangers. Cette évaluation est essentielle pour conforter nos financements et indiquer aux pouvoirs publics à quel point ces opérations sont indispensables au développement de l'industrie éditoriale française à l’étranger. Des programmes qui sont bien entendu aussi important en termes de soft power et de rayonnement culturel pour la France.
France Livre, notre nouveau nom est désormais adopté, en interne comme à l'étranger. Nous ne renversons pas la table, mais nous sommes plus que jamais attentifs aux souhaits des éditeurs français et étrangers.
Pour l’heure, j’espère que Francfort continuera à jouer ce rôle de plaque tournante de l'édition mondiale, nous en avons besoin. Peu d’événements restent aussi fédérateurs. Nous restons un partenaire solide de la foire et nous avons envie de rencontrer toujours plus de partenaires !