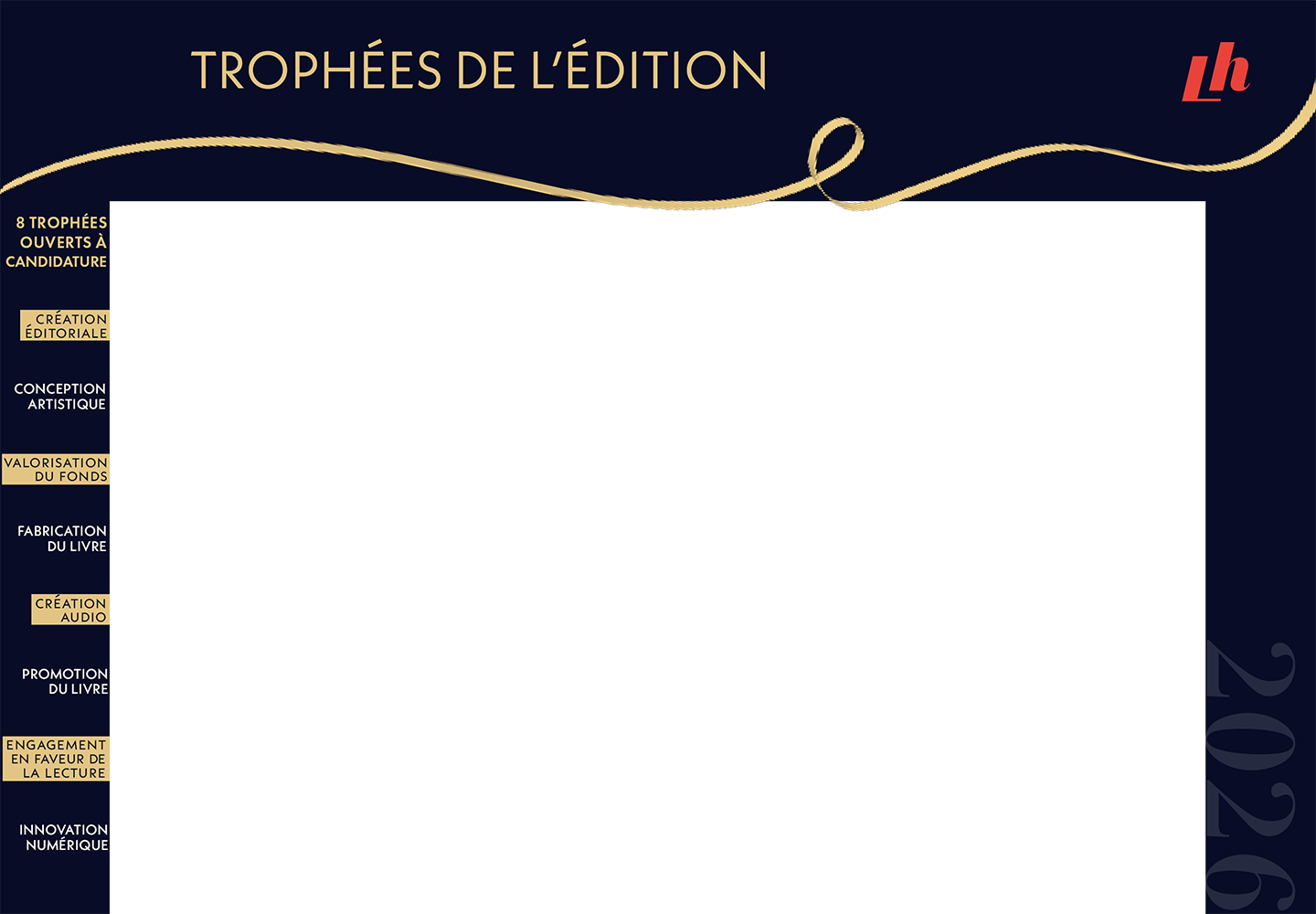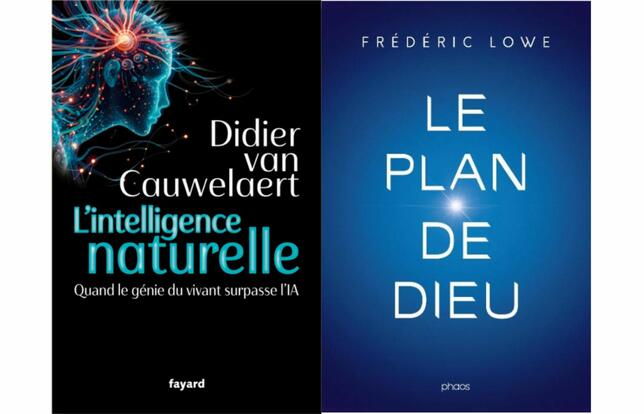Le 22 octobre dernier, 800 scientifiques, personnalités politiques, entrepreneurs tech et célébrités appelaient dans une tribune publiée en ligne « à l'arrêt des travaux visant au développement de la superintelligence artificielle, une IA capable de surpasser les capacités humaines ». Ces avancées en matière d'IA soulèvent des inquiétudes chez les scientifiques, mais aussi dans la société. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le monde face à l'intelligence humaine ? Est-elle réellement une menace ? Ces questions, au centre des débats, interrogent aussi les auteurs.
- Intelligences Artificielles et insensées OU naturelles et ignorantes de Pierre Bessière (EDP sciences). Pierre Bessière, directeur de recherches au CNRS à l'institut des systèmes intelligents et de robotique (ISIR), s'empare du sujet dans Intelligences Artificielles et insensées OU naturelles et ignorantes (EDP sciences), à paraître le 20 novembre. L'auteur distingue deux modèles d'intelligence : les intelligences incarnées (naturelles), qui gèrent les interactions avec le monde, et les intelligences ignorantes (artificielles) qui sont probabilistes. Pierre Bessière s'adresse à tout type de lecteur en détaillant les capacités et les limites des différentes formes d'intelligences, autour de plusieurs grandes questions « Comment les intelligences peuvent-elles percevoir, agir, apprendre ? Comment utilisent-elles le passé ou anticipent-elles l’avenir ? Comment trouvent-elles leur chemin dans l’espace qui les entoure ? Comment utilisent-elles les lois de la physique à leur avantage ? »
- L'Intelligence naturelle - Quand le génie du vivant surpasse l'IA de Didier van Cauwelaert (Fayard). Dans un livre à paraître le 5 novembre, Didier van Cauwelaert, lui, questionne la place de l'intelligence naturelle face à l'intelligence artificielle. Le lauréat du prix Goncourt 1994 pour Un aller simple publie L'Intelligence naturelle, Quand le génie du vivant surpasse l'IA, aux éditions Fayard. Il explique que la société a pris du recul sur la toute-puissance de l'intelligence artificielle, soulignant ses limites : « Elle atrophie la mémoire, la pensée critique, la créativité. Et, en plus, elle nous ment : lorsqu’elle ne sait pas, elle invente. Plus elle est perfectionnée, plus elle paraît crédible quand elle se trompe, et moins on arrive à la contrôler. » Dans un travail qui vise à démythifier l'IA, l'auteur explore les capacités de « l'intelligence naturelle » présente chez les végétaux, les animaux, les êtres humains dans un but de réveiller l'enthousiasme et l'espoir chez les lecteurs.
- Notre cerveau sous influence : comment les IA génératives façonnent nos émotions de Nadia Guerouaou (Eyrolles). Si la question des différentes intelligences a été posée, Nadia Guerouaou, s'interroge sur les conséquences des intelligences artificielles génératives sur nos manières de percevoir, nos croyances et les modèles cognitifs à la base de nos émotions. Dans son livre Notre cerveau sous influence : comment les IA génératives façonnent nos émotions, à paraître le 26 février chez Eyrolles, la docteure en neurosciences cognitives explore les implications de ces nouvelles technologies. Reprenant la phrase souvent entendue « L'IA n'est pas neutre », l'autrice décortique ces interrogations, en se posant une question centrale : « Et si les intelligences artificielles ne se contentaient plus de nous assister… Mais de nous façonner ? »
- Le plan de Dieu de Frédéric Lowe (Phaos). Ces réflexions autour du développement des outils IA interrogent aussi des auteurs sur un plan plus spirituel, notamment Frédéric Lowe dans son livre à paraître le 5 novembre, Le plan de Dieu (Phaos). Ingénieur de formation, Frédéric Lowe met en parallèle l'apparition du cosmos due à une « intention créatrice » et la création de l'intelligence artificielle. « Et si notre existence était, elle aussi, le résultat d’un plan structuré, comparable aux lignes de code informatique de nos machines ? ». Il exprime également, sous un angle différent, une forme de scepticisme quant à la technologie : « La technique ne nous sauvera pas ». Il propose une transformation des imaginaires pour arriver à une réflexion moins technosolutionniste et plus philosophique.