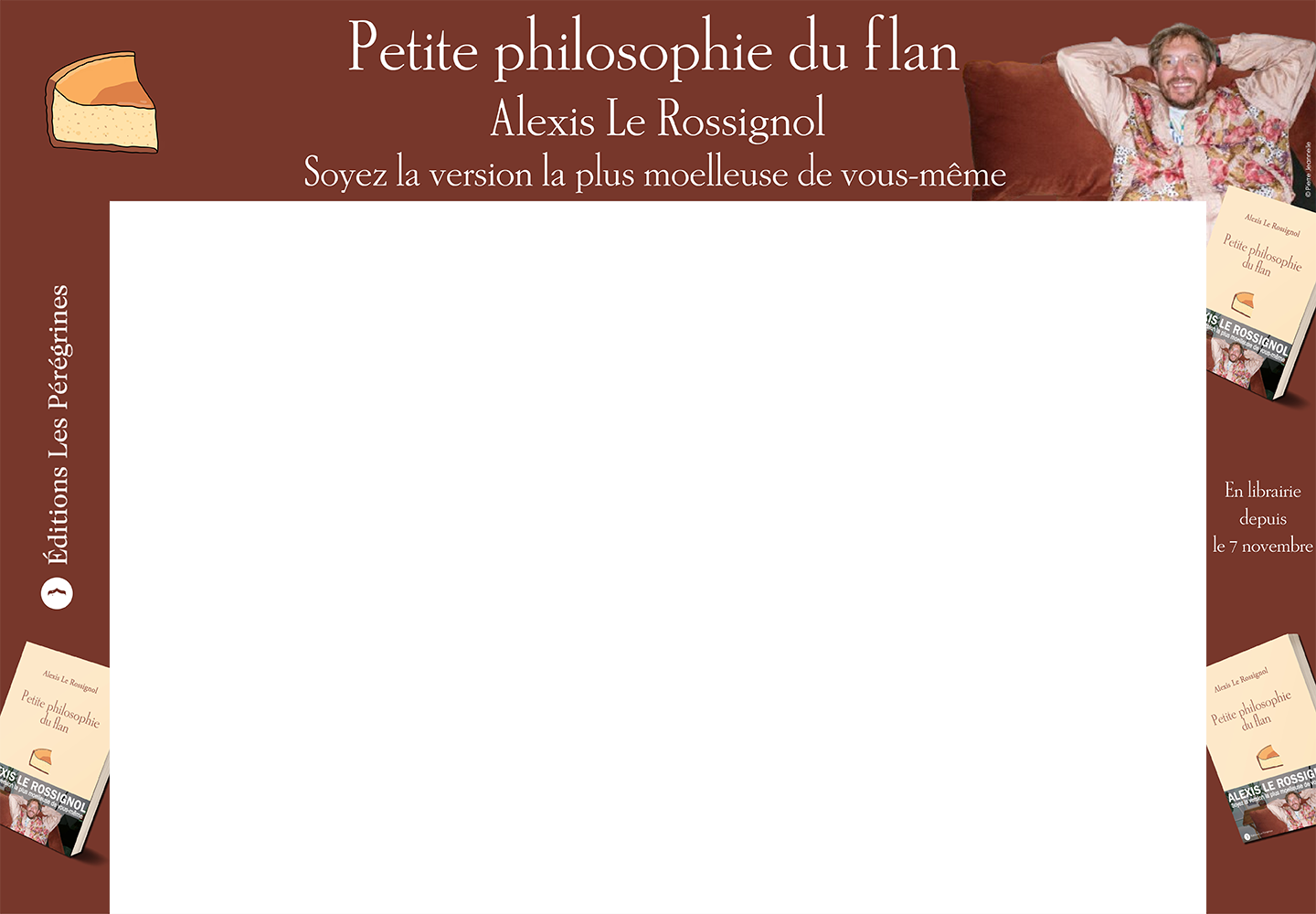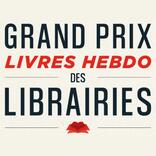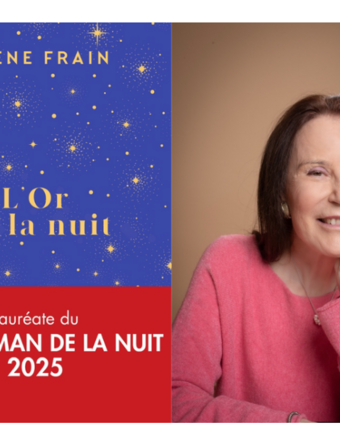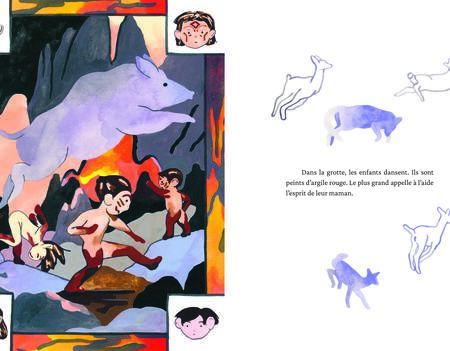Clôturant "l’année des bibliothèques" décidée par la précédente ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, les Assises des bibliothèques organisées lundi 8 décembre à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris sous l’intitulé "Bibliothèques, quelle place dans la démocratie du XXIe siècle ?" ont rassemblé un peu plus de 200 participants. Les élus, qui étaient pourtant le public cible de cette rencontre, ne représentaient qu’un quart environ de l’assistance, composée pour moitié de professionnels des bibliothèques et pour le dernier quart de directeurs des affaires culturelles (Dac). "Les invitations ont été envoyées il y a moins de deux semaines, déplorait l’un de ces derniers, envoyé par son maire pour le représenter. C’est bien trop tardif pour que les élus puissent se rendre disponibles, surtout à cette période de l’année, occupée par la préparation des budgets !"
Si on est toujours resté bien loin des débats enflammés qui avaient animé la rencontre historique sur les bibliothèques organisée à Hénin-Beaumont, avec près de 600 personnes, en 1981 (voir p. 17), les échanges, centrés sur le cadre juridique et l’organisation territoriale, d’une part, et les nouvelles missions des bibliothèques, d’autre part, ont permis de réaffirmer l’importance des bibliothèques dans les politiques locales. "Dans un contexte de réforme territoriale et de contraintes budgétaires fortes, il est important de refonder la parole politique sur la lecture publique, souligne Dominique Arot, doyen de l’inspection des bibliothèques et animateur de l’une des tables rondes. Certains élus ont encore une vision un peu ancienne des bibliothèques qu’il est nécessaire de faire évoluer. Et malgré un réseau de bonne qualité, beaucoup reste encore à faire. Aujourd’hui, 15 % de la population ne dispose pas d’une bibliothèque à proximité. Comment faire pour percer le plafond de verre des 17 % d’inscrits en bibliothèque ? Quelle offre proposer pour attirer les adolescents et les jeunes adultes, qui y sont peu présents ?"
Peu nombreux dans l’assistance, les élus, malgré quelques désistements de dernière minute, étaient en revanche bien représentés parmi les intervenants des quatre tables rondes et ont tenu un discours très engagé, rappelant que les bibliothèques sont le premier service culturel de base. "Elles sont de formidables occasions de réduire les inégalités culturelles sur le territoire, a affirmé Emmanuel Constant, vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis. Si les grandes institutions sont concentrées à Paris, les bibliothèques sont présentes partout." Pour Edouard Philippe, maire du Havre, les bibliothèques sont le premier point d’accès à la culture pour nombre de citoyens : "Il est plus facile d’entrer dans une bibliothèque que dans tout autre lieu culturel. Mais quand on construit un nouvel établissement, il faut s’interrogersur ses missions et ne pas rester dans la reproduction du même modèle."
Doute
Parmi les différents sujets abordés au cours de la journée, c’est le vaste chantier de la réforme territoriale en cours qui est apparu comme la principale préoccupation des élus comme des professionnels des bibliothèques. "C’est une chance de repenser les choses différemment, a affirmé avec optimisme Georges Képénékian, premier adjoint au maire de Lyon. Je rêve de faire des assises des bibliothèques à l’échelle de notre métropole pour inventer une nouvelle politique de service."
La tonalité dominante était cependant le doute sur la manière dont allait se partager la gestion de la lecture publique entre les différents acteurs, communes, départements, région, Etat, dans un paysage territorial entièrement recomposé. "Dans la réforme, le législateur ne parle pas de lecture publique. Tant mieux, qu’il nous oublie sur ce