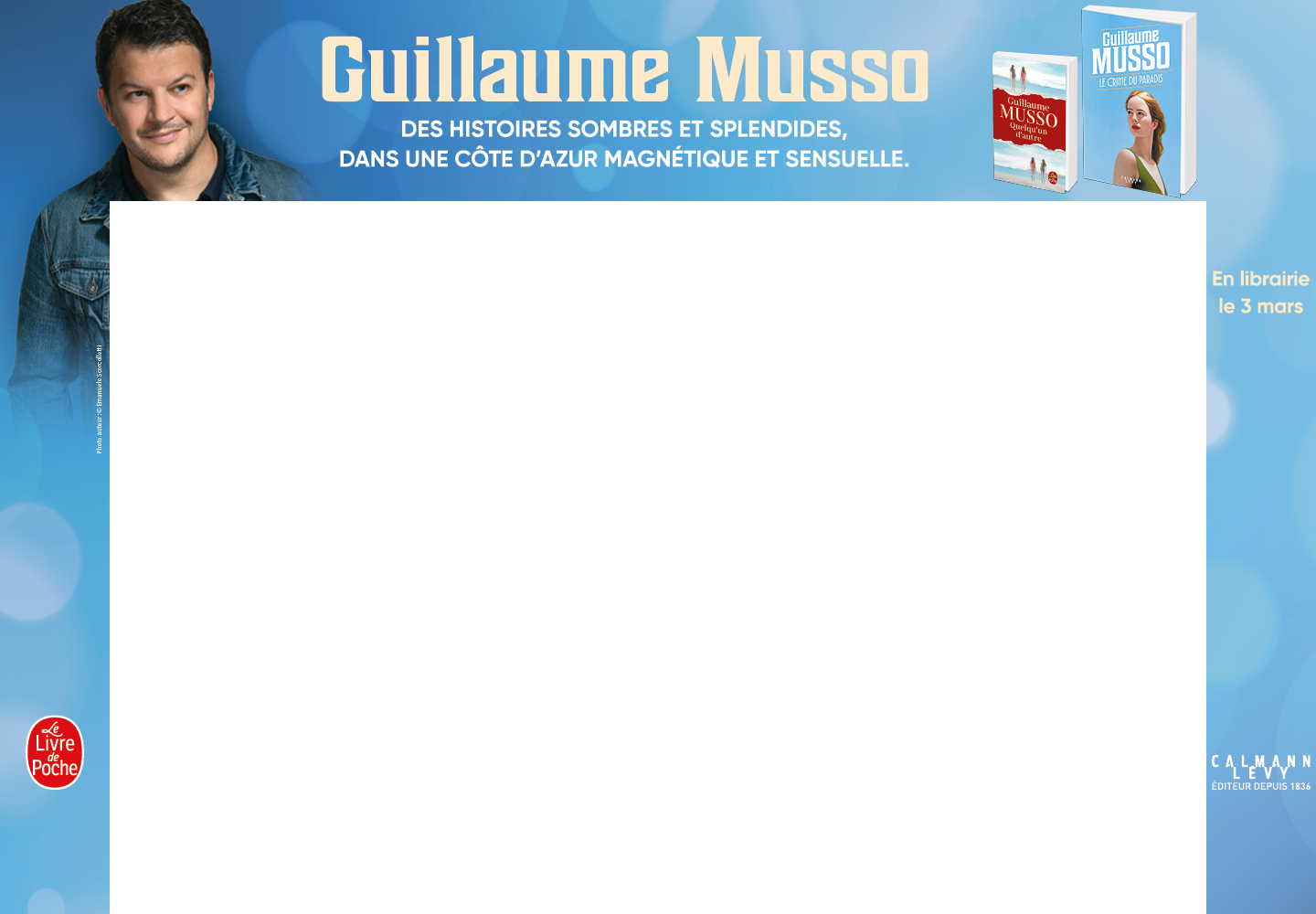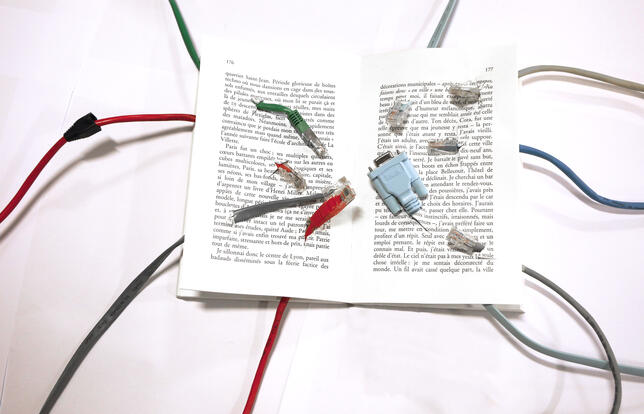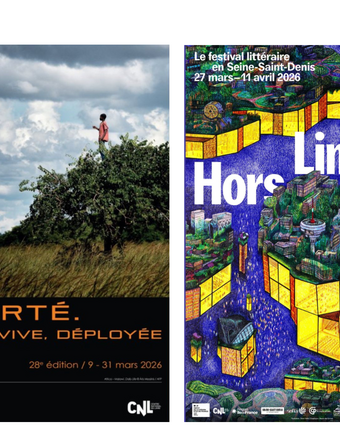À quoi l’IA sert-elle en bibliothèque universitaire ?
Améliorer la qualité des métadonnées (les enrichir, dédoublonner les notices…), recommander des contenus, optimiser le prêt entre bibliothèques… L’IA permet également de personnaliser la recherche de l’utilisateur, en reformulant ses requêtes en langage naturel ou encore en suggérant des ressources.
Lire aussi : Congrès de l'ADBU : « Les universités en France ont un vrai problème de communication »
« Au-delà de ces cas d’usage déjà répandus, plusieurs prestataires travaillent en pré-production sur la personnalisation avancée des résultats, la recherche d’images par similarité ou OCR [reconnaissance de caractères], et la synthèse automatique des résultats sous forme de résumés ou de cartographies sémantiques. Le multilinguisme se renforce également, avec des interfaces capables de traiter et de générer du contenu dans plusieurs langues. Globalement, ces évolutions sont planifiées à court ou moyen terme », indique la commission travaillant sur les systèmes d’information au sein de l’ADBU.
(In) former
Tous les prestataires prévoient des dispositifs d’accompagnement variés, tels que des webinaires, des tutoriels, des bots conversationnels voire des outils capables de fournir des explications contextuelles à mesure de leur utilisation. Et disent chercher à rendre le fonctionnement de leur logiciel transparent. Open source, explicabilité des algorithmes, signalement des contenus produits par IA… « mais la maturité de cette démarche est encore inégale ».
Quels modèles économiques ?
La moitié des prestataires envisage l’IA comme une évolution intégrée aux mises à jour des applications existantes, l’autre moitié comme un service distinct soumis à un surcoût. « Le défi sera à la fois de se démarquer des fonctionnalités proposées par les géants du secteur, sans pour autant renoncer à la performance et avec un modèle économique soutenable pour les institutions publiques », conclut l’ADBU.
L’état des lieux complet est à retrouver sur le site de l’ADBU.