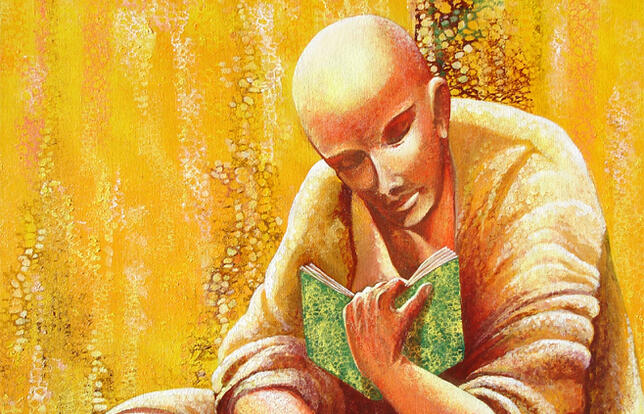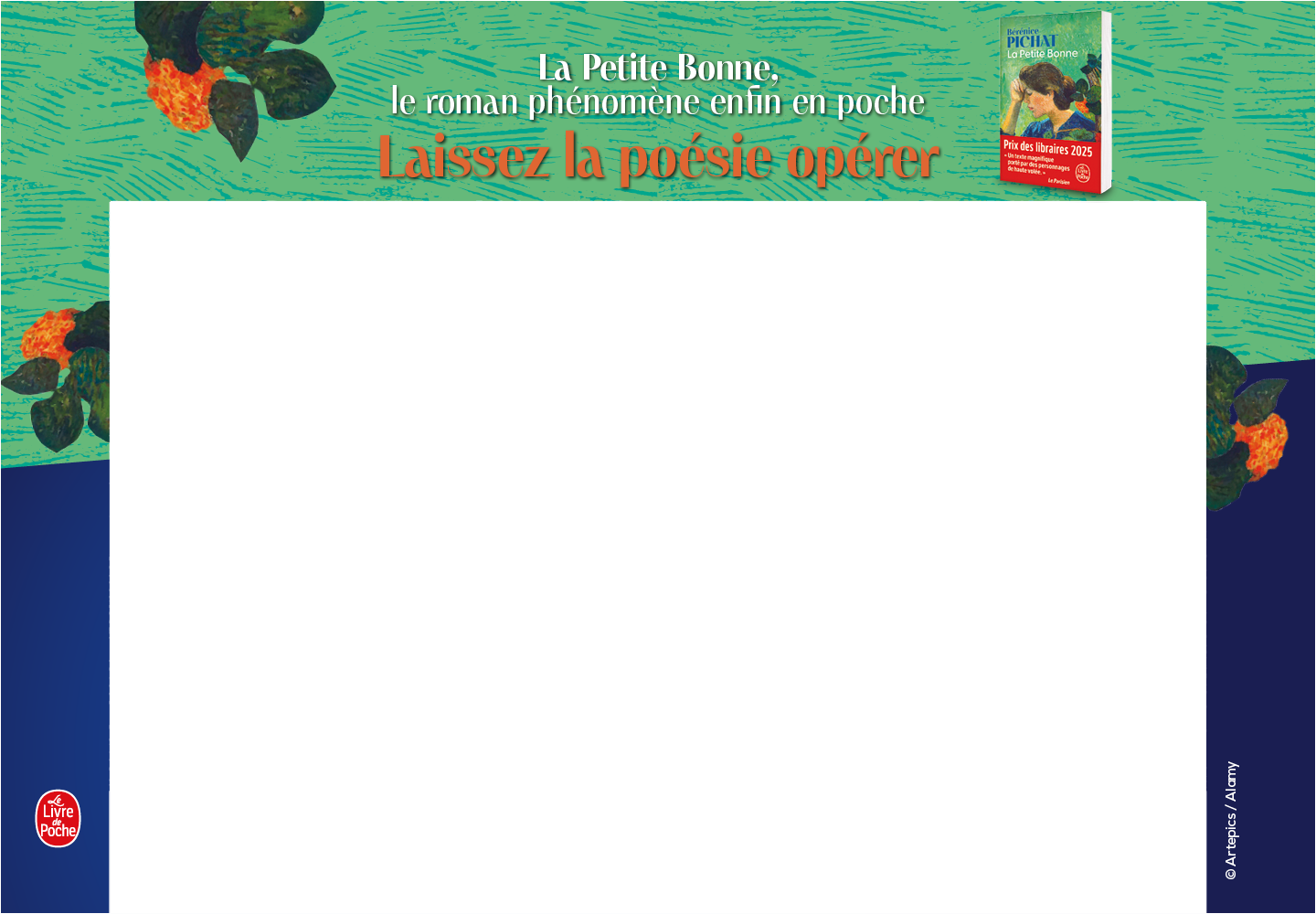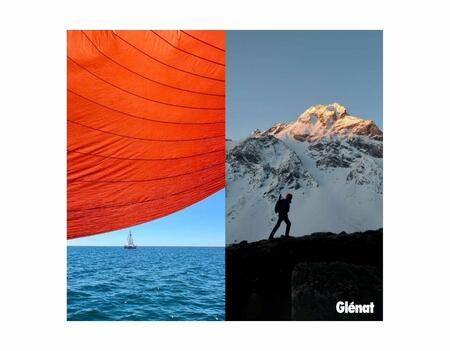Lire ?
La concurrence des écrans constituerait donc une menace. Et s'il ne s'agit plus des écrans de télévision comme dans les années 1980, ce sont les téléphones portables qui sont désormais ciblés. Et l'on peut s'interroger sur la définition même de la lecture. Les discours ne visent pas la traduction de texte en significations. L'usage des smartphones sans la lecture est-elle possible ?
Des réseaux sociaux à la presse en ligne, des SMS à la messagerie électronique, des applis de musique à celles de rencontres ou de navigation et autres, ne sommes-nous pas tout le temps en train de lire sur nos téléphones ? Et même du côté de la fiction, entre la fanfiction et les webtoons, il existe une offre de lecture abondante dont ne manquent pas de s'emparer les plus jeunes mais qui n'est pas toujours mesurée. Quelle est donc cette définition de la lecture au nom de laquelle la baisse de la lecture est présentée comme un problème ?
Lire des livres
Que ce soit les enquêtes Pratiques culturelles des Français ou celles du Centre national du livre (CNL), la lecture est mesurée par les déclarations de nombre de livres lus au cours des 12 derniers mois ou par le temps consacré à cette pratique. La « lecture » dépend donc de la fréquentation des livres. Certes, les études démontrent les bénéfices de la lecture de livres en termes de langage, de culture générale, d’attention, de capacités de rédaction… (un ensemble de données notamment compilées par Michel Desmurget dans son essai Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital, Seuil, 2023).
Mais est-ce une raison pour laisser de côté toutes les autres formes de lecture ? Où de négliger les autres formes d'accès à l'imaginaire (films et séries se portent bien) et à l'information (radio, podcasts sont des sources très riches désormais). La « lecture » est donc construite par la mesure dont elle fait l’objet et il paraît excessif d’extrapoler sa baisse sur celle de ce à quoi elle donne accès. S’il existe sans doute des aspects non substituables à la lecture, d’autres médias peuvent remplir la même fonction. Ne confondons pas le doigt et la Lune...
Et ce glissement du livre vers d’autres modes de diffusion des idées touche tous les médiateurs de contenu. Les élèves d’aujourd’hui ont de plus en plus des manuels scolaires en ligne (à quand une évaluation de la réalité de leur usage d’ailleurs ?) et la ministre de l’Éducation nationale est obligée d’imposer une déconnexion le soir et la nuit pour que les élèves (et leurs parents) se détournent des applications de suivi scolaire.
Les bibliothèques proposent de plus en plus des supports numériques parallèlement à leur offre de livres. Les journalistes ne manquent pas de renvoyer à du contenu qui n’est pas des livres. À titre d’exemple, lors de sa dernière émission sur France Inter, Thomas Legrand a orienté les auditeurs voulant en savoir davantage vers les conférences de son invité présentes sur Internet alors même que sur la page de l'émission, il faisait figurer des livres dont il est l'auteur.
Lire ou déclarer lire ?
Par ailleurs, la « baisse de la lecture » est d'abord la baisse de la déclaration des pratiques, laquelle dépend de l'évidence du livre dans les discours et représentations. Peut-être que les Français ne lisent pas moins, mais pensent moins à déclarer leurs lectures parce qu'elles sont moins valorisées et plus anodines. Moins sacralisé, le livre devient un objet de consommation courante que l'on achète de plus en plus d'occasion voire que l'on trouve dans les boîtes à livres.
Ne pas lire n'est désormais plus une marque d'infamie et il n'est donc pas nécessaire de surestimer sa pratique pour conserver son estime de soi et des autres. Et ainsi, plus les autres formes d’accès à l’information se développent, moins le livre devient une évidence collective (et donc individuelle) et plus il est possible de négliger la déclaration de cette pratique.
Des ventes qui ne reculent pas
La « baisse de la lecture » pourrait donc être en trompe-l’œil. Cette hypothèse qui date des années 1990 reste envisageable. Il faudrait pouvoir disposer de séries de données sur les pratiques réelles de lecture (et non leur déclaration). À défaut, on peut regarder du côté des chiffres de ventes de livres. Opportunément, le ministère de la Culture a publié une série de données de 1993 à 2024.
Si on s’intéresse non pas au chiffre d’affaires mais au volume des ventes, on observe une érosion moyenne de 0,2 % par an sur l’ensemble de la période. Cela correspond à une baisse de 6,3 % entre 1993 et 2019. En revanche, pour la période 2020-2024, la forte croissance de 2021 (+17,8%) conduit à une croissance moyenne de 2,4%. Cette hésitation se retrouve sur le nombre d’exemplaires vendus (hors scolaire) : entre 2010 et 2023, le nombre annuel des ventes s’établit à 380 millions d’exemplaires. On était à 390 en 2010 et 384 en 2023.
Tous ces chiffres ne décrivent pas une forte érosion des ventes et particulièrement pas dans la période récente du fait du rebond historique post-Covid. Donc y compris la « baisse de la lecture de livres » n’est pas totalement certaine quand on s’intéresse aux pratiques et non aux déclarations.
L’amour et la pitié
Dès lors, on peut s’interroger sur les discours inquiets sur la lecture. Décrivent-ils la réalité ou les angoisses d’une partie d’entre nous voire les enjeux identitaires et intérêts d’une partie des agents et des institutions ?
Au-delà de l’arbitrage sur la réalité de la situation, la question mérite d’être posée car ces discours produisent des effets. En pointant la (supposée) fragilité de la lecture, on mobilise les acteurs du monde du livre et leurs soutiens mais encourage-t-on à la lecture ? L'amour naît rarement de la pitié. Les Français ne retourneront pas vers la lecture de livres grâce à la thématique de la lecture en danger. Ils vont vers les livres quand ceux-ci sont disponibles où ils sont, avec qui ils sont, quand ils ne sont pas trop chers, qu’ils rencontrent leurs aspirations y compris non formulées et que de la place leur soit laissée dans l’appropriation qu’ils peuvent en faire.